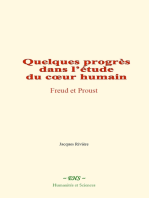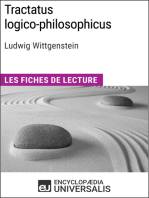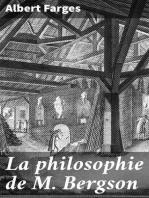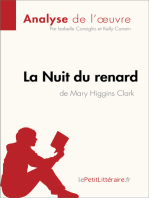Professional Documents
Culture Documents
Bergson Henri Deux Sources
Uploaded by
poa333041Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Bergson Henri Deux Sources
Uploaded by
poa333041Copyright:
Available Formats
Henri BERGSON (1932)
Les deux sources
de la morale
et de la religion
Un document produit en version numrique par Gemma Paquet, bnvole,
professeure la retraite du Cgep de Chicoutimi
Courriel: mgpaquet@videotron.ca
dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
fonde dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
Cette dition lectronique a t ralise par Gemma Paquet,
bnvole, professeure la retraite du Cgep de Chicoutimi
partir de :
Henri Bergson (1932)
Les deux sources de la morale et de la religion.
Une dition lectronique ralise partir du livre Les deux sources de la
morale et de la religion. Originalement publi en 1932. Paris : Les Presses
universitaires de France, 1948, 58e dition, 340 pages. Collection
Bibliothque de philosophie contemporaine..
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes
Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 14 aot 2003 Chicoutimi, Qubec.
Avec la prcieuse coopration de M. Bertrand Gibier, bnvole, professeur de
philosophie, qui a rcrit en grec moderne toutes les citations ou expressions
grecques contenues dans luvre originale : bertrand.gibier@ac-lille.fr.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
Table des matires
Chapitre I: L'obligation morale
Nature et socit. - L'individu dans la socit. - La socit dans
l'individu. - Obissance spontane. - Rsistance la rsistance. - L'obligation et la vie. - La socit close. - L'appel du hros. Force propulsive de
l'motion. - motion et cration. motion et reprsentation. - Libration de
l'me. Marche en avant. - Morale close et morale ouverte. Le respect de soi.
- La justice. - De l'intellectualisme en morale. - L'ducation morale. Dressage et mysticit
Chapitre II: La religion statique
De l'absurdit chez l'tre raisonnable. - La fonction fabulatrice. -La
fabulation et la vie. - Signification de l' lan vital . - Rle social de la
fabulation. - Thmes gnraux de fabulation utile. - Assurance contre la
dsorganisation. - Assurance contre la dpression. - Assurance contre
l'imprvisibilit. - Du hasard. - Mentalit primitive chez le civilis. Personnification partielle de l'vnement. - De la magie en gnral. - Magie
et science. - Magie et religion. - Dfrence l'gard des animaux. - Totmisme. - Croyance aux dieux. - La fantaisie mythologique. - Fonction
fabulatrice et littrature. - De l'existence des dieux. - Fonction gnrale de
la religion statique
Chapitre III: La religion dynamique
Deux sens du mot religion. - Pourquoi l'on emploie un seul mot. -Le
mysticisme grec. - Le mysticisme oriental. - Les prophtes d'Isral. - Le
mysticisme chrtien. - Mysticisme et rnovation. - Valeur philosophique du
mysticisme. - De l'existence de Dieu. -Nature de Dieu. Cration et amour. Le problme du mal. - La survie. De l'exprience et de la probabilit en
mtaphysique
Chapitre IV: Remarques finales. Mcanique et mystique
Socit close et socit ouverte. - Persistance du naturel. -Caractres de
la socit naturelle. - Socit naturelle et dmocratie. - La socit naturelle
et la guerre. - L'ge industriel. - volution des tendances. - Loi de dichotomie. - Loi de double frnsie. - Retour possible la vit simple. Mcanique et mystique.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
Du mme auteur
Aux Presses universitaires de France
uvres, en 1 vol. in-8 couronn. (dition du Centenaire.) (Essai sur les
donnes immdiates de la conscience. Matire et mmoire. Le rire.
L'volution cratrice. L'nergie spirituelle. Les deux sources de la morale et
de la religion. La pense et le mouvant.) 2e d.
Essai sur les donnes immdiates de la conscience, 120e d., 1 vol.in-8,
de la Bibliothque de Philosophie contemporaine .
Matire et mmoire, 72e d., 1 vol. in-8, de la Bibliothque de
Philosophie contemporaine .
Le rire, 233e d., 1 vol. in-16, de la Bibliothque de Philosophie
contemporaine .
L'volution cratrice, 118 d., 1 vol. in-8, de la Bibliothque de
Philosophie contemporaine.
L'nergie spirituelle, 132e d., 1 vol. in-8, de la Bibliothque de
Philosophie contemporaine .
La pense et le mouvant, Essais et confrences, 63e d., 1 vol.in-8, de
la Bibliothque de Philosophie contemporaine.
Dure et simultanit, propos de la thorie d'Einstein, 6e d., 1 vol. in16, de la Bibliothque de Philosophie contemporaine . (puis)
crits et paroles. Textes rassembls par Rose-Marie MOSSBASTIDE, 3 Vol. in-8, de la Bibliothque de Philosophie contemporaine .
Mmoire et vie, 2e d. Textes choisis, 1 vol. in-8 couronn, Les
Grands Textes .
Retour la table des matires
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
Chapitre I
L'obligation morale
Retour la table des matires
Le souvenir du fruit dfendu est ce qu'il y a de plus ancien dans la
mmoire de chacun de nous, comme dans celle de l'humanit. Nous nous en
apercevrions si ce souvenir n'tait recouvert par d'autres, auxquels nous
prfrons nous reporter. Que n'et pas t notre enfance si l'on nous avait
laisss faire ! Nous aurions vol de plaisirs en plaisirs. Mais voici qu'un
obstacle surgissait, ni visible ni tangible : une interdiction. Pourquoi
obissions-nous ? La question ne se posait gure ; nous avions pris l'habitude
d'couter nos parents et nos matres. Toutefois nous sentions bien que c'tait
parce qu'ils taient nos parents, parce qu'ils taient nos matres. Donc, nos
yeux, leur autorit leur venait moins d'eux-mmes que de leur situation par
rapport nous. Ils occupaient une certaine place : c'est de l que partait, avec
une force de pntration qu'il n'aurait pas eue s'il avait t lanc d'ailleurs, le
commandement. En d'autres termes, parents et matres semblaient agir par
dlgation. Nous ne nous en rendions pas nettement compte, mais derrire nos
parents et nos Matres nous devinions quelque chose d'norme ou plutt
d'indfini, qui pesait sur nous de toute sa masse par leur intermdiaire. Nous
dirions plus tard que c'est la socit. Philosophant alors sur elle, nous la
comparerions un organisme dont les cellules, unies par d'invisibles liens, se
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
subordonnent les unes aux autres dans une hirarchie savante et se plient
naturellement, pour le plus grand bien du tout, une discipline qui pourra
exiger le sacrifice de la partie. Ce ne sera d'ailleurs l qu'une comparaison, car
autre chose est un organisme soumis des lois ncessaires, autre chose une
socit constitue par des volonts libres. Mais du moment que ces volonts
sont organises, elles imitent un organisme ; et dans cet organisme plus ou
moins artificiel l'habitude joue le mme rle que la ncessit dans les uvres
de la nature. De ce premier point de vue, la vie sociale nous apparat comme
un systme d'habitudes plus ou moins fortement enracines qui rpondent aux
besoins de la communaut. Certaines d'entre elles sont des habitudes de
commander, la plupart sont des habitudes d'obir, soit que nous obissions
une personne qui commande en vertu d'une dlgation sociale, soit que de la
socit elle-mme, confusment perue ou sentie, mane un ordre impersonnel. Chacune de ces habitudes d'obir exerce une pression sur notre volont.
Nous pouvons nous y soustraire, mais nous sommes alors tirs vers elle,
ramens elle, comme le pendule cart de la verticale. Un certain ordre a t
drang, il devrait se rtablir. Bref, comme par toute habitude, nous nous
sentons obligs.
Mais c'est une obligation incomparablement plus forte. Quand une grandeur est tellement suprieure une autre que celle-ci est ngligeable par
rapport elle, les mathmaticiens disent qu'elle est d'un autre ordre. Ainsi
pour l'obligation sociale. Sa pression, compare celle des autres habitudes,
est telle que la diffrence de degr quivaut une diffrence de nature.
Remarquons en effet que toutes les habitudes (le ce genre se prtent un
mutuel appui. Nous avons beau ne pas spculer sur leur essence et leur
origine, nous sentons qu'elles ont un rapport entre elles, tant rclames de
nous par notre entourage immdiat, ou par l'entourage de cet entourage, et
ainsi de suite jusqu' la limite extrme, qui serait la socit. Chacune rpond,
directement ou indirectement, une exigence sociale ; et ds lors toutes se
tiennent, elles forment un bloc. Beaucoup seraient de petites obligations si
elles se prsentaient isolment. Mais elles font partie intgrante de l'obligation
en gnral ; et ce tout, qui doit d'tre ce qu'il est l'apport de ses parties,
confre chacune, en retour, l'autorit globale de l'ensemble. Le collectif
vient ainsi renforcer le singulier, et la formule c'est le devoir triomphe des
hsitations que nous pourrions avoir devant un &voir isol. A vrai dire, nous
ne pensons pas explicitement une masse d'obligations partielles, additionnes, qui composeraient une obligation totale. Peut-tre mme n'y a-t-il pas
vritablement ici une composition de parties. La force qu'une obligation tire
de toutes les autres est plutt comparable au souffle de vie que chacune des
cellules aspire, indivisible et complet, du fond de l'organisme dont elle est un
lment. La socit, immanente chacun de ses membres, a des exigences
qui, grandes ou petites, n'en expriment pas moins chacune le tout de sa
vitalit. Mais rptons que ce n'est l encore qu'une comparaison. Une socit
humaine est un ensemble d'tres libres. Les obligations qu'elle impose, et qui
lui permettent de subsister, introduisent en elle une rgularit qui a simplement de l'analogie avec l'ordre inflexible des phnomnes de la vie.
Tout concourt cependant nous faire croire que cette rgularit est
assimilable celle de la nature. Je ne parle pas seulement de l'unanimit des
hommes louer certains actes et en blmer d'autres. Je veux dire que l
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
mme o les prceptes moraux impliqus dans les jugements de valeur ne
sont pas observs, on s'arrange pour qu'ils paraissent l'tre. Pas plus que nous
ne voyons la maladie quand nous nous promenons dans la rue, nous ne
mesurons ce qu'il peut y avoir d'immoralit derrire la faade que l'humanit
nous montre. On mettrait bien du temps devenir misanthrope si l'on s'en
tenait l'observation d'autrui. C'est en notant ses propres faiblesses qu'on
arrive plaindre ou mpriser l'homme. L'humanit dont on se dtourne alors
est celle qu'on a dcouverte au fond de soi. Le mal se cache si bien, le secret
est si universellement gard, que chacun est ici la dupe de tous : si svrement
que nous affections de juger les autres hommes, nous les croyons, au fond,
meilleurs que nous. Sur cette heureuse illusion repose une bonne partie de la
vie sociale.
Il est naturel que la socit fasse tout pour l'encourager. Les lois qu'elle
dicte, et qui maintiennent l'ordre social, ressemblent d'ailleurs par certains
cts aux lois de la nature. Je veux bien que la diffrence soit radicale aux
yeux du philosophe. Autre chose, dit-il, est la loi qui constate, autre chose
celle qui ordonne. A celle-ci l'on peut se soustraire ; elle oblige, mais ne
ncessite pas. Celle-l est au contraire inluctable, car si quelque fait s'cartait
d'elle, c'est tort qu'elle aurait t prise pour une loi; il y en aurait une autre
qui serait la vraie, qu'on noncerait de manire exprimer tout ce qu'on observe, et laquelle alors le fait rfractaire se conformerait comme les autres. Sans doute ; mais il s'en faut que la distinction soit aussi nette pour la plupart
des hommes. Loi physique, loi sociale ou morale, toute loi est leurs yeux un
commandement. Il y a un certain ordre de la nature, lequel se traduit par des
lois : les faits obiraient ces lois pour se conformer cet ordre. Le savant
lui-mme peut peine s'empcher de croire que la loi prside aux faits et
par consquent les prcde, semblable l'Ide platonicienne sur laquelle les
choses avaient se rgler. Plus il s'lve dans l'chelle des gnralisations,
plus il incline, bon gr mal gr, doter les lois de ce caractre impratif : il
faut vraiment lutter contre soi-mme pour se reprsenter les principes de la
mcanique autrement qu'inscrits de toute ternit sur des tables transcendantes
que la science moderne serait alle chercher sur un autre Sina. Mais si la loi
physique tend revtir pour notre imagination la forme d'un commandement
quand elle atteint une certaine gnralit, rciproquement un impratif qui
s'adresse tout le monde se prsente un peu nous comme une loi de la
nature. Les deux ides, se rencontrant dans notre esprit, y font des changes.
La loi prend au commandement ce qu'il a d'imprieux; le commandement
reoit de la loi ce qu'elle d'inluctable. Une infraction l'ordre social revt
ainsi un caractre antinaturel : mme si elle est frquemment rpte, elle
nous fait l'effet d'une exception qui serait la socit ce qu'un monstre est la
nature.
Que sera-ce, si nous apercevons derrire l'impratif social un commandement religieux ! Peu importe la relation entre les deux termes. Qu'on
interprte la religion d'une manire ou d'une autre, qu'elle soit sociale par
essence ou par accident, un point est certain, c'est qu'elle a toujours jou un
rle social. Ce rle est d'ailleurs complexe ; il varie selon les temps et selon
les lieux ; mais, dans des socits telles que les ntres, la religion a pour
premier effet de soutenir et de renforcer les exigences de la socit. Elle peut
aller beaucoup plus loin, elle va tout au moins jusque-l. La socit institue
des peines qui peuvent frapper des innocents, pargner des coupables ; elle ne
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
rcompense gure ; elle voit gros et se contente de peu : o est la balance
humaine qui pserait comme il le faut les rcompenses et les peines ? Mais, de
mme que les Ides platoniciennes nous rvlent, parfaite et complte, la
ralit dont nous ne percevons que des imitations grossires, ainsi la religion
nous introduit dans une cit dont nos institutions, nos lois et nos coutumes
marquent tout au plus, de loin en loin, les points les plus saillants. Ici-bas,
l'ordre est simplement approximatif et plus ou moins artificiellement obtenu
par les hommes ; l-haut il est parfait, et se ralise de lui-mme. La religion
achve donc de combler nos yeux l'intervalle, dj rtrci par les habitudes
du sens commun, entre un commandement de la socit et une loi de la
nature.
Ainsi nous sommes toujours ramens la mme comparaison, dfectueuse
par bien des cts, acceptable pourtant sur le point qui nous intresse. Les
membres de la cit se tiennent comme les cellules d'un organisme. L'habitude,
servie par l'intelligence et l'imagination, introduit parmi eux une discipline qui
imite de loin, par la solidarit qu'elle tablit entre les individualits distinctes,
l'unit d'un organisme aux cellules anastomoses.
Tout concourt, encore une fois, faire de l'ordre social une imitation de
l'ordre observ dans les choses. Chacun de nous, se tournant vers lui-mme,
se sent videmment libre de suivre son got, son dsir ou son caprice, et de ne
pas penser aux autres hommes. Mais la vellit ne s'en est pas plutt dessine
qu'une force antagoniste survient, faite de toutes les forces sociales accumules : la diffrence des mobiles individuels, qui tireraient chacun de son
ct, cette force aboutirait un ordre qui ne serait pas sans analogie avec celui
des phnomnes naturels. La cellule composante d'un organisme, devenue
consciente pour un instant, aurait peine esquiss l'intention de s'manciper
qu'elle serait ressaisie par la ncessit. L'individu qui fait partie de la socit
peut inflchir et mme briser une ncessit qui imite celle-l, qu'il a quelque
peu contribu crer, mais que surtout il subit : le sentiment de cette ncessit, accompagn de la conscience de pouvoir s'y soustraire, n'en est pas
moins ce qu'il appelle obligation. Ainsi envisage, et prise dans son acception
la plus ordinaire, l'obligation est la ncessit ce que l'habitude est la nature.
Elle ne vient donc pas prcisment du dehors. Chacun de nous appartient
la socit autant qu' lui-mme. Si sa conscience, travaillant en profondeur,
lui rvle, mesure qu'il descend davantage, une personnalit de plus en plus
originale, incommensurable avec les autres et d'ailleurs inexprimable, par la
surface de nous-mmes nous sommes en continuit avec les autres personnes,
semblables elles, unis elles par une discipline qui cre entre elles et nous
une dpendance rciproque. S'installer dans cette partie socialise de luimme, est-ce, pour notre moi, le seul moyen de s'attacher quelque chose de
solide ? Ce le serait, si nous ne pouvions autrement nous soustraire une vie
d'impulsion, de caprice et de regret. Mais au plus profond de nous-mmes, si
nous savons le chercher, nous dcouvrirons peut-tre un quilibre d'un autre
genre, plus dsirable encore que l'quilibre superficiel. Des plantes aquatiques, qui montent la surface, sont ballottes sans cesse par le courant ;
leurs feuilles, se rejoignant au-dessus de l'eau, leur donnent de la stabilit, en
haut, par leur entrecroisement. Mais plus stables encore sont les racines,
solidement plantes dans la terre, qui les soutiennent du bas. Toutefois, de
l'effort par lequel on creuserait jusqu'au fond de soi-mme nous ne parlons pas
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
pour le moment. S'il est possible, il est exceptionnel ; et c'est sa surface,
son point d'insertion dans le tissu serr des autres personnalits extriorises,
que notre moi trouve d'ordinaire o s'attacher : sa solidit est dans cette
solidarit. Mais, au point o il s'attache, il est lui-mme socialis. L'obligation, que nous nous reprsentons comme un lien entre les hommes, lie d'abord
chacun de nous lui-mme.
C'est donc tort qu'on reprocherait une morale purement sociale de
ngliger les devoirs individuels. Mme si nous n'tions obligs, thoriquement, que vis--vis des autres hommes, nous le serions, en fait, vis--vis de
nous-mmes, puisque la solidarit sociale n'existe que du moment o un moi
social se surajoute en chacun de nous au moi individuel. Cultiver ce moi
social est l'essentiel de notre obligation vis--vis de la socit. Sans quelque
chose d'elle en nous, elle n'aurait sur nous aucune prise ; et nous avons peine
besoin d'aller jusqu' elle, nous nous suffisons nous-mmes, si nous la
trouvons prsente en nous. Sa prsence est plus ou moins marque selon les
hommes ; mais aucun de nous ne saurait s'isoler d'elle absolument. Il ne le
voudrait pas, parce qu'il sent bien que la plus grande partie de sa force vient
d'elle, et qu'il doit aux exigences sans cesse renouveles de la vie sociale cette
tension ininterrompue de son nergie, cette constance de direction dans
l'effort, qui assure son activit le plus haut rendement. Mais il ne le pourrait
pas, mme s'il le voulait, parce que sa mmoire et son imagination vivent de
ce que la socit a mis en elles, parce que l'me de la socit est immanente au
langage qu'il parle, et que, mme si personne n'est l, mme s'il ne fait que
penser, il se parle encore lui-mme. En vain on essaie de se reprsenter un
individu dgag de toute vie sociale. Mme matriellement, Robinson dans
son le reste en contact avec les autres hommes, car les objets fabriqus qu'il a
sauvs du naufrage, et sans lesquels il ne se tirerait pas d'affaire, le maintiennent dans la civilisation et par consquent dans la socit. Mais un contact
moral lui est plus ncessaire encore, car il se dcouragerait vite s'il ne pouvait
opposer des difficults sans cesse renaissantes qu'une force individuelle dont
il sent les limites. Dans la socit laquelle il demeure idalement attach il
puise de l'nergie ; il a beau ne pas la voir, elle est l qui le regarde : si le moi
individuel conserve vivant et prsent le moi social, il fera, isol, ce qu'il ferait
avec l'encouragement et mme l'appui de la socit entire. Ceux que les
circonstances condamnent pour un temps la solitude, et qui ne trouvent pas
en eux-mmes les ressources de la vie intrieure profonde, savent ce qu'il en
cote de se laisser aller , c'est--dire de ne pas fixer le moi individuel au
niveau prescrit par le moi social. Ils auront donc soin d'entretenir celui-ci,
pour qu'il ne se relche en rien de sa svrit l'gard de l'autre. Au besoin, ils
lui chercheront un point d'appui matriel et artificiel. On se rappelle le garde
forestier dont parle Kipling, seul dans sa maisonnette au milieu d'une fort de
l'Inde. Tous les soirs il se met en habit noir pour dner, afin de ne pas perdre,
dans son isolement, le respect de lui-mme 1.
Que ce moi social soit le spectateur impartial d'Adam Smith, qu'il
faille l'identifier avec la conscience morale, qu'on se sente satisfait ou mcontent de soi selon qu'il est bien ou mal impressionn, nous n'irons pas jusqu' le
dire. Nous dcouvrirons aux sentiments moraux des sources plus profondes.
Le langage runit ici sous le mme nom des choses bien diffrentes : quoi de
1
Kipling, In the Rukh, dans le recueil intitul Many inventions.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
10
commun entre le remords d'un assassin et celui qu'on peut prouver, tenace et
torturant, pour avoir froiss un amour-propre ou pour avoir t injuste
l'gard d'un enfant ? Tromper la confiance d'une me innocente qui s'ouvre
la vie est un des plus grands mfaits au regard d'une certaine conscience qui
semble n'avoir pas le sens des proportions, justement parce qu'elle n'emprunte
pas la socit son talon, ses instruments, ses mthodes de mesure. Mais
cette conscience n'est pas celle qui s'exerce le plus souvent ; elle est d'ailleurs
plus ou moins dlicate selon les personnes. En gnral, le verdict de la
conscience est celui que rendrait le moi social.
En gnral aussi, l'angoisse morale est une perturbation des rapports entre
ce moi social et le moi individuel. Analysez le sentiment du remords dans
l'me du grand criminel. Vous pourriez d'abord le confondre avec la crainte
du chtiment, car ce sont les prcautions les plus minutieuses, sans cesse
compltes et renouveles, pour cacher le crime ou pour faire qu'on ne trouve
pas le coupable ; c'est, tout instant, l'ide angoissante qu'un dtail a t
nglig et que la justice va saisir l'indice rvlateur. Mais regardez de plus
prs : il ne s'agit pas tant pour notre homme d'viter le chtiment que d'effacer
le pass, et de faire comme si le crime n'avait pas t commis. Quand personne ne sait qu'une chose est, c'est peu prs comme si elle n'tait pas. C'est
donc son crime mme que le criminel voudrait annuler, en supprimant toute
connaissance qu'en pourrait avoir une conscience humaine. Mais sa connaissance lui subsiste, et voici que de plus en plus elle le rejette hors de cette
socit o il esprait se maintenir en effaant les traces de son crime. Car on
marque encore la mme estime l'homme qu'il tait, l'homme qu'il n'est
plus ; ce n'est donc plus lui que la socit s'adresse : elle parle un autre.
Lui, qui sait ce qu'il est, il se sent plus isol parmi les hommes qu'il ne le
serait dans une le dserte ; car dans la solitude il emporterait, l'entourant et le
soutenant, l'image de la socit ; mais maintenant il est coup de l'image
comme de la chose. Il se rintgrerait dans la socit en confessant son crime;
on le traiterait alors comme il le mrite, mais c'est bien lui maintenant qu'on
s'adresserait. Il reprendrait avec les autres hommes sa collaboration. Il serait
chti par eux, mais, s'tant mis de leur ct, il serait un peu l'auteur de sa
propre condamnation ; et une partie de sa personne, la meilleure, chapperait
ainsi la peine. Telle est la force qui poussera le criminel se dnoncer.
Parfois, sans aller jusque-l, il se confessera un ami, ou a n'importe quel
honnte homme. Rentrant ainsi dans la vrit, sinon au regard de tous, au
moins pour quelqu'un, il se relie la socit sur un point, par un fil ; s'il ne se
rintgre en elle, du moins est-il ct d'elle, prs d'elle ; il cesse de lui tre
tranger ; en tout cas, il n'a plus aussi compltement rompu avec elle, ni avec
ce qu'il porte d'elle en lui-mme.
Il faut cette rupture violente pour que se rvle clairement l'adhrence de
l'individu la socit. En temps ordinaire, nous nous conformons nos obligations plutt que nous ne pensons elles. S'il fallait chaque fois en voquer
l'ide, noncer la formule, il serait beaucoup plus fatigant de faire son devoir.
Mais l'habitude suffit, et nous n'avons le plus souvent qu' nous laisser aller
pour donner la socit ce qu'elle attend de nous. Elle a d'ailleurs singulirement facilit les choses en intercalant des intermdiaires entre nous et elle :
nous avons une famille, nous exerons un mtier ou une profession; nous
appartenons notre commune, a notre arrondissement, notre dpartement ;
et, l o l'insertion du groupe dans la socit est parfaite, il nous suffit, la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
11
rigueur, de remplir nos obligations vis--vis du groupe pour tre quittes
envers la socit. Elle occupe la priphrie ; l'individu est au centre. Du centre
la priphrie sont disposs, comme autant de cercles concentriques de plus
en plus larges, les divers groupements auxquels l'individu appartient. De la
priphrie au centre, mesure que le cercle se rtrcit, les obligations s'ajoutent aux obligations et l'individu se trouve finalement devant leur ensemble.
L'obligation grossit ainsi en avanant ; mais, plus complique, elle est moins
abstraite, et elle est d'autant mieux accepte. Devenue pleinement concrte,
elle concide avec une tendance, si habituelle que nous la trouvons naturelle,
jouer dans la socit le rle que nous y assigne notre place. Tant que nous
nous abandonnons cette tendance, nous la sentons peine. Elle ne se rvle
imprieuse, comme toute habitude profonde, que si nous nous cartons d'elle.
C'est la socit qui trace l'individu le programme de son existence quotidienne. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux mille
soins de la vie journalire, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou
mme rester chez soi, sans obir des prescriptions et se plier des obligations. Un choix s'impose tout instant ; nous optons naturellement pour ce qui
est conforme la rgle. C'est peine si nous en avons conscience ; nous ne
faisons aucun effort. Une route a t trace par la socit nous la trouvons
ouverte devant nous et nous la suivons il faudrait plus d'initiative pour prendre
travers champs. Le devoir, ainsi entendu, s'accomplit presque toujours
automatiquement ; et l'obissance au devoir, si l'on s'en tenait au cas le plus
frquent, se dfinirait un laisser-aller ou un abandon. D'o vient donc que
cette obissance apparat au contraire comme un tat de tension, et le devoir
lui-mme comme une chose raide et dure ? C'est videmment que des cas se
prsentent o l'obissance implique un effort sur soi-mme. Ces cas sont
exceptionnels ; mais on les remarque, parce qu'une conscience intense les
accompagne, comme il arrive pour toute hsitation ; vrai dire, la conscience
est cette hsitation mme, l'acte qui se dclenche tout seul passant peu prs
inaperu. Alors, en raison de la solidarit de nos obligations entre elles, et
parce que le tout de l'obligation est immanent chacune de ses parties, tous
les devoirs se colorent de la teinte qu'a prise exceptionnellement tel ou tel
d'entre eux. Du point de vue pratique, il n'y a aucun inconvnient, il y a mme
certains avantages envisager ainsi les choses. Si naturellement, en effet,
qu'on fasse son devoir, on peut rencontrer en soi de la rsistance ; il est utile
de s'y attendre, et de ne pas prendre pour accord qu'il soit facile de rester bon
poux, bon citoyen, travailleur consciencieux, enfin honnte homme. Il y a
d'ailleurs une forte part de vrit dans cette opinion ; car s'il est relativement
ais de se maintenir dans le cadre social, encore a-t-il fallu s'y insrer, et
l'insertion exige un effort. L'indiscipline naturelle de l'enfant, la ncessit de
l'ducation, en sont la preuve. Il n'est que juste de tenir compte l'individu du
consentement virtuellement donn l'en. semble de ses obligations, mme s'il
n'a plus se consulter pour chacune d'elles. Le cavalier n'a qu' se laisser
porter; encore a-t-il d se mettre en selle. Ainsi pour l'individu vis--vis de la
socit. En un certain sens il serait faux, et dans tous les sens il serait dangereux, de dire que le devoir peut s'accomplir automatiquement. rigeons donc
en maxime pratique que l'obissance au devoir est une rsistance soi-mme.
Mais autre chose est une recommandation, autre chose une explication.
Lorsque, pour rendre compte de l'obligation, de son essence et de son origine,
on pose que l'obissance au devoir est avant tout un effort sur soi-mme, un
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
12
tat de tension ou de contraction, on commet une erreur psychologique qui a
vici beaucoup de thories morales. Ainsi ont surgi des difficults artificielles,
des problmes qui divisent les philosophes et que nous verrons s'vanouir
quand nous en analyserons les termes. L'obligation n'est nullement un fait
unique, incommensurable avec les autres, se dressant au-dessus d'eux comme
une apparition mystrieuse. Si bon nombre de philosophes, en particulier ceux
qui se rattachent Kant, l'ont envisage ainsi, c'est qu'ils ont confondu le
sentiment de l'obligation, tat tranquille et apparent l'inclination, avec
l'branlement que nous nous donnons parfois pour briser ce qui s'opposerait
elle.
Au sortir d'une crise rhumatismale, on peut prouver de la gne, voire de
la douleur, faire jouer ses muscles et ses articulations. C'est la sensation
globale d'une rsistance oppose par les organes. Elle dcrot peu peu, et
finit par se perdre dans la conscience que nous avons de nos mouvements
quand nous nous portons bien. On peut d'ailleurs admettre qu'elle est encore l
l'tat naissant ou plutt vanouissant, et qu'elle guette seulement l'occasion
de s'intensifier ; il faut en effet s'attendre des crises quand on est rhumatisant. Que dirait-on pourtant de celui qui ne verrait dans notre sentiment
habituel de mouvoir bras et jambes que l'attnuation d'une douleur, et qui
dfinirait alors notre facult locomotrice par un effort de rsistance la gne
rhumatismale ? Il renoncerait d'abord ainsi rendre compte des habitudes
motrices ; chacune de celles-ci implique en effet une combinaison particulire
de mouvements, et ne peut se comprendre que par elle. La facult gnrale de
marcher, de courir, de mouvoir son corps, n'est que la somme de ces habitudes
lmentaires, dont chacune trouve son explication propre dans les mouvements spciaux qu'elle enveloppe. Mais, n'ayant envisag cette facult que
globalement, et l'ayant d'ailleurs rige en force oppose une rsistance,
ncessairement on fait surgir ct d'elle le rhumatisme comme une entit
indpendante. Il semble qu'une erreur du mme genre ait t commise par
beaucoup de ceux qui ont spcul sur l'obligation. Nous avons mille obligations spciales dont chacune rclame son explication elle. Il est naturel, ou
plus prcisment habituel, de leur obir toutes. Par exception on s'cartera
de l'une d'elles, on rsistera : que si l'on rsiste cette rsistance, un tat de
tension ou de contraction se produira. C'est cette raideur que nous extriorisons quand nous prtons au devoir un aspect aussi svre.
C'est elle aussi que pensent les philosophes, quand ils croient rsoudre
l'obligation en lments rationnels. Pour rsister la rsistance, pour nous
maintenir dans le droit chemin quand le dsir, la passion ou l'intrt nous en
dtournent, nous devons ncessairement nous donner nous-mmes des
raisons. Mme si nous avons oppos au dsir illicite un autre dsir, celui-ci,
suscit par la volont, n'a pu surgir qu' l'appel d'une ide. Bref, un tre
intelligent agit sur lui-mme par l'intermdiaire de l'intelligence. Mais, de ce
que c'est par des voies rationnelles qu'on revient l'obligation, il ne suit pas
que l'obligation ait t d'ordre rationnel. Nous nous appesantirons plus tard sur
ce point ; nous ne voulons pas encore discuter les thories morales. Disons
simplement qu'autre chose est une tendance, naturelle ou acquise, autre chose
la mthode ncessairement rationnelle qu'emploiera, pour lui rendre sa force
et pour combattre ce qui s'oppose elle, un tre raisonnable. Dans ce dernier
cas, la tendance clipse peut reparatre ; et tout se passe sans doute alors
comme si l'on avait russi par cette mthode reconstituer la tendance. En
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
13
ralit, on n'a fait qu'carter ce qui la gnait ou 1'arrtait. Cela revient au
mme, je le veux bien, dans la pratique : qu'on explique le fait d'une manire
ou d'une autre, le fait est l, on a russi. Et il vaut peut-tre mieux, pour
russir, se figurer que les choses se sont passes de la premire manire. Mais
poser qu'il en est effectivement ainsi serait fausser la thorie de l'obligation.
N'est-ce pas ce qui est arriv la plupart des philosophes ?
Qu'on ne se mprenne pas sur notre pense. Mme si l'on s'en tient un
certain aspect de la morale, comme nous l'avons fait jusqu' prsent, on
constatera bien des attitudes diffrentes vis--vis du devoir. Elles jalonnent
l'intervalle entre deux attitudes ou plutt deux habitudes extrmes : circulation
si naturelle sur les voies traces par la socit qu'on les remarque peine ;
hsitation et dlibration, au contraire, sur celle qu'on prendra, sur le point
jusqu'o l'on ira, sur les trajets d'aller et de retour qu'on fera en s'engageant
successivement sur plusieurs d'entre elles. Dans le second cas, des problmes
nouveaux se posent, plus ou moins frquents ; et, l mme o le devoir est
tout trac, on y met plus ou moins de nuances en l'accomplissant. Mais
d'abord, la premire attitude est celle de l'immense majorit des hommes ; elle
est probablement gnrale dans les socits infrieures. Et ensuite on a beau
raisonner dans chaque cas particulier, formuler la maxime, noncer le
principe, dduire les consquences : si le dsir et la passion prennent la parole,
si la tentation est forte, si l'on va tomber, si tout coup ou se redresse, o
donc tait le ressort ? Une force s'affirme, que nous avons appele le tout de
l'obligation : extrait concentr, quintessence des mille habitudes spciales
que nous avons contractes d'obir aux mille exigences particulires de la vie
sociale. Elle n'est ni ceci ni cela ; et si elle parlait, alors qu'elle prfre agir,
elle dirait : Il faut parce qu'il faut. Ds lors, le travail auquel s'employait
l'intelligence en pesant les raisons, en comparant les maximes, en remontant
aux principes, tait de mettre plus de cohrence logique dans une conduite
soumise, par dfinition, aux exigences sociales ; mais cette exigence sociale
tenait l'obligation. Jamais, aux heures de tentation, on ne sacrifierait au seul
besoin de cohrence logique son intrt, sa passion, sa vanit. Parce que la
raison intervient en effet comme rgulatrice, chez un tre raisonnable, pour
assurer cette cohrence entre des rgles ou maximes obligatoires, la philosophie a pu voir en elle un principe d'obligation. Autant vaudrait croire que c'est
le volant qui fait tourner la machine.
Les exigences sociales se compltent d'ailleurs les unes les autres. Celui
mme dont l'honntet est la moins raisonne et, si je puis dire, la plus
routinire, met un ordre rationnel dans sa conduite en se rglant sur des
exigences qui sont logiquement cohrentes entre elles. Je veux bien que cette
logique soit une acquisition tardive des socits. La coordination logique est
essentiellement conomie; d'un ensemble elle dgage d'abord, en gros,
certains principes, puis elle exclut de l'ensemble tout ce qui n'est pas d'accord
avec eux. La nature est au contraire surabondante. Plus une socit est voisine
de la nature, plus large y est la part de l'accident et de l'incohrent. On rencontre chez les primitifs beaucoup d'interdictions et de prescriptions qui
s'expliquent par de vagues associations d'ides, par la superstition, par l'automatisme. Elles ne sont pas inutiles, puisque l'obissance de tous des rgles,
mme absurdes, assure la socit une cohsion plus grande. Mais l'utilit de
la rgle lui vient alors uniquement, par ricochet, du fait qu'on se soumet elle.
Des prescriptions ou des interdictions qui valent par elles-mmes sont celles
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
14
qui visent positivement la conservation ou le bien-tre de la socit. C'est la
longue, sans doute, qu'elles se sont dtaches des autres pour leur survivre.
Les exigences sociales se sont alors coordonnes entre elles et subordonnes
des principes. Mais peu importe. La logique pntre bien les socits actuelles, et celui-l mme qui ne raisonne pas sa conduite vivra, s'il se conforme
ces principes, raisonnablement.
Mais l'essence de l'obligation est autre chose qu'une exigence de la raison.
C'est tout ce que nous avons voulu suggrer jusqu' prsent. Notre expos
correspondrait de mieux en mieux la ralit, croyons-nous, mesure qu'on
aurait affaire des socits moins volues et des consciences plus rudimentaires. Il reste schmatique tant que nous nous en tenons la conscience
normale, telle que nous la trouvons aujourd'hui chez un honnte homme. Mais
justement parce que nous avons affaire alors une singulire complication de
sentiments, d'ides, de tendances qui s'entrepntrent, nous n'viterons les
analyses artificielles et les synthses arbitraires que si nous disposons d'un
schma o figurera l'essentiel. Tel est celui que nous avons essay de tracer.
Reprsentez-vous l'obligation comme pesant sur la volont la manire d'une
habitude, chaque obligation tranant derrire elle la masse accumule des
autres et utilisant ainsi, pour la pression qu'elle exerce, le poids de l'ensemble : vous avez le tout de l'obligation pour une conscience morale simple,
lmentaire. C'est l'essentiel ; et c'est quoi l'obligation pourrait la rigueur
se rduire, l mme o elle atteint sa complexit la plus haute.
On voit quel moment et dans quel sens, fort peu kantien, l'obligation
lmentaire prend la forme d'un impratif catgorique . On serait embarrass pour dcouvrir des exemples d'un tel impratif dans la vie courante. La
consigne militaire, qui est un ordre non motiv et sans rplique, dit bien
qu' il faut parce qu'il faut . Mais on a beau ne pas donner au soldat de
raison, il en imaginera une. Si nous voulons un cas d'impratif catgorique
pur, nous aurons le construire a priori ou tout au moins styliser l'exprience. Pensons donc une fourmi que traverserait une lueur de rflexion et
qui jugerait alors qu'elle a bien tort de travailler sans relche pour les autres.
Ses vellits de paresse ne dureraient d'ailleurs que quelques instants, le temps
que brillerait l'clair d'intelligence. Au dernier de ces instants, alors que
l'instinct, reprenant le dessus, la ramnerait de vive force sa tche, l'intelligence que va rsorber l'instinct dirait en guise d'adieu : il faut parce qu'il faut.
Cet il faut parce qu'il faut ne serait que la conscience momentanment
prise d'une traction subie, - de la traction qu'exercerait en se retendant le fil
momentanment dtendu. Le mme commandement retentirait l'oreille du
somnambule qui se prparerait, qui commencerait mme sortir du rve qu'il
joue : s'il retombait tout de suite en somnambulisme, un impratif catgorique
exprimerait en mots, pour la rflexion qui aurait failli surgir et qui se serait
aussitt vanouie, l'invitabilit du retour. Bref, un impratif absolument
catgorique est de nature instinctive ou somnambulique : jou comme tel
l'tat normal, reprsent comme tel si la rflexion s'veille juste assez longtemps pour qu'il puisse se formuler, pas assez longtemps pour qu'il puisse se
chercher des raisons, Mais alors, n'est-il pas vident que, chez un tre
raisonnable. un impratif tendra d'autant plus prendre la forme catgorique
que l'activit dploye, encore qu'intelligente, tendra davantage prendre la
forme instinctive ? Mais une activit qui, d'abord intelligente, s'achemine
une imitation de l'instinct est prcisment ce qu'on appelle chez l'homme une
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
15
habitude. Et l'habitude la plus puissante, celle dont la force est faite de toutes
les forces accumules, de toutes les habitudes sociales lmentaires, est
ncessairement celle qui imite le mieux l'instinct. Est-il tonnant alors que,
dans le court moment qui spare l'obligation purement vcue de l'obligation
pleinement reprsente et justifie par toute sorte de raisons, l'obligation
prenne en effet la forme de l'impratif catgorique : il faut parce qu'il
faut ?
Considrons deux lignes divergentes d'volution, et des socits
l'extrmit de l'une et de l'autre. Le type de socit qui paratra le plus naturel
sera videmment le type instinctif : le lien qui unit entre elles les abeilles de la
ruche ressemble beaucoup plus celui qui retient ensemble, coordonnes et
subordonnes les unes aux autres, les cellules d'un organisme. Supposons un
instant que la nature ait voulu, l'extrmit de l'autre ligne, obtenir des
socits o une certaine latitude ft laisse au choix individuel : elle aura fait
que l'intelligence obtnt ici des rsultats comparables, quant leur rgularit,
ceux de l'instinct dans l'autre ; elle aura eu recours l'habitude. Chacune de
ces habitudes, qu'on pourra appeler morales , sera contingente. Mais leur
ensemble, je veux dire l'habitude de contracter ces habitudes, tant la base
mme des socits et conditionnant leur existence, aura une force comparable
celle de l'instinct, et comme intensit et comme rgularit. C'est l prcisment ce que nous avons appel le tout de l'obligation . Il ne s'agira
d'ailleurs que des socits humaines telles qu'elles sont au sortir des mains de
la nature. Il s'agira de socits primitives et lmentaires. Mais la socit
humaine aura beau progresser, se compliquer et se spiritualiser : le statut de sa
fondation demeurera, ou plutt l'intention de la nature.
Or, c'est bien ainsi que les choses se sont passes. Sans approfondir un
point dont nous nous sommes occupe ailleurs, disons simplement qu'intelligence et instinct sont des formes de conscience qui ont d s'entrepntrer
l'tat rudimentaire et se dissocier en grandissant. Ce dveloppement s'est
effectu sur les deux grandes lignes d'volution de la vie animale, avec les
Arthropodes et les Vertbrs. Au bout de la premire est l'instinct des
Insectes, plus particulirement des Hymnoptres; au bout de la seconde est
l'intelligence humaine. Instinct et intelligence ont pour objet essentiel
d'utiliser des instruments : ici des outils invents, par consquent variables et
imprvus ; l des organes fournis par la nature, et par consquent immuables.
L'instrument est d'ailleurs destin un travail, et ce travail est d'autant plus
efficace qu'il est plus spcialis, plus divis par consquent entre travailleurs
diversement qualifis qui se compltent rciproquement. La vie sociale est
ainsi immanente, comme un vague idal, l'instinct comme l'intelligence ;
cet idal trouve sa ralisation la plus complte dans la ruche ou la fourmilire
d'une part, dans les socits humaines de l'autre. Humaine ou animale, une
socit est une organisation ; elle implique une coordination et gnralement
aussi une subordination d'lments les uns aux autres ; elle offre donc, ou
simplement vcu ou, de plus, reprsent, un ensemble de rgles ou de lois.
Mais, dans une ruche ou dans une fourmilire, l'individu est riv son emploi
par sa structure, et l'organisation est relativement invariable, tandis que la cit
humaine est de forme variable, ouverte a tous les progrs. Il en rsulte que,
dans les premires, chaque rgle est impose par la nature, elle est ncessaire ;
tandis que dans les autres une seule chose est naturelle, la ncessit d'une
rgle. Plus donc, dans une socit humaine, on creusera jusqu' la racine des
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
16
obligations diverses pour arriver l'obligation en gnral, plus l'obligation
tendra devenir ncessit, plus elle se rapprochera de l'instinct dans ce qu'elle
a d'imprieux. Et nanmoins on se tromperait grandement si l'on voulait
rapporter l'instinct une obligation particulire, quelle qu'elle ft. Ce qu'il
faudra toujours se dire, c'est que, aucune obligation n'tant de nature instinctive, le tout de l'obligation et t de l'instinct si les socits humaines
n'taient en quelque sorte lestes de variabilit et d'intelligence. C'est un
instinct virtuel, comme celui qui est derrire l'habitude de parler. La morale
d'une socit humaine est en effet comparable son langage. Il est remarquer que si les fourmis changent des signes, comme cela parat probable, le
signe leur est fourni par l'instinct mme qui les fait communiquer ensemble.
Au contraire, une langue est un produit de l'usage. Rien, ni dans le vocabulaire ni mme dans la syntaxe, ne vient de la nature. Mais il est naturel de
parler, et les signes invariables, d'origine naturelle, qui servent probablement
dans une socit d'insectes reprsentent ce qu'et t notre langage si la
nature, en nous octroyant la facult de parler, n'y et joint cette fonction
fabricatrice et utilisatrice de l'outil, inventive par consquent, qu'est l'intelligence. Reportons-nous sans cesse ce qu'et t l'obligation si la socit
humaine avait t instinctive au lieu d'tre intelligente : nous n'expliquerons
ainsi aucune obligation en particulier, nous donnerons mme de l'obligation
en gnral une ide qui serait fausse si l'on s'en tenait elle ; et pourtant
cette socit instinctive on devra penser, comme un pendant de la socit
intelligente, si l'on ne veut pas s'engager sans fil conducteur dans la recherche
des fondements de la morale.
De ce point de vue, l'obligation perd son caractre spcifique. Elle se
rattache aux phnomnes les plus gnraux de la vie. Quand les lments qui
composent un organisme se plient une discipline rigoureuse, peut-on dire
qu'ils se sentent obligs et qu'ils obissent un instinct social ? videmment
non ; mais si cet organisme est peine une socit, la ruche et la fourmilire
sont de vritables organismes, dont les lments sont unis entre eux par
d'invisibles liens ; et l'instinct social de la fourmi - je veux dire la force en
vertu de laquelle l'ouvrire, par exemple, excute le travail auquel elle est
prdestine par sa structure - ne peut diffrer radicalement de la cause, quelle
qu'elle soit, en vertu de laquelle chaque tissu, chaque cellule d'un corps vivant
fonctionne pour le plus grand bien de l'ensemble. Pas plus dans un cas que
dans l'autre, d'ailleurs, il n'y a proprement obligation; il y aurait plutt ncessit. Mais cette ncessit, nous l'apercevons prcisment par transparence, non
pas relle, sans doute, mais virtuelle, au fond de l'obligation morale. Un tre
ne se sent oblig que s'il est libre, et chaque obligation, prise part, implique
la libert. Mais il est ncessaire qu'il y ait des obligations ; et plus nous descendons de ces obligations particulires, qui sont au sommet, vers l'obligation
en gnral, ou, comme nous disions, vers le tout de l'obligation qui est la
base, plus l'obligation nous apparat comme la forme mme que la ncessit
prend dans le domaine de la vie quand elle exige, pour raliser certaines fins,
l'intelligence, le choix, et par consquent la libert.
On allguera de nouveau qu'il s'agit alors de socits humaines trs
simples, primitives ou tout au moins lmentaires. Sans aucun doute ; mais,
comme nous aurons occasion de le dire plus loin, le civilis diffre surtout du
primitif par la masse norme de connaissances et d'habitudes qu'il a puises,
depuis le premier veil de sa conscience, dans le milieu social o elles se
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
17
conservaient. Le naturel est en grande partie recouvert par l'acquis ; mais il
persiste, peu prs immuable, travers les sicles : habitudes et connaissances sont loin d'imprgner 1'organisme et de se transmettre hrditairement,
comme on se l'tait imagin. Il est vrai que nous pourrions tenir ce naturel
pour ngligeable, dans notre analyse de l'obligation, s'il tait cras par les
habitudes acquises qui se sont accumules sur lui pendant des sicles de
civilisation. Mais il se maintient en fort bon tat, trs vivant, dans la socit la
plus civilise. C'est lui qu'il faut se reporter, non pas pour rendre compte de
telle ou telle obligation sociale, mais pour expliquer ce que nous avons appel
le tout de l'obligation. Nos socits civilises, si diffrentes qu'elles soient de
la socit laquelle nous tions immdiatement destins par la nature,
prsentent d'ailleurs avec elle une ressemblance fondamentale.
Ce sont en effet, elles aussi, des socits closes. Elles ont beau tre trs
vastes en comparaison des petits groupements auxquels nous tions ports par
instinct, et que le mme instinct tendrait probablement reconstituer aujourd'hui si toutes les acquisitions matrielles et spirituelles de la civilisation
disparaissaient du milieu social o nous les trouvons dposes : elles n'en ont
pas moins pour essence de comprendre chaque moment un certain nombre
d'individus, d'exclure les autres. Nous disions plus haut qu'au fond de
l'obligation morale il y a l'exigence sociale. De quelle socit s'agissait-il ?
tait-ce de cette socit ouverte que serait l'humanit entire ? Nous ne tranchions pas la question, pas plus qu'on ne le fait d'ordinaire quand on parle du
devoir de l'homme envers ses semblables. On reste prudemment dans le
vague. On s'abstient d'affirmer, mais on voudrait laisser croire que la socit
humaine est ds prsent ralise. Et il est bon de le laisser croire, car nous
avons incontestablement des devoirs envers l'homme en tant qu'homme
(quoiqu'ils aient une tout autre origine, comme on le verra un peu plus loin),
et nous risquerions de les affaiblir en les distinguant radicalement des devoirs
envers nos concitoyens. L'action y trouve son compte. Mais une philosophie
morale qui ne met pas l'accent sur cette distinction est ct de la vrit ; ses
analyses en seront ncessairement fausses. En fait, quand nous posons que le
devoir de respecter la vie et la proprit d'autrui est une exigence fondamentale de la vie sociale, de quelle socit parlons-nous ? Pour rpondre, il suffit
de considrer ce qui se passe en temps de guerre. Le meurtre et le pillage,
comme aussi la perfidie, la fraude et le mensonge ne deviennent pas seulement licites ; ils sont mritoires. Les belligrants diront comme les sorcires
de Macbeth :
Fair is foul, and foul is fair.
Serait-ce possible, la transformation s'oprerait-elle aussi facilement,
gnrale et instantane, si c'tait vraiment une certaine attitude de l'homme
vis--vis de l'homme que la socit nous avait jusque-l recommande ? Oh,
je sais ce que la socit dit (elle a, je le rpte, ses raisons de le dire) ; mais
pour savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle veut, il ne faut pas trop couter ce
qu'elle dit, il faut regarder ce qu'elle fait. Elle dit que les devoirs dfinis par
elle sont bien, en principe, des devoirs envers l'humanit, mais que dans des
circonstances exceptionnelles, malheureusement invitables, l'exercice s'en
trouve suspendu. Si elle ne s'exprimait pas ainsi, elle barrerait la route au
progrs d'une autre morale, qui ne vient pas directement d'elle, et qu'elle a tout
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
18
intrt mnager. D'autre part, il est conforme nos habitudes d'esprit de
considrer comme anormal ce qui est relativement rare et exceptionnel, la
maladie par exemple. Mais la maladie est aussi normale que la sant, laquelle,
envisage d'un certain point de vue, apparat comme un effort constant pour
prvenir la maladie ou l'carter. De mme, la paix a toujours t jusqu'
prsent une prparation la dfense ou mme l'attaque, en tout cas la
guerre. Nos devoirs sociaux visent la cohsion sociale ; bon gr mal gr, ils
nous composent une attitude qui est celle de la discipline devant l'ennemi.
C'est dire que l'homme auquel la socit fait appel pour le discipliner a beau
tre enrichi par elle de tout ce qu'elle a acquis pendant des sicles de
civilisation, elle a nanmoins besoin de cet instinct primitif qu'elle revt d'un
si pais vernis. Bref, l'instinct social que nous avons aperu au fond de
l'obligation sociale vise toujours - l'instinct tant relativement immuable - une
socit close, si vaste soit-elle. Il est sans doute recouvert d'une autre morale
que par l mme il soutient et laquelle il prte quelque chose de sa force, je
veux dire de son caractre imprieux. Mais lui-mme ne vise pas l'humanit.
C'est qu'entre la nation, si grande soit-elle, et l'humanit, il y a toute la distance du fini l'indfini, du clos l'ouvert. On se plat dire que
l'apprentissage des vertus civiques se fait dans la famille, et que de mme,
chrir sa patrie, on se prpare aimer le genre humain. Notre sympathie
s'largirait ainsi par un progrs continu, grandirait en restant la mme, et
finirait par embrasser l'humanit entire. C'est l un raisonnement a priori,
issu d'une conception purement intellectualiste de l'me. On constate que les
trois groupes auxquels nous pouvons nous attacher comprennent un nombre
croissant de personnes, et l'on en conclut qu' ces largissements successifs de
l'objet aim correspond simplement une dilatation progressive du sentiment.
Ce qui encourage d'ailleurs l'illusion, c'est que, par une heureuse rencontre, la
premire partie du raisonnement se trouve tre d'accord avec les faits : les
vertus domestiques sont bien lies aux vertus civiques, pour la raison trs
simple que famille et socit, confondues l'origine, sont restes en troite
connexion. Mais entre la socit o nous vivons et l'humanit en gnral il y
a, nous le rptons, le mme contraste qu'entre le clos et l'ouvert ; la
diffrence entre les deux objets est de nature, et non plus simplement de
degr. Que sera-ce, si l'on va aux tats d'me, si l'on compare entre eux ces
deux sentiments, attachement la patrie, amour de l'humanit ? Qui ne voit
que la cohsion sociale est due, en grande partie, la ncessit pour une
socit de se dfendre contre d'autres, et que c'est d'abord contre tous les
autres hommes qu'on aime les hommes avec lesquels on vit ? Tel est l'instinct
primitif. Il est encore l, heureusement dissimul sous les apports de la civilisation ; mais aujourd'hui encore nous aimons naturellement et directement nos
parents et nos concitoyens, tandis que l'amour de l'humanit est indirect et
acquis. A ceux-l nous allons tout droit, celle-ci nous ne venons que par un
dtour ; car c'est seulement a travers Dieu, en Dieu, que la religion convie
l'homme aimer le genre humain ; comme aussi c'est seulement travers la
Raison, dans la Raison par o nous communions tous, que les philosophes
nous font regarder l'humanit pour nous montrer l'minente dignit de la
personne humaine, le droit de tous au respect. Ni dans un cas ni dans l'autre
nous n'arrivons a l'humanit par tapes, en traversant la famille et la nation. Il
faut que, d'un bond, nous nous soyons transports plus loin qu'elle et que nous
l'ayons atteinte sans l'avoir prise pour fin, en la dpassant. Qu'on parle
d'ailleurs le langage de la religion ou celui de la philosophie, qu'il s'agisse
d'amour ou de respect, c'est une autre morale, c'est un autre genre d'obligation,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
19
qui viennent se superposer la pression sociale. Il n'a t question que de
celle-ci jusqu' prsent. Le moment est venu de passer l'autre.
Nous avons cherch l'obligation pure. Pour la trouver, nous avons d
rduire la morale sa plus simple expression. L'avantage a t de voir en quoi
l'obligation consiste. L'inconvnient a t de rtrcir la morale normment.
Non pas, certes, que ce que nous en avons laiss de ct ne soit pas obligatoire : imagine-t-on un devoir qui n'obligerait pas ? Mais on conoit que, ce
qui est primitivement et purement obligatoire tant bien ce que nous venons
de dire, l'obligation s'irradie, se diffuse, et vienne mme s'absorber en quelque
autre chose qui la transfigure. Voyons donc maintenant ce que serait la morale
complte. Nous allons user de la mme mthode et passer encore, non plus en
bas mais en haut, la limite.
De tout temps ont surgi des hommes exceptionnels en lesquels cette
morale s'incarnait. Avant les saints du christianisme, l'humanit avait connu
les sages de la Grce, les prophtes d'Isral, les Arahants du bouddhisme et
d'autres encore. C'est eux que l'on s'est toujours report pour avoir cette
moralit complte, qu'on ferait mieux d'appeler absolue. Et ceci mme est
dj caractristique et instructif. Et ceci mme nous fait pressentir une
diffrence de nature, et non pas seulement de degr, entre la morale dont il a
t question jusqu' prsent et celle dont nous abordons l'tude, entre le
minimum et le maximum, entre les deux limites. Tandis que la premire est
d'autant plus pure et plus parfaite qu'elle se ramne mieux des formules
impersonnelles, la seconde, pour tre pleinement elle-mme, doit s'incarner
dans une personnalit privilgie qui devient un exemple. La gnralit de
l'une tient l'universelle acceptation d'une loi, celle de l'autre la commune
imitation d'un modle.
Pourquoi les saints ont-ils ainsi des imitateurs, et pourquoi les grands
hommes de bien ont-ils entran derrire eux des foules ? Ils ne demandent
rien, et pourtant ils obtiennent. Ils n'ont pas besoin d'exhorter; ils n'ont qu'
exister; leur existence est un appel. Car tel est bien le caractre de cette autre
morale. Tandis que l'obligation naturelle est pression ou pousse, dans la
morale complte et parfaite il y a un appel.
La nature de cet appel, ceux-l seuls l'ont connue entirement qui se sont
trouves en prsence d'une grande personnalit morale. Mais chacun de nous,
des heures o ses maximes habituelles de conduite lui paraissaient insuffisantes, s'est demand ce que tel ou tel et attendu de lui en pareille occasion.
Ce pouvait tre un parent, un ami, que nous voquions ainsi par la pense.
Mais ce pouvait aussi bien tre un homme que nous n'avions jamais rencontr,
dont on nous avait simplement racont la vie, et au jugement duquel nous
soumettions alors en imagination notre conduite, redoutant de lui un blme,
fiers de son approbation. Ce pouvait mme tre, tire du fond de l'me la
lumire de la conscience, une personnalit qui naissait en nous, que nous
sentions capable de nous envahir tout entiers plus tard, et laquelle nous
voulions nous attacher pour le moment comme fait le disciple au matre. A
vrai dire, cette personnalit se dessine du jour o l'on a adopt un modle : le
dsir de ressembler, qui est idalement gnrateur d'une forme prendre, est
dj ressemblance; la parole qu'on fera sienne est celle dont on a entendu en
soi un cho. Mais peu importe la personne. Constatons seulement que si la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
20
premire morale avait d'autant plus de force qu'elle se dissociait plus nettement en obligations impersonnelles, celle-ci au contraire, d'abord parpille
en prceptes gnraux auxquels adhrait notre intelligence mais qui n'allaient
pas jusqu' branler notre volont, devient d'autant plus entranante que la
multiplicit et la gnralit des maximes vient mieux se fondre dans l'unit et
l'individualit d'un homme.
D'o lui vient sa force ? Quel est le principe d'action qui succde ici
l'obligation naturelle ou plutt qui finit par l'absorber ? Pour le savoir, voyons
d'abord ce qui nous est tacitement demand. Les devoirs dont il a t question
jusqu' prsent sont ceux que nous impose la vie sociale ; ils nous obligent
vis--vis de la cit plutt que de l'humanit. On pourrait donc dire que la
seconde morale - si dcidment nous en distinguons deux - diffre de la premire en ce qu'elle est humaine, au lieu d'tre seulement sociale. Et l'on
n'aurait pas tout fait tort. Nous avons vu, en effet, que ce n'est pas en largissant la cit qu'on arrive l'humanit : entre une morale sociale et une morale humaine la diffrence n'est pas de degr, mais de nature. La premire est
celle laquelle nous pensons d'ordinaire quand nous nous sentons naturellement obligs. Au-dessus de ces devoirs bien nets nous aimons nous en
reprsenter d'autres, plutt flous, qui s'y superposeraient. Dvouement, don de
soi, esprit de sacrifice, charit, tels sont les mots que nous prononons quand
nous pensons eux. Mais pensons-nous alors, le plus souvent, autre chose
qu' des mots ? Non, sans doute, et nous nous en rendons bien compte.
Seulement il suffit, disons-nous, que la formule soit l ; elle prendra tout son
sens, l'ide qui viendra la remplir se fera agissante, quand une occasion se
prsentera. Il est vrai que pour beaucoup l'occasion ne se prsentera pas, ou
l'action sera remise plus tard. Chez certains la volont s'branlera bien un
peu, mais si peu que la secousse reue pourra en effet tre attribue la seule
dilatation du devoir social, largi et affaibli en devoir humain. Mais que les
formules se remplissent de matire et que la matire s'anime - c'est une vie
nouvelle qui s'annonce ; nous comprenons, nous sentons qu'une autre morale
survient. Donc, en parlant ici d'amour de l'humanit, on caractriserait sans
doute cette morale. Et pourtant on n'en exprimerait pas l'essence, car l'amour
de l'humanit n'est pas un mobile qui se suffise lui-mme et qui agisse
directement. Les ducateurs de la jeunesse savent bien qu'on ne triomphe pas
de lgosme en recommandant l'altruisme . Il arrive mme qu'une me
gnreuse, impatiente de se dvouer, se trouve tout coup refroidie a l'ide
qu'elle va travailler pour le genre humain . L'objet est trop vaste, l'effet trop
dispers. On peut donc conjecturer que si l'amour de l'humanit est constitutif
de cette morale, c'est peu prs comme est implique, dans l'intention
d'atteindre un point, la ncessit de franchir l'espace intermdiaire. En un
sens, c'est la mme chose ; en un autre, c'est tout diffrent. Si l'on ne pense
qu' l'intervalle et aux points, en nombre infini, qu'il faudra traverser un un,
on se dcouragera de partir, comme la flche de Znon ; on n'y verra d'ailleurs
aucun intrt, aucun attrait. Mais si l'on enjambe l'intervalle en ne considrant
que l'extrmit ou mme en regardant plus loin, on aura facilement accompli
un acte simple en mme temps qu'on sera venu bout de la multiplicit infinie
dont cette simplicit est l'quivalent. Quel est donc ici le terme, quelle est la
direction de l'effort? Qu'est-ce, en un mot, qui nous est proprement demand ?
Dfinissons d'abord l'attitude morale de l'homme que nous avons considr jusqu' prsent. Il fait corps avec la socit ; lui et elle sont absorbs
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
21
ensemble dans une mme tche de conservation individuelle et sociale. Ils
sont tourns vers eux-mmes. Certes, il est douteux que l'intrt particulier
s'accorde invariablement avec l'intrt gnral : on sait quelles difficults
insolubles s'est toujours heurte la morale utilitaire quand elle a pos en
principe que l'individu ne pouvait rechercher que son bien propre, quand elle
a prtendu qu'il serait conduit par l vouloir le bien d'autrui. Un tre
intelligent, la poursuite de ce qui est de son intrt personnel, fera souvent
tout autre chose que ce que rclamerait l'intrt gnral. Si pourtant la morale
utilitaire s'obstine reparatre sous une forme ou sous une autre, c'est qu'elle
n'est pas insoutenable ; et si elle peut se soutenir, c'est justement parce qu'audessous de l'activit intelligente, qui aurait en effet opter entre l'intrt
personnel et l'intrt d'autrui, il y a un substratum d'activit instinctive primitivement tabli par la nature, o l'individuel et le social sont tout prs de se
confondre. La cellule vit pour elle et aussi pour l'organisme, lui apportant et
lui empruntant de la vitalit; elle se sacrifiera au tout s'il en est besoin ; et elle
se dirait sans doute alors, si elle tait consciente, que c'est pour elle-mme
qu'elle le fait. Tel serait probablement aussi l'tat d'me d'une fourmi rflchissant sur sa conduite. Elle sentirait que son activit est suspendue quelque chose d'intermdiaire entre le bien de la fourmi et celui de la fourmilire.
Or. c'est cet instinct fondamental que nous avons rattach l'obligation
proprement dite : elle implique, l'origine, un tat de choses o l'individuel et
le social ne se distinguent pas l'un de l'autre. C'est pourquoi nous pouvons dire
que l'attitude laquelle elle correspond est celle d'un individu et d'une socit
recourbs sur eux-mmes. Individuelle et sociale tout a la fois, l'me tourne
ici dans un cercle. Elle est close.
L'autre attitude est celle de l'me ouverte. Que laisse-t-elle alors entrer ? Si
l'on disait qu'elle embrasse l'humanit entire, on n'irait pas trop loin, on
n'irait mme pas assez loin, puisque son amour s'tendra aux animaux, aux
plantes, toute la nature. Et pourtant rien de ce qui viendrait ainsi l'occuper ne
suffirait dfinir l'attitude qu'elle a prise, car de tout cela elle pourrait la
rigueur se passer. Sa forme ne dpend pas de son contenu. Nous venons de la
remplir ; nous pourrions aussi bien, maintenant, la vider. La charit subsisterait chez celui qui la possde, lors mme qu'il n'y aurait plus d'autre vivant
sur la terre.
Encore une fois, ce n'est pas par une dilatation de soi qu'on passera du
premier tat au second. Une psychologie trop purement intellectualiste, qui
suit les indications du langage, dfinira sans doute les tats d'me par les
objets auxquels ils sont attachs : amour de la famille, amour de la patrie,
amour de l'humanit, elle verra dans ces trois inclinations un mme sentiment
qui se dilate de plus en plus, pour englober un nombre croissant de personnes.
Le fait que ces tats d'me se traduisent au dehors par la mme attitude ou le
mme mouvement, que tous trois nous inclinent, nous permet de les grouper
sous le concept d'amour et de les exprimer par le mme mot ; on les
distinguera alors en nommant trois objets, de plus en plus larges, auxquels ils
se rapporteraient, Cela suffit, en effet, les dsigner. Mais est-ce les dcrire ?
Est-ce les analyser ? Au premier coup dil, la conscience aperoit entre les
deux premiers sentiments et le troisime une diffrence de nature. Ceux-l
impliquent un choix et par consquent une exclusion : ils pourront inciter la
lutte ; ils n'excluent pas la haine. Celui-ci n'est qu'amour. Ceux-l vont tout
droit se poser sur un objet qui les attire. Celui-ci ne cde pas un attrait de
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
22
son objet; il ne l'a pas vis ; il s'est lanc plus loin, et n'atteint l'humanit
qu'en la traversant. A-t-il, proprement parler, un objet ? Nous nous le demanderons. Bornons-nous pour le moment constater que cette attitude de
l'me, qui est plutt un mouvement, se suffit elle-mme.
Toutefois un problme se pose l'gard d'elle, qui est tout rsolu pour
l'autre. Celle-ci a t voulue en effet par la nature; on vient de voir comment
et pourquoi nous nous sentons tenus de l'adopter. Mais celle-l est acquise ;
elle a exig, elle exige toujours un effort. D'o vient que les hommes qui en
ont donn l'exemple ont trouv d'autres hommes pour les suivre ? Et quelle est
la force qui fait pendant ici la pression sociale ? Nous n'avons pas le choix.
En dehors de l'instinct et de l'habitude, il n'y a d'action directe sur le vouloir
que celle de la sensibilit. La propulsion exerce par le sentiment peut
d'ailleurs ressembler de prs l'obligation. Analysez la passion de l'amour,
surtout ses dbuts : est-ce le plaisir qu'elle vise ? ne serait-ce pas aussi bien
la peine ? Il y a peut-tre une tragdie qui se prpare, toute une vie gche,
dissipe, perdue, on le sait, on le sent, n'importe ! il faut parce qu'il faut. La
grande perfidie de la passion naissante est justement de contrefaire le devoir.
Mais point n'est besoin d'aller jusqu' la passion. Dans l'motion la plus
tranquille peut entrer une certaine exigence d'action, qui diffre de l'obligation
dfinie tout l'heure en ce qu'elle ne rencontrera pas de rsistance, en ce
qu'elle n'imposera que du consenti, mais qui n'en ressemble pas moins
l'obligation en ce qu'elle impose quelque chose. Nulle part nous ne nous en
apercevons mieux que l o cette exigence suspend son effet pratique, nous
laissant ainsi le loisir de rflchir sur elle et d'analyser ce que nous prouvons.
C'est ce qui arrive dans l'motion musicale, par exemple. Il nous semble,
pendant que nous coutons, que nous ne pourrions pas vouloir autre chose que
ce que la musique nous suggre, et que c'est bien ainsi que nous agirions
naturellement, ncessairement, si nous ne nous reposions d'agir en coutant.
Que la musique exprime la joie, la tristesse, la piti, la sympathie, nous sommes chaque instant ce qu'elle exprime. Non seulement nous, mais beaucoup
d'autres, mais tous les autres aussi. Quand la musique pleure, c'est l'humanit,
c'est la nature entire qui pleure avec elle. A vrai dire, elle n'introduit pas ces
sentiments en nous ; elle nous introduit plutt en eux, comme des passants
qu'on pousserait dans une danse. Ainsi procdent les initiateurs en morale. La
vie a pour eux des rsonances de sentiment insouponnes, comme en pourrait donner une symphonie nouvelle ; ils nous font entrer avec eux dans cette
musique, pour que nous la traduisions en mouvement.
C'est par excs d'intellectualisme qu'on suspend le sentiment un objet et
qu'on tient toute motion pour la rpercussion, dans la sensibilit, d'une
reprsentation intellectuelle. Pour reprendre l'exemple de la musique, chacun
sait qu'elle provoque en nous des motions dtermines, joie, tristesse, piti,
sympathie, et que ces motions peuvent tre intenses, et qu'elles sont
compltes pour nous, encore qu'elles ne s'attachent rien. Dira-t-on que nous
sommes ici dans le domaine de l'art, et non pas dans la ralit, que nous ne
nous mouvons alors que par jeu, que notre tat d'me est purement imaginatif, que d'ailleurs le musicien ne pourrait pas susciter cette motion en nous,
la suggrer sans la causer, si nous ne l'avions dj prouve dans la vie relle,
alors qu'elle tait dtermine par un objet dont l'art n'a plus eu qu' la dtacher
? Ce serait oublier que joie, tristesse, piti, sympathie sont des mots exprimant
des gnralits auxquelles il faut bien se reporter pour traduire ce que la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
23
musique fait prouver, mais qu' chaque musique nouvelle adhrent des
sentiments nouveaux, cres par cette musique et dans cette musique, dfinis et
dlimits par le dessin mme, unique en son genre, de la mlodie ou de la
symphonie. Ils n'ont donc pas t extraits de la vie par l'art ; c'est nous qui,
pour les traduire en mots, sommes bien obligs de rapprocher le sentiment
cre par l'artiste de ce qui y ressemble le plus dans la vie. Mais prenons mme
les tats d'me effectivement causes par des choses, et comme prfigurs en
elles. En nombre dtermin, c'est--dire limit, sont ceux qui ont t voulus
par la nature. On les reconnat ce qu'ils sont faits pour pousser des actions
qui rpondent des besoins. Les autres, au contraire, sont de vritables
inventions, comparables celles du musicien, et l'origine desquelles il y a
un homme. Ainsi la montagne a pu, de tout temps, communiquer ceux qui la
contemplaient certains sentiments comparables des sensations et qui lui
taient en effet adhrents. Mais Rousseau a cr, propos d'elle, une motion
neuve et originale. Cette motion est devenue courante, Rousseau l'ayant
lance dans la circulation. Et aujourd'hui encore c'est Rousseau qui nous la
fait prouver, autant et plus que la montagne. Certes, il y avait des raisons
pour que cette motion, issue de l'me de Jean-Jacques, s'accrocht la montagne plutt qu' tout autre objet : les sentiments lmentaires, voisins de la
sensation, provoqus directement par la montagne devaient s'accorder avec
l'motion nouvelle. Mais Rousseau les a ramasss ; il les a fait entrer, simples
harmoniques dsormais, dans un timbre dont il a donn, par une cration
vritable, la note fondamentale. De mme pour l'amour de la nature en
gnral. Celle-ci a de tout temps suscit des sentiments qui sont presque des
sensations ; on a toujours got la douceur des ombrages, la fracheur des
eaux, etc., enfin ce que suggre le mot amoenus par lequel les Romains
caractrisaient le charme de la campagne. Mais une motion neuve, srement
cre par quelqu'un, ou quelques-uns, est venue utiliser ces notes prexistantes comme des harmoniques, et produire ainsi quelque chose de comparable
au timbre original d'un nouvel instrument, ce que nous appelons dans nos
pays le sentiment de la nature. La note fondamentale ainsi introduite aurait pu
tre autre, comme il est arriv en Orient, plus particulirement au Japon :
autre et alors t le timbre. Les sentiments voisins de la sensation, troitement lis aux objets qui les dterminent, peuvent d'ailleurs aussi bien attirer
eux une motion antrieurement cre, et non pas toute neuve. C'est ce qui
s'est pass pour l'amour. De tout temps la femme a d inspirer l'homme une
inclination distincte du dsir, qui y restait cependant contigu et comme
soude, participant la fois du sentiment et de la sensation. Mais l'amour
romanesque a une date : il a surgi au moyen ge, le jour o l'on s'avisa d'absorber l'amour naturel dans un sentiment en quelque sorte surnaturel, dans
l'motion religieuse telle que le christianisme l'avait cre et jete dans le
monde. Quand on reproche au mysticisme de s'exprimer la manire de la
passion amoureuse, on oublie que c'est l'amour qui avait commenc par
plagier la mystique, qui lui avait emprunt sa ferveur, ses lans, ses extases ;
en utilisant le langage d'une passion qu'elle avait trans. figure, la mystique
n'a fait que reprendre son bien. Plus, d'ailleurs, l'amour confine l'adoration,
plus grande est la disproportion entre l'motion et l'objet, plus profonde par
consquent la dception laquelle l'amoureux s'expose, - moins qu'il ne
s'astreigne indfiniment voir l'objet travers l'motion, n'y pas toucher,
le traiter religieusement. Remarquons que les anciens avaient dj parl des
illusions de l'amour, mais il s'agissait alors d'erreurs apparentes celles des
sens et qui concernaient la figure de la femme qu'on aime, sa taille, sa
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
24
dmarche, son caractre. On se rappelle la description de Lucrce : l'illusion
porte seulement ici sur les qualits de l'objet aim, et non pas, comme l'illusion moderne, sur ce qu'on peut attendre de l'amour. Entre l'ancienne illusion
et celle que nous y avons surajoute il y a la mme diffrence qu'entre le
sentiment primitif, manant de l'objet lui. mme, et l'motion religieuse,
appele du dehors, qui est venue le recouvrir et le dborder. La marge laisse
la dception est maintenant norme, parce que c'est l'intervalle entre le divin
et l'humain.
Qu'une motion neuve soit a l'origine des grandes crations de l'art, de la
science et de la civilisation en gnral, cela ne nous parat pas douteux. Non
pas seulement parce que l'motion est un stimulant, parce qu'elle incite
l'intelligence entreprendre et la volont a persvrer. Il faut aller beaucoup
plus loin. Il y a des motions qui sont gnratrices de pense ; et l'invention,
quoique d'ordre intellectuel, peut avoir de la sensibilit pour substance. C'est
qu'il faut s'entendre sur la signification des mots motion , sentiment ,
sensibilit . Une motion est un branlement affectif de l'me, mais autre
chose est une agitation de la surface, autre chose un soulvement des profondeurs. Dans le premier cas l'effet se disperse, dans le second il reste indivis.
Dans l'un, c'est une oscillation des parties sans dplacement du tout ; dans
l'autre, le tout est pouss en avant. Mais sortons des mtaphores. Il faut
distinguer deux espces d'motion, deux varits de sentiment, deux manifestations de sensibilit, qui n'ont de commun entre elles que d'tre des tats
affectifs distincts de la sensation et de ne pas se rduire, comme celle-ci, la
transposition psychologique d'une excitation physique. Dans la premire,
l'motion est conscutive une ide ou une image reprsente ; l'tat sensible rsulte bien d'un tat intellectuel qui ne lui doit rien, qui se suffit luimme et qui, s'il en subit l'effet par ricochet, y perd plus qu'il n'y gagne. C'est
l'agitation de la sensibilit par une reprsentation qui y tombe. Mais l'autre
motion n'est pas dtermine par une reprsentation dont elle prendrait la
suite et dont elle resterait distincte. Bien plutt serait-elle, par rapport aux
tats intellectuels qui surviendront, une cause et non plus un effet; elle est
grosse de reprsentations, dont aucune n'est proprement forme, mais qu'elle
tire ou pourrait tirer de sa substance par un dveloppement organique. La
premire est infra-intellectuelle ; c'est d'elle que les psychologues s'occupent
gnralement, et c'est elle qu'on pense quand on oppose la sensibilit
l'intelligence ou quand on fait de l'motion un vague reflet de la reprsentation. Mais de l'autre nous dirions volontiers qu'elle est supra-intellectuelle, si
le mot n'voquait tout de suite, et exclusivement, l'ide d'une supriorit de
valeur ; il s'agit aussi bien d'une antriorit dans le temps, et de la relation de
ce qui engendre ce qui est engendr. Seule, en effet, l'motion du second
genre peut devenir gnratrice d'ides.
On ne s'en rend pas compte quand on traite de fminine , avec une
nuance de ddain, une psychologie qui fait une place si large et si belle la
sensibilit. Ceux qui parlent ainsi ont pour premier tort de s'en tenir aux
banalits qui ont cours sur la femme, alors qu'il serait si facile d'observer.
Nous n'allons pas nous engager, seule fin de corriger une expression
inexacte, dans une tude compare des deux sexes. Bornons-nous dire que la
femme est aussi intelligente que l'homme, mais qu'elle est moins capable
d'motion, et que si quelque puissance de l'me se prsente chez elle avec un
moindre dveloppement, ce n'est pas l'intelligence, c'est la sensibilit. Il s'agit,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
25
bien entendu, de la sensibilit profonde, et non pas de l'agitation en surface 1.
Mais peu importe. Le plus grand tort de ceux qui croiraient rabaisser l'homme
en rattachant la sensibilit les plus hautes facults de l'esprit est de ne pas
voir o est prcisment la diffrence entre l'intelligence qui comprend,
discute, accepte ou rejette, s'en tient enfin la critique, et celle qui invente.
Cration signifie, avant tout, motion. Il ne s'agit pas seulement de la
littrature et de l'art. On sait ce qu'une dcouverte scientifique implique de
concentration et d'effort. Le gnie a t dfini une longue patience. Il est vrai
qu'on se reprsente l'intelligence part, et part aussi une facult gnrale
d'attention, laquelle, plus ou moins dveloppe, concentrerait plus ou moins
fortement l'intelligence. Mais comment cette attention indtermine, extrieure l'intelligence, vide de matire, pourrait-elle, par le seul fait de se joindre
l'intelligence, en faire surgir ce qui n'y tait pas ? On sent bien que la
psychologie est encore dupe du langage quand, ayant dsign par le mme
mot toutes les attentions prtes dans tous les cas possibles, elle ne voit plus
entre elles, supposes alors de mme qualit, que des diffrences de grandeur.
La vrit est que dans chaque cas l'attention est marque d'une nuance spciale, et comme individualise, par l'objet auquel elle s'applique : c'est pourquoi la psychologie incline dj parler d' intrt autant que d'attention et
faire ainsi intervenir implicitement la sensibilit, plus susceptible de se
diversifier selon les cas particuliers. Mais alors on n'appuie pas assez sur la
diversit ; on pose une facult gnrale de s'intresser, laquelle, toujours la
mme, ne se diversifierait encore que par une application plus ou moins
grande son objet. Ne parlons donc pas d'intrt en gnral. Disons que le
problme qui a inspir de l'intrt est une reprsentation double d'une motion, et que l'motion, tant la fois la curiosit, le dsir et la joie anticipe de
rsoudre un problme dtermin, est unique comme la reprsentation. C'est
elle qui pousse l'intelligence en avant, malgr les obstacles. C'est elle surtout
qui vivifie, ou plutt qui vitalise, les lments intellectuels avec lesquels elle
fera corps, ramasse tout moment ce qui pourra s'organiser avec eux, et
obtient finalement de l'nonc du problme qu'il s'panouisse en solution. Que
sera-ce dans la littrature et dans l'art! Luvre gniale est le plus souvent
sortie d'une motion unique en son genre, qu'on et crue inexprimable, et qui
a voulu s'exprimer. Mais n'en est-il pas ainsi de toute oeuvre, si imparfaite
soit-elle, o entre une part de cration ? Quiconque s'exerce la composition
littraire a pu constater la diffrence entre l'intelligence laisse elle. mme et
celle que consume de son feu l'motion originale et unique, ne d'une concidence entre l'auteur et son sujet, c'est--dire d'une intuition. Dans le premier
cas l'esprit travaille froid, combinant entre elles des ides, depuis longtemps
coules en mots, que la socit lui livre l'tat solide. Dans le second, il
semble que les matriaux fournis par l'intelligence entrent pralablement en
fusion et qu'ils se solidifient ensuite nouveau en ides cette fois informes
1
Inutile de dire qu'il y a bien des exceptions. La ferveur religieuse, par exemple, petit
atteindre chez la femme des profondeurs insouponnes. Mais la nature a probablement
voulu, en rgle gnrale. que la femme concentrt sur l'enfant et enfermt dans des
limites assez troites le meilleur de sa sensibilit. Dans ce domaine elle est d'ailleurs
incomparable ; l'motion est ici supra-intellectuelle, en ce qu'elle devient divination. Que
de choses surgissent devant les yeux merveills d'une mre qui regarde son petit enfant !
Illusion peut-tre ? Ce n'est pas sr. Disons plutt que la ralit est grosse de possibilits,
et que la mre voit dans l'enfant non seulement ce qu'il sera, mais encore tout ce qu'il
pourrait tre s'il ne devait pas chaque instant de sa vie choisir, et par consquent
exclure.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
26
par l'esprit lui-mme : si ces ides trouvent des mots prexistants pour les
exprimer, cela fait pour chacune l'effet d'une bonne fortune inespre; et,
vrai dire, il a souvent fallu aider la chance, et forcer le sens du mot pour qu'il
se modelt sur la pense. L'effort est cette fois douloureux, et le rsultat
alatoire. Mais c'est alors seulement que l'esprit se sent ou se croit crateur. Il
ne part plus d'une multiplicit d'lments tout faits pour aboutir une unit
composite o il y aura un nouvel arrangement de l'ancien. Il s'est transport
tout d'un coup a quelque chose qui parat la fois un et unique, qui cherchera
ensuite s'taler tant bien que mal en concepts multiples et communs, donns
d'avance dans des mots.
En rsum, ct de l'motion qui est l'effet de la reprsentation et qui s'y
surajoute, il y a celle qui prcde la reprsentation, qui la contient virtuellement et qui en est jusqu' un certain point la cause. Un drame qui est peine
une oeuvre littraire pourra secouer nos nerfs et susciter une motion du
premier genre, intense sans doute, mais banale, cueillie parmi celles que nous
prouvons couramment dans la vie, et en tout cas vide de reprsentation. Mais
l'motion provoque en nous par une grande uvre dramatique est d'une tout
autre nature : unique en son genre, elle a surgi dans l'me du pote, et l seulement, avant d'branler la ntre ; c'est d'elle que l'uvre est sortie, car c'est
elle que l'auteur se rfrait au fur et mesure de la composition de l'ouvrage.
Elle n'tait qu'une exigence de cration, mais une exigence dtermine, qui a
t satisfaite par luvre une fois ralise et qui ne l'aurait t par une autre
que si celle-ci avait eu avec la premire une analogie interne et profonde,
comparable celle qui existe entre deux traductions, galement acceptables,
d'une mme musique en ides ou en images.
C'est dire qu'en faisant une large part l'motion dans la gense de la
morale, nous ne prsentons nullement une morale de sentiment . Car il
s'agit d'une motion capable de cristalliser en reprsentations, et mme en
doctrine. De cette doctrine, pas plus que de toute autre, on n'et pu dduire
cette morale ; aucune spculation ne crera une obligation ou rien qui y
ressemble; peu m'importe la beaut de la thorie, je pourrai toujours dire que
je ne l'accepte pas ; et, mme si je l'accepte, je prtendrai rester libre de me
conduire ma guise. Mais si l'atmosphre d'motion est l, si je l'ai respire,
si l'motion me pntre, j'agirai selon elle, soulev par elle. Non pas contraint
ou ncessit, mais en vertu d'une inclination laquelle je ne voudrais pas
rsister. Et au lieu d'expliquer mon acte par l'motion elle-mme, je pourrai
aussi bien le dduire alors de la thorie qu'on aura construite par la transposition de l'motion en ides. Nous entrevoyons ici la rponse possible une
question grave, que nous retrouverons plus loin, mais que nous venons de
frler en passant. On se plat dire que si une religion apporte une morale
nouvelle, elle l'impose par la mtaphysique qu'elle fait accepter, par ses ides
sur Dieu, sur l'univers, sur la relation de l'un l'autre. A quoi l'on a rpondu
que c'est au contraire par la supriorit de sa morale qu'une religion gagne les
mes et les ouvre une certaine conception des choses. Mais l'intelligence
reconnatrait-elle la supriorit de la morale qu'on lui propose, tant donn
qu'elle ne peut apprcier des diffrences de valeur que par des comparaisons
avec une rgle ou un idal, et que l'idal et la rgle sont ncessairement
fournis par la morale qui occupe dj la place ? D'autre part, comment une
conception nouvelle de l'ordre du monde serait-elle autre chose qu'une philosophie de plus, mettre avec celles que nous connaissons ? Mme si notre
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
27
intelligence s'y rallie, nous n'y verrons jamais qu'une explication thoriquement prfrable aux autres. Mme si elle nous parat recommander, comme
s'harmonisant mieux avec elle, certaines rgles nouvelles de conduite, il y
aura loin de cette adhsion de l'intelligence une conversion de la volont.
Mais la vrit est que ni la doctrine, l'tat de pure reprsentation intellectuelle, ne fera adopter et surtout pratiquer la morale, ni la morale, envisage
par l'intelligence comme un systme de rgles de conduite, ne rendra intellectuellement prfrable la doctrine, Avant la nouvelle morale, avant la mtaphysique nouvelle, il y a l'motion, qui se prolonge en lan du ct de la
volont, et en reprsentation explicative dans l'intelligence. Posez, par
exemple, l'motion que le christianisme a apporte sous le nom de charit : si
elle gagne les mes, une certaine conduite s'ensuit, et une certaine doctrine se
rpand. Ni cette mtaphysique n'a impos cette morale, ni cette morale ne fait
prfrer cette mtaphysique. Mtaphysique et morale expriment la mme
chose, l'une en termes d'intelligence, l'autre en termes de volont ; et les deux
expressions sont acceptes ensemble ds qu'on s'est donn la chose exprimer.
Qu'une bonne moiti de notre morale comprenne des devoirs dont le caractre obligatoire s'explique en dernire analyse par la pression de la socit
sur l'individu, on l'accordera sans trop de peine, parce que ces devoirs sont
pratiqus couramment, parce qu'ils ont une formule nette et prcise et qu'il
nous est alors facile, en les saisissant par leur partie pleinement visible et en
descendant jusqu' la racine, de dcouvrir l'exigence sociale d'o ils sont
sortis. Mais que le reste de la morale traduise un certain tat motionnel,
qu'on ne cde plus ici une pression mais un attrait, beaucoup hsiteront
l'admettre. La raison en est qu'on ne peut pas ici, le plus souvent, retrouver au
fond de soi l'motion originelle. Il y a des formules qui en sont le rsidu, et
qui se sont dposes dans ce qu'on pourrait appeler la conscience sociale au
fur et mesure que se consolidait, immanente cette motion, une conception
nouvelle de la vie ou mieux une certaine attitude vis--vis d'elle. Justement
parce que nous nous trouvons devant la cendre d'une motion teinte, et que la
puissance propulsive de cette motion venait du feu qu'elle portait en elle, les
formules qui sont restes seraient gnralement incapables d'branler notre
volont si les formules plus anciennes, exprimant des exigences fondamentales de la vie sociale, ne leur communiquaient par contagion quelque chose
de leur caractre obligatoire. Ces deux morales juxtaposes semblent maintenant n'en plus faire qu'une, la premire ayant prt la seconde un peu de ce
qu'elle a d'impratif et ayant d'ailleurs reu de celle-ci, en change, une signification moins troitement sociale, plus largement humaine. Mais remuons la
cendre ; nous trouverons des parties encore chaudes, et finalement jaillira
l'tincelle ; le feu pourra se rallumer, et, s'il se rallume, il gagnera de proche
en proche. Je veux dire que les maximes de cette seconde morale n'oprent
pas isolment, comme celles de la premire : ds que l'une d'elles, cessant
d'tre abstraite, se remplit de signification et acquiert la force d'agir, les autres
tendent en faire autant ; finalement toutes se rejoignent dans la chaude
motion qui les laissa jadis derrire elle et dans les hommes, redevenus
vivants, qui l'prouvrent. Fondateurs et rformateurs de religions, mystiques
et saints, hros obscurs de la vie morale que nous avons pu rencontrer sur
notre chemin et qui galent nos yeux les plus grands, tous sont l : entrans
par leur exemple, nous nous joignons eux comme une arme de conqurants. Ce sont des conqurants, en effet ; ils ont bris la rsistance de la nature
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
28
et hauss l'humanit des destines nouvelles. Ainsi, quand nous dissipons
les apparences pour toucher les ralits, quand nous faisons abstraction de la
forme commune que les deux morales, grce des changes rciproques, ont
prise dans la pense conceptuelle et dans le langage, nous trouvons aux deux
extrmits de cette morale unique la pression et l'aspiration : celle-l d'autant
plus parfaite qu'elle est plus impersonnelle, plus proche de ces forces naturelles qu'on appelle habitude et mme instinct, celle-ci d'autant plus puissante
qu'elle est plus visiblement souleve en nous par des personnes, et qu'elle
semble mieux triompher de la nature. Il est vrai que si l'on descendait jusqu'
la racine de la nature elle-mme, on s'apercevrait peut-tre que c'est la mme
force qui se manifeste directement, en tournant sur elle-mme, dans l'espce
humaine une fois constitue, et qui agit ensuite indirectement, par l'intermdiaire d'individualits privilgies, pour pousser l'humanit en avant.
Mais point n'est besoin de recourir une mtaphysique pour dterminer le
rapport de cette pression cette aspiration. Encore une fois, il y a une certaine
difficult comparer entre elles les deux morales parce qu'elles ne se
prsentent plus l'tat pur. La premire a pass l'autre quelque chose de sa
force de contrainte; la seconde a rpandu sur la premire quelque chose de son
parfum. Nous sommes en prsence d'une srie de gradations ou de dgradations, selon qu'on parcourt les prescriptions de la morale en commenant par
une extrmit ou par l'autre ; quant aux deux limites extrmes, elles ont plutt
un intrt thorique ; il n'arrive gure qu'elles soient rellement atteintes. Considrons cependant en elles-mmes, isolment, pression et aspiration. Immanente la premire est la reprsentation d'une socit qui ne vise qu' se
conserver : le mouvement circulaire o elle entrane avec elle les individus, se
produisant sur place, imite de loin, par l'intermdiaire de l'habitude, l'immobilit de l'instinct. Le sentiment qui caractriserait la conscience de cet
ensemble d'obligations pures, supposes toutes remplies, serait un tat de
bien-tre individuel et social comparable celui qui accompagne le fonctionnement normal de la vie. Il ressemblerait au plaisir plutt qu' la joie. Dans la
morale de l'aspiration, au contraire, est implicitement contenu le sentiment
d'un progrs. L'motion dont nous parlions est l'enthousiasme d'une marche en
avant, - enthousiasme par lequel cette morale s'est fait accepter de quelquesuns et s'est ensuite, travers eux, propage dans le monde. Progrs et
marche en avant se confondent d'ailleurs ici avec l'enthousiasme luimme. Pour en prendre conscience, il n'est pas ncessaire de se reprsenter un
terme que l'on vise ou une perfection dont on se rapproche. Il suffit que dans
la joie de l'enthousiasme il y ait plus que dans le plaisir du bien-tre, ce plaisir
n'impliquant pas cette joie, cette joie enveloppant et mme rsorbant en elle
ce plaisir. Cela, nous le sentons; et la certitude ainsi obtenue, bien loin d'tre
suspendue une mtaphysique, est ce qui donnera cette mtaphysique son
plus solide appui.
Mais avant cette mtaphysique, et beaucoup plus prs de l'immdiatement
prouv, sont les reprsentations simples qui jaillissent ici de l'motion au fur
et mesure qu'on s'appesantit sur elle. Nous parlions des fondateurs et
rformateurs de religions, des mystiques et des saints. coutons leur langage ;
il ne fait que traduire en reprsentations l'motion particulire d'une me qui
s'ouvre, rompant avec la nature qui l'enfermait la fois en elle. mme et dans
la cit.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
29
Ils disent d'abord que ce qu'ils prouvent est un sentiment de libration.
Bien-tre, plaisirs, richesse, tout ce qui retient le commun des hommes les
laisse indiffrents. A s'en dlivrer ils ressentent un soulagement, puis une
allgresse. Non pas que la nature ait eu tort de nous attacher par des liens
solides la vie qu'elle avait voulue pour nous. Mais il s'agit d'aller plus loin,
et les commodits dont on se trouve bien chez soi deviendraient des gnes,
elles tourneraient au bagage encombrant, s'il fallait les emporter en voyage.
Qu'une me ainsi mobilise soit plus encline sympathiser avec les autres
mes, et mme avec la nature entire, on pourrait s'en tonner si l'immobilit
relative de l'me, tournant en cercle dans une socit close, ne tenait prcisment ce que la nature a morcel l'humanit en individualits distinctes par
l'acte mme qui constitua l'espce humaine. Comme tout acte constitutif d'une
espce, celui-ci fut un arrt. En reprenant la marche en avant, on brise la
dcision de briser. Pour obtenir un effet complet, il faudrait, il est vrai,
entraner avec soi le reste des hommes. Mais si quelques-uns suivent, et si les
autres se persuadent qu'ils le feraient l'occasion, c'est dj beaucoup : il y a
ds lors, avec le commencement d'excution, l'esprance que le cercle finira
par tre rompu. En tout cas, nous ne saurions trop le rpter, ce n'est pas en
prchant l'amour du prochain qu'on l'obtient. Ce n'est pas en largissant des
sentiments plus troits qu'on embrassera l'humanit. Notre intelligence a beau
se persuader elle-mme que telle est la marche indique, les choses s'y
prennent autrement. Ce qui est simple au regard de notre entendement ne l'est
pas ncessairement pour notre volont. L o la logique dit qu'une certaine
voie serait la plus courte, l'exprience survient et trouve que dans cette
direction il n'y a pas de voie. La vrit est qu'il faut passer ici par l'hrosme
pour arriver l'amour. L'hrosme, d'ailleurs, ne se prche pas ; il n'a qu' se
montrer, et sa seule prsence pourra mettre d'autres hommes en mouvement.
C'est qu'il est, lui-mme, retour au mouvement, et qu'il mane d'une motion communicative comme toute motion - apparente l'acte crateur. La
religion exprime cette vrit sa manire en disant que c'est en Dieu que nous
aimons les autres hommes. Et les grands mystiques dclarent avoir le
sentiment d'un courant qui irait de leur me Dieu et redescendrait de Dieu au
genre humain.
Qu'on ne vienne pas parler d'obstacles matriels l'me ainsi are ! Elle
ne rpondra pas que l'obstacle doit tre tourn, ni qu'il peut tre forc : elle le
dclarera inexistant. De sa conviction morale on ne peut pas dire qu'elle
soulve des montagnes, car elle ne voit pas de montagne soulever. Tant que
vous raisonnerez sur l'obstacle, il restera o il est ; et tant que vous le regarderez, vous le dcomposerez en parties qu'il faudra surmonter une une; le
dtail en peut tre illimit ; rien ne dit que vous l'puiserez. Mais vous pouvez
rejeter l'ensemble, en bloc, si vous le niez. Ainsi procdait le philosophe qui
prouvait le mouvement en marchant ; son acte tait la ngation pure et simple
de l'effort, toujours recommencer et par consquent impuissant, que Znon
jugeait ncessaire pour franchir un un les points de l'intervalle. En
approfondissant ce nouvel aspect de la morale, on y trouverait le sentiment
d'une concidence, relle ou illusoire, avec l'effort gnrateur de la vie. Vu du
dehors, le travail de la vie se prte, dans chacune de ses oeuvres, une
analyse qui se poursuivrait sans fin ; jamais on n'aura achev de dcrire la
structure d'un oeil tel que le ntre. Mais ce que nous appelons un ensemble de
moyens employs n'est en ralit qu'une srie d'obstacles tombs ; l'acte de la
nature est simple, et la complexit infinie du mcanisme qu'elle parat avoir
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
30
construit pice pice pour obtenir la vision n'est que l'entrecroisement sans
fin des antagonismes qui se sont neutraliss les uns les autres pour laisser
passer, indivisible, l'exercice de la fonction. Telle, une main invisible qui
s'enfoncerait dans de la limaille de fer et dont l'acte simple apparatrait, si l'on
ne tenait compte que de ce qu'on voit, comme une inpuisable srie d'actions
et de ractions que les brins de limaille exerceraient les uns sur les autres pour
s'quilibrer rciproquement. Si tel est le contraste entre l'opration relle de la
vie et l'aspect qu'elle prend pour les sens et l'intelligence qui l'analysent, est-il
tonnant qu'une me qui ne connat plus d'obstacle matriel se sente, tort ou
raison, en concidence avec le principe mme de la vie ?
Quelque htrognit qu'on puisse trouver d'abord entre l'effet et la cause,
et bien qu'il y ait loin d'une rgle de conduite une affirmation sur le fond des
choses, c'est toujours dans un contact avec le principe gnrateur de l'espce
humaine qu'on s'est senti puiser la force d'aimer l'humanit. Je parle, bien
entendu, d'un amour qui absorbe et rchauffe l'me entire. Mais un amour
plus tide, attnu et intermittent, ne peut tre que le rayonnement de celui-l,
quand il n'est pas l'image, plus ple et plus froide encore, qui en est reste
dans l'intelligence ou qui s'est dpose dans le langage. La morale comprend
ainsi deux parties distinctes, dont l'une a sa raison d'tre dans la structure
originelle de la socit humaine, et dont l'autre trouve son explication dans le
principe explicatif de cette structure. Dans la premire, l'obligation reprsente
la pression que les lments de la socit exercent les uns sur les autres pour
maintenir la forme du tout, pression dont l'effet est prfigur en chacun de
nous par un systme d'habitudes qui vont pour ainsi dire au-devant d'elle : ce
mcanisme, dont chaque pice est une habitude mais dont l'ensemble est
comparable un instinct, a t prpar par la nature. Dans la seconde, il y a
encore obligation, si l'on veut, mais l'obligation est la force d'une aspiration
ou d'un lan, de l'lan mme qui a abouti l'espce humaine, la vie sociale,
un systme d'habitudes plus ou moins assimilable l'instinct : le principe de
propulsion intervient directement, et non plus par l'intermdiaire des mcanismes qu'il avait monts, auxquels il s'tait arrt provisoirement. Bref, pour
rsumer tout ce qui prcde, nous dirons que la nature, dposant l'espce
humaine le long du cours de l'volution, l'a voulue sociable, comme elle a
voulu les socits de fourmis et d'abeilles ; mais puisque l'intelligence tait l,
le maintien de la vie sociale devait tre confi un mcanisme quasi intelligent : intelligent, en ce que chaque pice pouvait en tre remodele par
l'intelligence humaine, instinctif cependant en ce que l'homme ne pouvait pas,
sans cesser d'tre un homme, rejeter l'ensemble des pices et ne plus accepter
un mcanisme conservateur. L'instinct cdait provisoirement la place un
systme d'habitudes, dont chacune devenait contingente, leur convergence
vers la conservation de la socit tant seule ncessaire, et cette ncessit
ramenant avec elle l'instinct. La ncessit du tout, sentie travers la
contingence des parties, est ce que nous appelons l'obligation morale en
gnral ; les parties ne sont d'ailleurs contingentes qu'aux yeux de la socit ;
pour l'individu, qui la socit inculque des habitudes, la partie est ncessaire
comme le tout. Maintenant, le mcanisme voulu par la nature tait simple,
comme les socits originellement constitues par elle. La nature avait-elle
prvu l'norme dveloppement et la complexit indfinie de socits comme
les ntres ? Entendons-nous d'abord sur le sens de la question. Nous n'affirmons pas que la nature ait proprement voulu ou prvu quoi que ce soit. Mais
nous avons le droit de procder comme le biologiste, qui parle d'une intention
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
31
de la nature toutes les fois qu'il assigne une fonction un organe : il exprime
simplement ainsi l'adquation de l'organe la fonction. L'humanit a beau
s'tre civilise, la socit a beau s'tre transforme, nous prtendons que les
tendances en quelque sorte organiques la vie sociale sont restes ce qu'elles
taient l'origine. Nous pouvons les retrouver, les observer. Le rsultat de
cette observation est net : c'est pour des socits simples et closes que la
structure morale, originelle et fondamentale de l'homme, est faite. Ces tendances organiques n'apparaissent pas clairement notre conscience, je le veux
bien. Elles n'en constituent pas moins ce qu'il y a de plus solide dans
l'obligation. Si complexe que soit devenue notre morale, bien qu'elle se soit
double de tendances qui ne sont pas de simples modifications des tendances
naturelles et qui ne vont pas dans la direction de la nature, c'est ces
tendances naturelles que nous aboutissons quand nous dsirons, de tout ce que
cette masse fluide contient d'obligation pure, obtenir un prcipit. Telle est
donc la premire moiti de la morale. L'autre n'entrait pas dans le plan de la
nature. Nous entendons par l que la nature avait prvu une certaine extension
de la vie sociale par l'intelligence, mais une extension limite. Elle ne pouvait
pas vouloir que cette extension allt jusqu' mettre en danger la structure
originelle. Nombreux sont d'ailleurs les cas o l'homme a tromp ainsi la
nature, si savante et pourtant si nave. La nature entendait srement que
l'homme procrt sans fin, comme tous les autres vivants ; elle a pris les
prcautions les plus minutieuses pour assurer la conservation de l'espce par
la multiplication des individus ; elle n'avait donc pas prvu, en nous donnant
l'intelligence, que celle-ci trouverait aussitt le moyen de couper l'acte sexuel
de ses consquences, et que l'homme pourrait s'abstenir de rcolter sans
renoncer au plaisir de semer. C'est dans un tout autre sens que l'homme
trompe la nature quand il prolonge la solidarit sociale en fraternit humaine ;
mais il la trompe encore, car les socits dont le dessin tait prform dans la
structure originelle de l'me humaine, et dont on peut apercevoir encore le
plan dans les tendances innes et fondamentales de l'homme actuel, exigeaient
que le groupe ft troitement uni, mais que de groupe groupe il y et
hostilit virtuelle : on devait tre toujours prt attaquer ou se dfendre.
Non pas, certes, que la nature ait voulu la guerre pour la guerre. Les grands
entraneurs de l'humanit, qui ont forc les barrires de la cit, semblent bien
s'tre replacs par l dans la direction de l'lan vital. Mais cet lan propre la
vie est fini comme elle. Tout le long de sa route il rencontre des obstacles, et
les espces successivement apparues sont les rsultantes de cette force et de
forces antagonistes : celle-l pousse en avant, celles-ci font qu'on tourne sur
place. L'homme, sortant des mains de la nature, tait un tre intelligent et
sociable, sa sociabilit tant calcule pour aboutir de petites socits, son
intelligence tant destine favoriser la vie individuelle et la vie du groupe.
Mais l'intelligence, se dilatant par son effort propre, a pris un dveloppement
inattendu. Elle a affranchi les hommes de servitudes auxquelles ils taient
condamns par les limitations de leur nature. Dans ces conditions, il n'tait
pas impossible certains d'entre eux, particulirement dous, de rouvrir ce qui
avait t clos et de faire au moins pour eux-mmes ce qu'il et t impossible
la nature de faire pour l'humanit. Leur exemple a fini par entraner les
autres, au moins en imagination. La volont a son gnie, comme la pense, et
le gnie dfie toute prvision. Par l'intermdiaire de ces volonts gniales
l'lan de vie qui traverse la matire obtient de celle-ci, pour l'avenir de
l'espce, des promesses dont il ne pouvait mme tre question quand l'espce
se constituait. En allant de la solidarit sociale la fraternit humaine, nous
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
32
rompons donc avec une certaine nature, mais non pas avec toute nature. On
pourrait dire, en dtournant de leur sens les expressions spinozistes, que c'est
pour revenir la Nature naturante que nous nous dtachons de la Nature
nature.
Entre la premire morale et la seconde il y a donc toute la distance du
repos au mouvement. La premire est cense immuable. Si elle change, elle
oublie aussitt qu'elle a chang ou n'avoue pas le changement. La forme
qu'elle prsente n'importe quel moment prtend tre la forme dfinitive.
Mais l'autre est une pousse, une exigence de mouvement ; elle est mobilit
en principe. C'est par l qu'elle prouverait - c'est mme par l seulement
qu'elle pourrait d'abord dfinir - sa supriorit. Donnez-vous la premire, vous
n'en ferez pas sortir la seconde, pas plus que d'une ou de plusieurs positions
d'un mobile vous ne tirerez du mouvement. Au contraire, le mouvement
enveloppe l'immobilit, chaque position traverse par le mobile tant conue
et mme perue comme un arrt virtuel. Mais point n'est besoin d'une
dmonstration en rgle : la supriorit est vcue avant d'tre reprsente, et ne
pourrait d'ailleurs tre ensuite dmontre si elle n'tait d'abord sentie. C'est
une diffrence de ton vital. Celui qui pratique rgulirement la morale de la
cit prouve ce sentiment de bien-tre, commun l'individu et la socit, qui
manifeste l'interfrence des rsistances matrielles les unes avec les autres.
Mais l'me qui s'ouvre, et aux yeux de laquelle les obstacles matriels
tombent, est toute la joie. Plaisir et bien-tre sont quelque chose, la joie est
davantage. Car elle n'tait pas contenue en eux, tandis qu'ils se retrouvent
virtuellement en elle. Ils sont, en effet, arrt ou pitinement sur place, tandis
qu'elle est marche en avant.
De l vient que la premire morale est relativement facile formuler, mais
non pas la seconde. Notre intelligence et notre langage portent en effet sur des
choses ; ils sont moins leur aise pour reprsenter des transitions ou des
progrs. La morale de l'vangile est essentiellement celle de l'me ouverte :
n'a-t-on pas eu raison de faire remarquer qu'elle frise le paradoxe, et mme la
contradiction, dans les plus prcises de ses recommandations ? Si la richesse
est un mal, ne nuirons-nous pas aux pauvres en leur abandonnant ce que nous
possdons ? Si celui qui a reu un soufflet tend l'autre joue, que devient la
justice, sans laquelle il n'y a pourtant pas de charit ? Mais le paradoxe tombe,
la contradiction s'vanouit, si l'on considre l'intention de ces maximes, qui
est d'induire un tat d'me. Ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour lui que le
riche doit faire abandon de sa richesse : heureux le pauvre en esprit! Ce qui
est beau, ce n'est pas d'tre priv, ni mme de se priver, c'est de ne pas sentir
la privation. L'acte par lequel l'me s'ouvre a pour effet d'largir et d'lever
la pure spiritualit une morale emprisonne et matrialise dans des formules :
celle-ci devient alors, par rapport l'autre, quelque chose comme un instantan pris sur un mouvement. Tel est le sens profond des oppositions qui se
succdent dans le Sermon sur la montagne : On vous a dit que... Et moi je
vous dis que... D'un ct le clos, de l'autre l'ouvert. La morale courante n'est
pas abolie ; mais elle se prsente comme un moment le long d'un progrs. On
ne renonce pas l'ancienne mthode; mais on l'intgre dans une mthode plus
gnrale, comme il arrive quand le dynamique rsorbe en lui le statique,
devenu un cas particulier. Il faudrait alors, en toute rigueur, une expression
directe du mouvement et de la tendance; mais si l'on veut encore - et il le faut
bien - les traduire dans la langue du statique et de l'immobile, on aura des
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
33
formules qui frleront la contradiction. Aussi comparerions-nous ce qu'il y a
d'impraticable dans certains prceptes vangliques ce que prsentrent
d'illogique les premires explications de la diffrentielle. De fait, entre la
morale antique et le christianisme on trouverait un rapport du mme genre que
celui de l'ancienne mathmatique la ntre.
La gomtrie des anciens a pu fournir des solutions particulires qui
taient comme des applications anticipes de nos mthodes gnrales. Mais
elle n'a pas dgag ces mthodes ; l'lan n'tait pas l, qui et fait sauter du
statique au dynamique. Du moins avait-on pouss aussi loin que possible
l'imitation du dynamique par le statique. Nous avons une impression de ce
genre quand nous confrontons la doctrine des stociens, par exemple, avec la
morale chrtienne. Ils se proclamaient citoyens du monde, et ils ajoutaient que
tous les hommes sont frres, tant issus du mme Dieu. C'taient presque les
mmes paroles ; mais elles ne trouvrent pas le mme cho, parce qu'elles
n'avaient pas t dites avec le mme accent. Les stociens ont donn de fort
beaux exemples. S'ils n'ont pas russi entraner l'humanit avec eux, c'est
que le stocisme est essentiellement une philosophie. Le philosophe qui
s'prend d'une doctrine aussi haute, et qui s'insre en elle, l'anime sans doute
en la pratiquant : tel, l'amour de Pygmalion insuffla la vie la statue une fois
sculpte. Mais il y a loin de l l'enthousiasme qui se propage d'me en me,
indfiniment, comme un incendie. Une telle motion pourra videmment s'expliciter en ides constitutives d'une doctrine, et mme en plusieurs doctrines
diffrentes qui n'auront d'autre ressemblance entre elles qu'une communaut
d'esprit ; mais elle prcde l'ide au lieu de la suivre. Pour trouver quelque
chose d'elle dans l'antiquit classique, ce n'est pas aux stociens qu'il faudrait
s'adresser, mais plutt celui qui fut l'inspirateur de toutes les grandes
philosophies de la Grce sans avoir apport de doctrine, sans avoir rien crit,
Socrate. Certes, Socrate met au-dessus de tout l'activit raisonnable, et plus
spcialement la fonction logique de l'esprit. L'ironie qu'il promne avec lui est
destine carter les opinions qui n'ont pas subi l'preuve de la rflexion et
leur faire honte, pour ainsi dire, en les mettant en contradiction avec ellesmmes. Le dialogue, tel qu'il l'entend, a donn naissance la dialectique
platonicienne et par suite la mthode philosophique, essentiellement rationnelle, que nous pratiquons encore. L'objet de ce dialogue est d'aboutir des
concepts qu'on enfermera dans des dfinitions ; ces concepts deviendront les
Ides platoniciennes ; et la thorie des ides, son tour, servira de type aux
constructions, elles aussi rationnelles par essence, de la mtaphysique traditionnelle. Socrate va plus loin encore; de la vertu mme il fait une science ; il
identifie la pratique du bien avec la connaissance qu'on en possde ; il prpare
ainsi la doctrine qui absorbera la vie morale dans l'exercice rationnel de la
pense. Jamais la raison n'aura t place plus haut. Voil du moins ce qui
frappe d'abord. Mais regardons de plus prs. Socrate enseigne parce que
l'oracle de Delphes a parl. Il a reu une mission. Il est pauvre, et il doit rester
pauvre. Il faut qu'il se mle au peuple, qu'il se fasse peuple, que son langage
rejoigne le parler populaire. Il n'crira rien, pour que sa pense se communique, vivante, des esprits qui la porteront d'autres esprits. Il est insensible
au froid et la faim, nullement ascte, mais libr du besoin et affranchi de
son corps. Un dmon l'accompagne, qui fait entendre sa voix quand un
avertissement est ncessaire. Il croit si bien ce signe dmonique qu'il
meurt plutt que de ne pas le suivre : s'il refuse de se dfendre devant le
tribunal populaire, s'il va au-devant de sa condamnation, c'est que le dmon
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
34
n'a rien dit pour l'en dtourner. Bref, sa mission est d'ordre religieux et
mystique, au sens o nous prenons aujourd'hui ces mots ; son enseignement,
si parfaitement rationnel, est suspendu quelque chose qui semble dpasser la
pure raison. Mais ne s'en aperoit-on pas son enseignement mme ? Si les
propos inspirs, en tout cas lyriques, qu'il tient en maint endroit des dialogues
de Platon n'taient pas de Socrate, mais de Platon lui-mme, si le langage du
matre avait toujours t celui que Xnophon lui prte, comprendrait-on
l'enthousiasme dont il enflamma ses disciples et qui traversa les ges ?
Stociens, picuriens, cyniques, tous les moralistes de la Grce drivent de
Socrate, - non pas seulement, comme on l'a toujours dit, parce qu'ils dveloppent dans ses diverses directions la doctrine du matre, mais encore et surtout
parce qu'ils lui empruntent l'attitude qu'il a cre et qui tait d'ailleurs si peu
conforme au gnie grec, l'attitude du Sage. Quand le philosophe, s'enfermant
dans sa sagesse, se dtache du commun des hommes, soit pour les enseigner,
soit pour leur servir de modle, soit simplement pour vaquer son travail de
perfectionnement intrieur, c'est Socrate vivant qui est l, Socrate agissant par
l'incomparable prestige de sa personne. Allons plus loin. On a dit qu'il avait
ramen la philosophie du ciel sur la terre. Mais comprendrait-on sa vie, et
surtout sa mort, si la conception de l'me que Platon lui prte dans le Phdon
n'avait pas t la sienne ? Plus gnralement, les mythes que nous trouvons
dans les dialogues de Platon et qui concernent l'me, son origine, son insertion
dans le corps, font-ils autre chose que noter en termes de pense platonicienne
une motion cratrice, l'motion immanente l'enseignement moral de
Socrate ? Les mythes, et l'tat d'me socratique par rapport auquel ils sont ce
que le programme explicatif est la symphonie, se sont conservs ct de la
dialectique platonicienne ; ils traversent en souterrain la mtaphysique
grecque et reparaissent l'air libre avec le noplatonisme alexandrin, avec
Ammonius peut-tre, en tout cas avec Plotin, qui se dclare continuateur de
Socrate. A l'me socratique ils ont fourni un corps de doctrine comparable
celui qu'anima l'esprit vanglique. Les deux mtaphysiques, en dpit de leur
ressemblance ou peut-tre cause d'elle, se livrrent bataille, avant que l'une
absorbt ce qu'il y avait de meilleur dans l'autre : pendant un temps le monde
put se demander s'il allait devenir chrtien ou no-platonicien. C'tait Socrate
qui tenait tte Jsus. Pour en rester Socrate, la question est de savoir ce
que ce gnie trs pratique et fait dans une autre socit et dans d'autres
circonstances, s'il n'avait pas t frapp par-dessus tout de ce qu'il y avait de
dangereux dans l'empirisme moral de son temps et dans les incohrences de la
dmocratie athnienne, s'il n'avait pas d aller au plus press en tablissant les
droits de la raison, s'il n'avait ainsi repouss l'intuition et l'inspiration
l'arrire-plan, et si le grec qu'il tait n'avait mat en lui l'oriental qui voulait
tre. Nous avons distingu l'me close et l'me ouverte : qui voudrait classer
Socrate parmi les mes closes ? L'ironie courait travers l'enseignement
socratique, et le lyrisme n'y faisait sans doute que des explosions rares ; mais,
dans la mesure o ces explosions ont livr passage un esprit nouveau, elles
ont t dcisives pour l'avenir de l'humanit.
Entre l'me close et l'me ouverte il y a l'me qui s'ouvre. Entre l'immobilit de l'homme assis, et le mouvement du mme homme qui court, il y a
son redressement, l'attitude qu'il prend quand il se lve. Bref, entre le statique
et le dynamique on observe en morale une transition. Cet tat intermdiaire
passerait inaperu si l'on prenait, au repos, l'lan ncessaire pour sauter tout
d'un coup au mouvement. Mais il frappe l'attention quand on s'y arrte, - signe
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
35
ordinaire d'une insuffisance d'lan. Disons la mme chose sous une autre
forme. Nous avons vu que le pur statique, en morale, serait de l'infraintellectuel, et le pur dynamique du supra-intellectuel. L'un a t voulu par la
nature, l'autre est un apport du gnie humain. Celui-l caractrise un ensemble
d'habitudes qui correspondent symtriquement, chez l'homme, certains
instincts de l'animal ; il est moins qu'intelligence. Celui-ci est aspiration,
intuition et motion ; il s'analysera en ides qui en seront des notations
intellectuelles et dont le dtail se poursuivra indfiniment ; il contient donc,
comme une unit qui envelopperait et dpasserait une multiplicit incapable
de lui quivaloir, toute l'intellectualit qu'on voudra ; il est plus qu'intelligence. Entre les deux, il y a l'intelligence mme. L ft demeure l'me
humaine, si elle s'tait lance de l'un sans aller jusqu' l'autre. Elle et
domin la morale de l'me close ; elle n'et pas encore atteint ou plutt cr
celle de l'me ouverte. Son attitude, effet d'un redressement, lui aurait fait
toucher le plan de l'intellectualit. Par rapport ce qu'elle viendrait de quitter,
une telle me pratiquerait l'indiffrence ou l'insensibilit ; elle serait dans l'
ataraxie ou l' apathie des picuriens et des stociens. Par rapport ce
qu'elle trouve de positif en elle, si son dtachement de l'ancien veut tre un
attachement du nouveau, sa vie serait contemplation ; elle se conformerait
l'idal de Platon et d'Aristote. Par quelque ct qu'on la considre, l'attitude
sera droite, fire, vraiment digne d'admiration et rserve d'ailleurs une lite.
Des philosophies parties de principes trs diffrents pourront concider en
elle. La raison en est qu'un seul chemin mne de l'action confine dans un
cercle l'action se dployant dans l'espace libre, de la rptition la cration,
de l'infra-intellectuel au supra-intellectuel. Qui s'arrte entre les deux est
ncessairement dans la gion de la pure contemplation, et pratique en tout cas
naturellement, ne s'en tenant plus l'un et n'tant pas all jusqu' l'autre, cette
demi-vertu qu'est le dtachement.
Nous parlons de l'intelligence pure, se renfermant en elle-mme et jugeant
que l'objet de la vie est ce que les anciens appelaient science ou contemplation. Nous parlons, en un mot, de ce qui caractrise principalement la
morale des philosophes grecs. Mais il ne s'agirait plus de philosophie grecque
ou orientale, nous aurions affaire la morale de tout le monde, si nous
considrions l'intelligence en tant que simplement laboratrice ou coordinatrice des matriaux, les uns infra-intellectuels et les autres supra-intellectuels, dont il a t question dans le prsent chapitre. Pour dterminer l'essence
mme du devoir, nous avons en effet dgag les deux forces qui agissent sur
nous, impulsion d'une part et attraction de l'autre. Il le fallait, et c'est pour ne
l'avoir pas fait, c'est pour s'en tre tenue l'intellectualit qui recouvre
aujourd'hui le tout, que la philosophie n'a gure russi, semble-t-il, expliquer
comment une morale peut avoir prise sur les mes. Mais notre expos se
condamnait ainsi, comme nous le faisions pressentir, rester schmatique. Ce
qui est aspiration tend se consolider en prenant la forme de l'obligation
stricte. Ce qui est obligation stricte tend grossir et s'largir en englobant
l'aspiration. Pression et aspiration se donnent pour cela rendez-vous dans la
rgion de la pense o s'laborent les concepts. Il en rsulte des reprsentations dont beaucoup sont mixtes, runissant ensemble ce qui est cause de
pression et ce qui est objet d'aspiration. Mais il en rsulte aussi que nous
perdons de vue la pression et l'aspiration pures, agissant effectivement sur
notre volont ; nous ne voyons plus que le concept o sont venus se fondre les
deux objets distincts auxquels elles taient respectivement attaches. C'est ce
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
36
concept qui exercerait une action sur nous. Erreur qui explique l'chec des
morales proprement intellectualistes, c'est--dire, en somme, de la plupart des
thories philosophiques du devoir. Non pas, certes, qu'une ide pure soit sans
influence sur notre volont. Mais cette influence ne s'exercerait avec efficacit
que si elle pouvait tre seule. Elle rsiste difficilement des influences antagonistes, ou, si elle en triomphe, c'est que reparaissent dans leur individualit
et leur indpendance, dployant alors l'intgralit de leur force, la pression et
l'aspiration qui avaient renonc chacune leur action propre en se faisant
reprsenter ensemble par une ide.
Longue serait la parenthse qu'il faudrait ouvrir si l'on voulait faire la part
des deux forces, l'une sociale et l'autre supra-sociale, l'une d'impulsion et
l'autre d'attraction, qui donnent leur efficace aux mobiles moraux. Un honnte
homme dira par exemple qu'il agit par respect de soi, par sentiment de la
dignit humaine. Il ne s'exprimerait pas ainsi, videmment, s'il ne commenait
par se scinder en deux personnalits, celle qu'il serait s'il se laissait aller et
celle o sa volont le hausse : le moi qui respecte n'est pas le mme que le
moi respect. Quel est donc ce dernier moi ? en quoi consiste sa dignit ? d'o
vient le respect qu'il inspire ? Laissons de ct l'analyse du respect, o nous
trouverions surtout un besoin de s'effacer, l'attitude de l'apprenti devant le
matre ou plutt, pour parler le langage aristotlicien, de l'accident devant
l'essence. Resterait alors dfinir le moi suprieur devant lequel la personnalit moyenne s'incline. Il n'est pas douteux que ce soit d'abord le moi
social , intrieur chacun, dont nous avons dj dit un mot. Si l'on admet, ne
ft-ce que thoriquement, une mentalit primitive , on y verra le respect de
soi concider avec le sentiment d'une telle solidarit entre l'individu et le
groupe que le groupe reste prsent l'individu isol, le surveille, l'encourage
ou le menace, exige enfin d'tre consult et obi : derrire la socit ellemme il y a des puissances surnaturelles, dont le groupe dpend, et qui rendent la socit responsable des actes de l'individu; la pression du moi social
s'exerce avec toutes ces nergies accumules. L'individu n'obit d'ailleurs pas
seulement par habitude de la discipline ou par crainte du chtiment : le groupe
auquel il appartient se met ncessairement au-dessus des autres, ne ft-ce que
pour exalter son courage dans la bataille, et la conscience de cette supriorit
de force lui assure lui-mme une force plus grande, avec toutes les jouissances de l'orgueil. On s'en convaincra en considrant une mentalit dj plus
volue . Qu'on songe ce qu'il entrait de fiert, en mme temps que
d'nergie morale dans le Civis sum romanus : le respect de soi, chez un
citoyen romain, devait se confondre avec ce que nous appellerions aujourd'hui
son nationalisme. Mais point n'est besoin d'un recours l'histoire ou a la
prhistoire pour voir le respect de soi concider avec l'amour-propre du
groupe. Il suffit d'observer ce qui se passe sous nos yeux dans les petites
socits qui se constituent au sein de la grande, quand des hommes se
trouvent rapprochs les uns des autres par quelque marque distinctive qui
souligne une supriorit relle ou apparente, et qui les met part. Au respect
de soi que professe tout homme en tant qu'homme se joint alors un respect
additionnel, celui du moi qui est simplement homme pour un moi minent
entre les hommes ; tous les membres du groupe se tiennent et s'imposent
ainsi une tenue ; on voit natre un sentiment de l'honneur qui ne fait
qu'un avec l'esprit de corps. Telles sont les premires composantes du respect
de soi. Envisag de ce ct, que nous ne pouvons isoler aujourd'hui que par un
effort d'abstraction, il oblige par tout ce qu'il apporte avec lui de pression
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
37
sociale. Maintenant, l'impulsion deviendrait manifestement attraction si le
respect de soi tait celui d'une personnalit admire et vnre dont on
porterait en soi l'image et avec laquelle on aspirerait se confondre, comme la
copie avec le modle. Il n'en est pas ainsi en fait, car l'expression a beau
n'voquer que des ides de repliement sur soi-mme, le respect de soi n'en
reste pas moins, au terme de son volution comme l'origine, un sentiment
social. Mais les grandes figures morales qui ont marqu dans l'histoire se
donnent la main par-dessus les sicles, par-dessus nos cits humaines :
ensemble elles composent une cit divine o elles nous invitent entrer. Nous
pouvons ne pas entendre distinctement leur voix ; l'appel n'en est pas moins
lanc ; quelque chose y rpond au fond de notre me ; de la socit relle dont
nous sommes nous nous transportons par la pense la socit idale; vers
elle monte notre hommage quand nous nous inclinons devant la dignit
humaine en nous, quand nous dclarons agir par respect de nous-mmes. Il est
vrai que l'action exerce sur nous par des personnes tend ainsi devenir
impersonnelle. Et ce caractre impersonnel s'accentue encore nos yeux
quand les moralistes nous exposent que c'est la raison, prsente en chacun de
nous, qui fait la dignit de l'homme. Il faudrait pourtant s'entendre sur ce
point. Que la raison soit la marque distinctive de l'homme, personne ne le
contestera. Qu'elle ait une valeur minente, au sens o une belle oeuvre d'art a
de la valeur, on l'accordera galement. Mais il faut expliquer pourquoi elle
peut commander absolument, et comment elle se fait alors obir. La raison ne
peut qu'allguer des raisons, auxquelles il semble toujours loisible d'opposer
d'autres raisons. Ne disons donc pas seulement que la raison, prsente en
chacun de nous, s'impose notre respect et obtient notre obissance en vertu
de sa valeur minente. Ajoutons qu'il y a derrire elle les hommes qui ont
rendu l'humanit divine, et qui ont imprim ainsi un caractre divin la
raison, attribut essentiel de l'humanit. Ce sont eux qui nous attirent dans une
socit idale, en mme temps que nous cdons la pression de la socit
relle.
Toutes les notions morales se compntrent, mais il n'en est pas de plus
instructive que celle de justice, d'abord parce qu'elle englobe la plupart des
autres, ensuite parce qu'elle se traduit, malgr sa plus grande richesse, par des
formules plus simples, enfin et surtout parce qu'on y voit s'emboter l'une dans
l'autre les deux formes de l'obligation. La justice a toujours voqu des ides
d'galit, de proportion, de compensation. Pensare, d'o drivent compensation et rcompense , a le sens de peser; la justice tait reprsente avec
une balance. quit signifie galit. Rgle et rglement, rectitude et rgularit,
sont des mots qui dsignent la ligne droite. Ces rfrences l'arithmtique et
la gomtrie sont caractristiques de la justice travers le cours de son
histoire. La notion a d se dessiner dj avec prcision dans les changes. Si
rudimentaire que soit une socit, on y pratique le troc ; et l'on ne peut le
pratiquer sans s'tre demand si les deux objets changs sont bien de mme
valeur, c'est--dire changeables contre un mme troisime. Que cette galit
de valeur soit rige en rgle, que la rgle s'insre dans les usages du groupe,
que le tout de l'obligation , comme nous disions, vienne ainsi se poser sur
elle : voil dj la justice sous sa forme prcise, avec son caractre imprieux
et les ides d'galit et de rciprocit qui s'attachent elle. - Mais elle ne
s'appliquera pas seulement aux changes de choses. Graduellement elle s'tendra des relations entre personnes, sans toutefois pouvoir, de longtemps, se
dtacher de toute considration de choses et d'change. Elle consistera surtout
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
38
alors rgulariser des impulsions naturelles en y introduisant l'ide d'une
rciprocit non moins naturelle, par exemple l'attente d'un dommage quivalent celui qu'on aura pu causer. Dans les socits primitives, les attentats
contre les personnes n'intressent la communaut qu'exceptionnellement,
quand l'acte accompli peut lui nuire elle-mme en attirant sur elle la colre
des dieux. La personne lse, ou sa famille, n'a donc alors qu' suivre son
instinct, ragir selon la nature, se venger ; et les reprsailles pourraient tre
hors de proportion avec l'offense si cet change de mauvais procds
n'apparaissait pas comme vaguement soumis la rgle gnrale des changes.
Il est vrai que la querelle risquerait de s'terniser, la vendetta se poursuivrait sans fin entre les deux familles, si l'une d'elles ne se dcidait accepter
un ddommagement pcuniaire : alors se dgagera nettement l'ide de compensation, dj implique dans celles d'change et de rciprocit. - Que la
socit se charge maintenant de svir elle-mme, de rprimer les actes de
violence quels qu'ils soient, on dira que c'est elle qui exerce la justice, si l'on
appelait dj de ce nom la rgle laquelle se rfraient, pour mettre fin leurs
diffrends, les individus ou les familles. Elle mesurera d'ailleurs la peine la
gravit de l'offense, puisque, sans cela, on n'aurait aucun intrt s'arrter
quand on commence mal faire ; on ne courrait pas plus de risque aller
jusqu'au bout. Oeil pour oeil, dent pour dent, le dommage subi devra toujours
tre gal au dommage caus. - Mais un oeil vaut-il toujours un oeil, une dent
toujours une dent ? Il faut tenir compte de la qualit comme de la quantit : la
loi du talion ne s'appliquera qu' l'intrieur d'une classe ; le mme dommage
subi, la mme offense reue, appellera une compensation plus forte ou rclamera une peine plus grave si la victime appartenait une classe plus haute.
Bref, l'galit peut porter sur un rapport et devenir une proportion. La justice a
donc beau embrasser une plus grande varit de choses, elle se dfinit de la
mme manire. - Elle ne changera pas davantage de formule, dans un tat de
civilisation plus avanc, quand elle s'tendra aux relations entre gouvernants
et gouverns et plus gnralement entre catgories sociales : dans une
situation de fait elle introduira des considrations d'galit ou de proportion
qui en feront quelque chose de mathmatiquement dfini et, par l mme,
d'apparemment dfinitif. Il n'est pas douteux, en effet, que la force n'ait t
l'origine de la division des anciennes socits en classes subordonnes les
unes aux autres. Mais une subordination habituelle finit par sembler naturelle,
et elle se cherche elle-mme une explication : si la classe infrieure a
accept sa situation pendant assez longtemps, elle pourra y consentir encore
quand elle sera devenue virtuellement la plus forte, parce qu'elle attribuera
aux dirigeants une supriorit de valeur. Cette supriorit sera d'ailleurs relle
s'ils ont profit des facilits qu'ils se trouvaient avoir pour se perfectionner
intellectuellement et moralement ; mais elle pourra aussi bien n'tre qu'une
apparence soigneusement entretenue. Quoi qu'il en soit, relle ou apparente,
elle n'aura qu' durer pour paratre congnitale : il faut bien qu'il y ait
supriorit inne, se dit-on, puisqu'il y a privilge hrditaire. La nature, qui a
voulu des socits disciplines, a prdispos l'homme cette illusion. Platon
la partageait, au moins pour sa rpublique idale. Si l'on entend ainsi la
hirarchie des classes, charges et avantages sont traits comme une espce de
masse commune qui serait rpartie ensuite entre les individus selon leur
valeur, et par consquent selon les services qu'ils rendent : la justice conserve
sa balance ; elle mesure et proportionne. - De cette justice qui peut ne pas
s'exprimer en termes utilitaires, mais qui n'en reste pas moins fidle a ses
origines mercantiles, comment passer celle qui n'implique ni changes ni
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
39
services, tant l'affirmation pure et simple du droit inviolable, et de l'incommensurabilit de la personne avec toutes les valeurs ? Avant de rpondre
cette question, admirons la vertu magique du langage, je veux dire le pouvoir
qu'un mot confre une ide nouvelle, quand il s'tend elle aprs s'tre
appliqu un objet prexistant, de modifier celui-ci et d'influencer le pass
rtroactivement. De quelque manire qu'on se reprsente la transition de la
justice relative la justice absolue, qu'elle se soit faite en plusieurs fois ou
tout d'un coup, il y a eu cration. Quelque chose est survenu qui aurait pu ne
pas tre, qui n'aurait pas t sans certaines circonstances, sans certains hommes, sans un certain homme peut-tre. Mais au lieu de penser du nouveau,
qui s'est empar de l'ancien pour l'englober dans un tout imprvisible, nous
aimons mieux envisager l'ancien comme une partie de ce tout, lequel aurait
alors virtuellement prexist : les conceptions de la justice qui se sont succd
dans des socits anciennes n'auraient donc t que des visions partielles,
incompltes, d'une justice intgrale qui serait prcisment la ntre. Inutile
d'analyser en dtail ce cas particulier d'une illusion trs gnrale, peu remarque des philosophes, qui a vici bon nombre de doctrines mtaphysiques et
qui pose la thorie de la connaissance des problmes insolubles. Disons
seulement qu'elle se rattache notre habitude de considrer tout mouvement
en avant comme le rtrcissement progressif de la distance entre le point de
dpart (qui est effectivement donn), et le point d'arrive, qui n'existe comme
station que lorsque le mobile a choisi de s'y arrter. Parce qu'il peut toujours
tre envisage ainsi quand il a atteint son terme, il ne s'ensuit pas que le
mouvement ait consist se rapprocher de ce terme : un intervalle dont il n'y
a encore qu'une extrmit ne peut pas diminuer peu peu puisqu'il n'est pas
encore intervalle; il aura diminu peu peu quand le mobile aura cre par son
arrt rel ou virtuel une autre extrmit et que nous le considrerons rtrospectivement, ou mme simplement quand nous suivrons le mouvement dans
son progrs en le reconstituant par avance de cette manire, reculons. Mais
c'est de quoi nous ne nous rendons pas compte, le plus souvent : nous mettons
dans les choses mmes, sous forme d'une prexistence du possible dans le
rel, cette prvision rtrospective. L'illusion fait le fond de maint problme
philosophique, dont la Dichotomie de Znon a fourni le modle. Et c'est elle
que nous retrouvons en morale, quand les formes de plus en plus larges de la
justice relative sont dfinies comme des approximations croissantes de la
justice absolue. Tout au plus devrions-nous dire qu'une fois celle-ci pose,
celles-l peuvent tre considres comme autant de stations le long d'une
route qui, trace rtrospectivement par nous, conduirait elle. Encore
faudrait-il ajouter qu'il n'y eut pas acheminement graduel, mais, un certain
moment, saut brusque. - Il serait intressant de dterminer le point prcis o
ce saltus se produisit. Et il serait non moins instructif de chercher comment,
une fois conue, sous une forme d'ailleurs vague, la justice absolue resta si
longtemps l'tat d'idal respect, qu'il n'tait mme pas question de raliser.
Disons seulement, en ce qui concerne le premier point, que les antiques
ingalits de classe, primitivement imposes sans doute par la force, acceptes
ensuite comme des ingalits de valeur et de services rendus, sont de plus en
plus soumises la critique de la classe infrieure : les dirigeants valent
d'ailleurs de moins en moins, parce que, trop srs d'eux-mmes, ils se relchent de la tension intrieure laquelle ils avaient demand une plus grande
force d'intelligence et de volont, et qui avait consolid leur domination. Ils se
maintiendraient pourtant s'ils restaient unis; mais, en raison mme de leur
tendance affirmer leur individualit, il se trouvera un jour ou l'autre parmi
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
40
eux des ambitieux qui prtendront tre les matres et qui chercheront un appui
dans la classe infrieure, surtout si celle-ci a dj quelque part aux affaires :
plus de supriorit native, alors, chez celui qui appartient la classe suprieure ; le charme est rompu. C'est ainsi que les aristocraties tendent se
perdre dans la dmocratie, simplement parce que l'ingalit politique est
chose instable, comme le sera d'ailleurs l'galit politique une fois ralise si
elle n'est qu'un fait, si elle admet par consquent des exceptions, si par
exemple elle tolre dans la cit l'esclavage. - Mais il y a loin de ces quilibres
mcaniquement atteints, toujours provisoires comme celui de la balance aux
mains de la justice antique, une justice telle que la ntre, celle des droits
de l'homme , qui n'voque plus des ides de relation ou de mesure, mais au
contraire d'incommensurabilit et d'absolu. Cette justice ne comporterait une
reprsentation complte qu' l'infini , comme disent les mathmaticiens ;
elle ne se formule prcisment et catgoriquement un moment dtermin,
que par des interdictions ; mais, dans ce qu'elle a de positif, elle procde par
des crations successives, dont chacune est une ralisation plus complte de la
personnalit, et par consquent de l'humanit. Cette ralisation n'est possible
que par l'intermdiaire des lois ; elle implique le consentement de la socit.
En vain d'ailleurs on prtendrait qu'elle se fait d'elle-mme, peu a peu, en
vertu de l'tat d'me de la socit une certaine priode de son histoire. C'est
un bond en avant, qui ne s'excute que si la socit s'est dcide tenter une
exprience ; il faut pour cela qu'elle se soit laiss convaincre ou tout au moins
branler; et le branle a toujours t donn par quelqu'un. En vain on allguera
que ce bond en avant ne suppose derrire lui aucun effort crateur, qu'il n'y a
pas ici une invention comparable celle de l'artiste. Ce serait oublier que la
plupart des grandes rformes accomplies ont paru d'abord irralisables, et
qu'elles l'taient en effet. Elles ne pouvaient tre ralises que dans une
socit dont l'tat d'me ft dj celui qu'elles devaient induire par leur
ralisation ; et il y avait l un cercle dont on ne serait pas sorti si une ou
plusieurs mes privilgies, ayant dilat en elles l'me sociale, n'avaient bris
le cercle en entranant la socit derrire elles. Or, c'est le miracle mme de la
cration artistique. Une uvre gniale, qui commence par dconcerter, pourra
crer peu peu par sa seule prsence une conception de l'art et une atmosphre artistique qui permettront de la comprendre ; elle deviendra alors
rtrospectivement gniale : sinon, elle serait reste ce qu'elle tait au dbut,
simplement dconcertante. Dans une spculation financire, c'est le succs qui
fait que l'ide avait t bonne. Il y a quelque chose du mme genre dans la
cration artistique, avec cette diffrence que le succs, s'il finit par venir
luvre qui avait d'abord choqu, tient une transformation du got publie
opre par luvre mme ; celle-ci tait donc force en mme temps que
matire ; elle a imprim un lan que l'artiste lui avait communique ou plutt
qui est celui mme de l'artiste, invisible et prsent en elle. On en dirait autant
de l'invention morale, et plus spcialement des crations successives qui
enrichissent de plus en plus l'ide de justice. Elles portent surtout sur la
matire de la justice, mais elles en modifient aussi bien la forme. - Pour
commencer par celle-ci, disons que la justice est toujours apparue comme
obligatoire, mais que pendant longtemps ce fut une obligation comme les
autres. Elle rpondait, comme les autres, une ncessit sociale ; et c'tait la
pression de la socit sur l'individu qui la rendait obligatoire. Dans ces
conditions, une injustice n'tait ni plus ni moins choquante qu'une autre
infraction la rgle. Il n'y avait pas de justice pour les esclaves, ou c'tait une
justice relative, presque facultative. Le salut du peuple n'tait pas seulement la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
41
loi suprme, comme il l'est d'ailleurs rest ; il tait en outre proclam tel, alors
que nous n'oserions plus aujourd'hui riger en principe qu'il justifie l'injustice,
mme si nous acceptons de ce principe telle ou telle consquence.
Consultons-nous sur ce point; posons-nous la fameuse question : que
ferions-nous si nous apprenions que pour le salut du peuple, pour l'existence
mme de l'humanit, il y a quelque part un homme, un innocent, qui est
condamn subir des tortures ternelles ? . Nous y consentirions peut-tre
s'il tait entendu qu'un philtre magique nous le fera oublier, et que nous n'en
saurons jamais plus rien ; mais s'il fallait le savoir, y penser, nous dire que cet
homme est soumis des supplices atroces pour que nous puissions exister,
que c'est l une condition fondamentale de l'existence en gnral, ah non !
plutt accepter que plus rien n'existe ! plutt laisser sauter la plante ! Que
s'est-il donc pass ? Comment la justice a-t-elle merg de la vie sociale,
laquelle elle tait vaguement intrieure, pour planer au-dessus d'elle et plus
haut que tout, catgorique et transcendante ? Rappelons-nous le ton et l'accent
des prophtes d'Isral. C'est leur voix mme que nous entendons quand une
grande injustice a t commise et admise. Du fond des sicles ils lvent leur
protestation. Certes, la justice s'est singulirement largie depuis eux. Celle
qu'ils prchaient concernait avant tout Isral ; leur indignation contre l'injustice tait la colre mme de Jahveh contre son peuple dsobissant ou contre
les ennemis de ce peuple lu. Si tel d'entre eux, comme Isae, a pu penser
une justice universelle, c'est parce qu'Isral, distingu par Dieu des autres
peuples, li Dieu par un contrat, s'levait si haut au-dessus du reste de
l'humanit que tt ou tard il serait pris pour modle. Du moins ont-ils donn
la justice le caractre violemment imprieux qu'elle a gard, qu'elle a imprim
depuis une matire indfiniment agrandie. - Mais ces agrandissements non
plus ne se sont pas faits tout seuls. Sur chacun d'eux l'historien suffisamment
renseign mettrait un nom propre. Chacun fut une cration, et la porte restera
toujours ouverte a des crations nouvelles. Le progrs qui fut dcisif pour la
matire de la justice, comme le prophtisme l'avait t pour la forme, consista
dans la substitution d'une rpublique universelle, comprenant tous les hommes, celle qui s'arrtait aux frontires de la cit, et qui s'en tenait dans la cit
elle-mme aux hommes libres. Tout le reste est venu de l, car si la porte est
reste ouverte des crations nouvelles, et le restera probablement toujours,
encore fallait-il qu'elle s'ouvrt. Il ne nous parat pas douteux que ce second
progrs, le passage du clos l'ouvert, soit d au christianisme, comme le
premier l'avait t au prophtisme juif. Aurait-il pu s'accomplir par la philosophie pure ? Rien n'est plus instructif que de voir comment les philosophes
l'ont frl, touch, et pourtant manque. Laissons de ct Platon, qui certainement comprend parmi les Ides suprasensibles celle de l'homme : ne
s'ensuivait-il pas que tous les hommes taient de mme essence ? De l
l'ide que tous avaient une gale valeur en tant qu'hommes, et que la communaut d'essence leur confrait les mmes droits fondamentaux, il n'y avait
qu'un pas. Mais le pas ne fut pas franchi. Il et fallu condamner l'esclavage,
renoncer l'ide grecque que les trangers, tant des barbares, ne pouvaient
revendiquer aucun droit. tait-ce d'ailleurs une ide proprement grecque ?
Nous la trouvons l'tat implicite partout o le christianisme n'a pas pntr,
chez les modernes comme chez les anciens. En Chine, par exemple, ont surgi
des doctrines morales trs leves, mais qui ne se sont pas soucies de
lgifrer pour l'humanit ; sans le dire, elles ne s'intressent en fait qu' la
communaut chinoise. Toutefois, avant le christianisme, il y eut le stocisme :
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
42
des philosophes proclamrent que tous les hommes sont frres, et que le sage
est citoyen du monde. Mais ces formules taient celles d'un idal conu, et
conu peut-tre comme irralisable. Nous ne voyons pas qu'aucun des grands
stociens, mme celui qui fut empereur, ait jug possible d'abaisser la barrire
entre l'homme libre et l'esclave, entre le citoyen romain et le barbare. Il fallut
attendre jusqu'au christianisme pour que l'ide de fraternit universelle,
laquelle implique l'galit des droits et l'inviolabilit de la personne, devnt
agissante. On dira que l'action fut bien lente : dix-huit sicles s'coulrent, en
effet, avant que les Droits de l'homme fussent proclams par les puritains
d'Amrique, bientt suivis par les hommes de la Rvolution franaise. Elle
n'en avait pas moins commenc avec l'enseignement de l'vangile, pour se
continuer indfiniment : autre chose est un idal simplement prsent aux
hommes par des sages dignes d'admiration, autre chose celui qui fut lanc
travers le monde dans un message charg d'amour, qui appelait l'amour. A
vrai dire, il ne s'agissait plus ici d'une sagesse dfinie, tout entire formulable
en maximes. On indiquait plutt une direction, on apportait une mthode ;
tout au plus dsignait-on une fin qui ne serait que provisoire et qui exigeait
par consquent un effort sans cesse renouvel. Cet effort devait d'ailleurs
ncessairement tre, chez quelques-uns au moins, un effort de cration. La
mthode consistait supposer possible ce qui est effectivement impossible
dans une socit donne, a se reprsenter ce qui en rsulterait pour l'me
sociale, et induire alors quelque chose de cet tat d'me par la propagande et
par l'exemple . l'effet, une fois obtenu, complterait rtroactivement sa cause ;
des sentiments nouveaux, d'ailleurs vanouissants, susciteraient la lgislation
nouvelle qui semblait ncessaire leur apparition et qui servirait alors les
consolider. L'ide moderne de justice a progress ainsi par une srie de
crations individuelles qui ont russi, par des efforts multiples anims d'un
mme lan. - L'antiquit classique n'avait pas connu la propagande ; sa justice
avait l'impassibilit sereine des dieux olympiens. Besoin de s'largir, ardeur
se propager, lan, mouvement, tout cela est d'origine judo-chrtienne. Mais,
parce que l'on continuait employer le mme mot, on a trop cru qu'il s'agissait
de la mme chose. Nous ne saurions trop le rpter : des crations successives, individuelles et contingentes, seront gnralement classes sous la
mme rubrique, subsumes la mme notion et appeles du mme nom, si
chacune a occasionn la suivante et si elles apparaissent aprs coup comme se
continuant les unes les autres. Allons plus loin. Le nom ne s'appliquera pas
seulement aux termes dj existants de la srie ainsi constitue. Anticipant sur
l'avenir, il dsignera la srie entire, on le placera au bout, que dis-je ?
l'infini ; comme il est fait depuis longtemps, on supposera galement faite,
depuis aussi longtemps et mme de toute ternit, la notion pourtant ouverte
et de contenu indtermin qu'il reprsente ; chacun des progrs acquis serait
alors autant de pris sur cette entit prexistante ; le rel rongerait l'idal,
s'incorporant par morceaux le tout de la justice ternelle. - Et cela n'est pas
seulement vrai de l'ide de justice, mais encore de celles qui lui sont
coordonnes, galit et libert par exemple. On dfinit volontiers le progrs de
la justice par une marche la libert et l'galit. La dfinition est inattaquable, mais que tirera-t-on d'elle ? Elle vaut pour le pass ; il est rare qu'elle
puisse orienter notre choix pour l'avenir. Prenons la libert, par exemple. On
dit couramment que l'individu a droit toute libert qui ne lse pas la libert
d'autrui. Mais l'octroi d'une libert nouvelle, qui aurait pour consquence un
empitement de toutes les liberts les unes sur les autres dans la socit
actuelle, pourrait produire l'effet contraire dans une socit dont cette rforme
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
43
aurait modifi les sentiments et les murs. De sorte qu'il est souvent impossible de dire a priori quelle est la dose de libert qu'on peut concder
l'individu sans dommage pour la libert de ses semblables : quand la quantit
change, ce n'est plus la mme qualit. D'autre part, l'galit ne s'obtient gure
qu'aux dpens de la libert, de sorte qu'il faudrait commencer par se demander
quelle est celle des deux qui est prfrable l'autre. Mais cette question ne
comporte aucune rponse gnrale ; car le sacrifice de telle ou telle libert, s'il
est librement consenti par l'ensemble des citoyens, est encore de la libert ; et
surtout la libert qui reste pourra tre d'une qualit suprieure si la rforme
accomplie dans le sens de l'galit a donn une socit o l'on respire mieux,
o l'on prouve plus de joie agir. Quoi qu'on fasse, il faudra toujours revenir
la conception de crateurs moraux, qui se reprsentent par la pense une
nouvelle atmosphre sociale, un milieu dans lequel il ferait meilleur vivre, je
veux dire une socit telle que, si les hommes en faisaient l'exprience, ils ne
voudraient pas revenir leur ancien tat. Ainsi seulement se dfinira le
progrs moral ; mais on ne peut le dfinir qu'aprs coup, quand une nature
morale privilgie a cr un sentiment nouveau, pareil une nouvelle musique, et qu'il l'a communiqu aux hommes en lui imprimant son propre lan.
Qu'on rflchisse ainsi la libert, l' galit , au respect du droit ,
on verra qu'il n'y a pas une simple diffrence de degr, mais une diffrence
radicale de nature, entre les deux ides de justice que nous avons distingues,
l'une close, l'autre ouverte. Car la justice relativement stable, close, qui traduit
l'quilibre automatique d'une socit sortant des mains de la nature, s'exprime
dans des usages auxquels s'attache le tout de l'obligation , et ce tout de
l'obligation vient englober, au fur et mesure qu'elles sont acceptes par
l'opinion, les prescriptions de l'autre justice, celle qui est ouverte des
crations successives. La mme forme s'impose ainsi deux matires, l'une
fournie par la socit, l'autre issue du gnie de l'homme. Pratiquement, en
effet, elles devraient tre confondues. Mais le philosophe les distinguera, sous
peine de se tromper gravement sur le caractre de l'volution sociale en mme
temps que sur l'origine du devoir. L'volution sociale n'est pas celle d'une
socit qui se serait dveloppe d'abord par une mthode destine la
transformer plus tard. Entre le dveloppement et la transformation il n'y a ici
ni analogie, ni commune mesure. Parce que justice close et justice ouverte
s'incorporent dans des lois galement impratives, qui se formulent de mme
et qui se ressemblent extrieurement, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent s'expliquer de la mme manire. Nul exemple ne montrera mieux que celui-ci la
double origine de la morale et les deux composantes de l'obligation.
Que, dans l'tat actuel des choses, la raison doive apparatre comme seule
imprative, que l'intrt de l'humanit soit d'attribuer aux concepts moraux
une autorit propre et une force intrinsque, enfin que l'activit morale, dans
une socit civilise, soit essentiellement rationnelle, cela n'est pas douteux.
Comment saurait-on autrement ce qu'on doit faire dans chaque cas particulier
? Des forces profondes sont l, l'une d'impulsion et l'autre d'attraction : nous
ne pouvons nous reporter directement elles chaque fois qu'il y a une
dcision prendre. Ce serait le plus souvent refaire inutilement un travail que
la socit en gnral d'une part, l'lite de l'humanit de l'autre, ont fait pour
nous. Ce travail a abouti formuler des rgles et dessiner un idal : ce sera
vivre moralement que de suivre ces rgles, que de se conformer cet idal.
Ainsi seulement on sera sr de rester pleinement d'accord avec soi-mme : il
n'y a de cohrent que le rationnel. Ainsi seulement pourront tre compares
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
44
entre elles les diverses lignes de conduite ; ainsi seulement pourra tre apprcie leur valeur morale. La chose est tellement vidente que nous l'avons
peine indique ; nous l'avons presque toujours sous-entendue. Mais il rsultait
de l que notre expos restait schmatique et pouvait paratre insuffisant. Sur
le plan intellectuel, en effet, toutes les exigences de la morale se compntrent
dans des concepts dont chacun, comme la monade leibnizienne, est plus ou
moins reprsentatif de tous les autres. Au-dessus ou au-dessous de ce plan
nous trouvons des forces dont chacune, prise isolment, ne correspond qu'
une partie de ce qui a t projet sur le plan intellectuel. Comme cet inconvnient de la mthode que nous avons suivie est incontestable, comme
d'ailleurs il est invitable, comme nous voyons que la mthode s'impose et
comme nous sentons qu'elle ne peut pas ne pas soulever des objections tout le
long de son application, nous tenons, pour conclure, la caractriser de
nouveau et la dfinir encore, dussions-nous rpter sur quelques points,
presque dans les mmes termes, ce que nous avons dj eu l'occasion de dire.
Une socit humaine dont les membres seraient lis entre eux comme les
cellules d'un organisme ou, ce qui revient peu prs au mme, comme les
fourmis d'une fourmilire, n'a jamais exist, mais les groupements de
l'humanit primitive s'en rapprochaient certainement plus que les ntres. La
nature, en faisant de l'homme un animal sociable, a voulu cette solidarit
troite, en la relchant toutefois dans la mesure o cela tait ncessaire pour
que l'individu dployt, dans l'intrt mme de la socit, l'intelligence dont
elle l'avait pourvu.. Telle est la constatation que nous nous sommes born
faire dans la premire partie de notre expos. Elle serait de mdiocre importance pour une philosophie morale qui accepterait sans discussion la croyance
l'hrdit de l'acquis : l'homme pourrait alors natre aujourd'hui avec des
tendances trs diffrentes de celles de ses plus lointains anctres. Mais nous
nous en tenons l'exprience, qui nous montre dans la transmission hrditaire de l'habitude contracte une exception - supposer qu'elle se produise
jamais - et non pas un fait assez rgulier, assez frquent, pour dterminer la
longue un changement profond de la disposition naturelle. Si radicale que soit
alors la diffrence entre le civilis et le primitif, elle tient uniquement ce que
l'enfant a emmagasin depuis le premier veil de sa conscience : toutes les
acquisitions de l'humanit pendant des sicles de civilisation sont l, ct de
lui, dposes dans la science qu'on lui enseigne, dans la tradition, dans les
institutions, dans les usages, dans la syntaxe et le vocabulaire de la langue
qu'il apprend parler et jusque dans la gesticulation des hommes qui l'entourent. C'est cette couche paisse de terre vgtale qui recouvre aujourd'hui le
roc de la nature originelle. Elle a beau reprsenter les effets lentement
accumuls de causes infiniment varies, elle n'en a pas moins d adopter la
configuration gnrale du sol sur lequel elle se posait. Bref, l'obligation que
nous trouvons au fond de notre conscience et qui en effet, comme le mot
l'indique bien, nous lie aux autres membres de la socit, est un lien du mme
genre que celui qui unit les unes aux autres les fourmis d'une fourmilire ou
les cellules d'un organisme. C'est la forme que prendrait ce lien aux yeux
d'une fourmi devenue intelligente comme un homme, ou d'une cellule
organique devenue aussi indpendante dans ses mouvements qu'une fourmi
intelligente. Je parle, bien entendu, de l'obligation envisage comme cette
simple forme, sans matire : elle est ce qu'il y a d'irrductible, et de toujours
prsent encore, dans notre nature morale. Il va de soi que la matire qui
s'encadre dans cette forme, chez un tre intelligent, est de plus en plus
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
45
intelligente et cohrente mesure que la civilisation avance, et qu'une
nouvelle matire survient sans cesse, non pas ncessairement l'appel direct
de cette forme, mais sous la pression logique de la matire intelligente qui s'y
est dj insre. Et nous avons vu aussi comment une matire qui est
proprement faite pour se couler dans une forme diffrente, qui n'est plus
apporte, mme trs indirectement, par le besoin de conservation sociale mais
par une aspiration de la conscience individuelle, accepte cette forme en se
disposant, comme le reste de la morale, sur le plan intellectuel. Mais toutes les
fois que nous revenons ce qu'il y a de proprement impratif dans l'obligation, et lors mme que nous trouverions en elle tout ce que l'intelligence y a
insr pour l'enrichir, tout ce que la raison a mis autour d'elle pour la justifier,
c'est dans cette structure fondamentale que nous nous replaons. Voil pour
l'obligation pure.
Maintenant, une socit mystique, qui engloberait l'humanit entire et qui
marcherait, anime d'une volont commune, la cration sans cesse renouvele d'une humanit plus complte, ne se ralisera videmment pas plus dans
l'avenir que n'ont exist, dans le pass, des socits humaines fonctionnement organique, comparables des socits animales. L'aspiration pure est
une limite idale, comme l'obligation nue. Il n'en est pas moins vrai que ce
sont les mes mystiques qui ont entran et qui entranent encore dans leur
mouvement les socits civilises. Le souvenir de ce qu'elles ont t, de ce
qu'elles ont fait, s'est dpos dans la mmoire de l'humanit. Chacun de nous
peut le revivifier, surtout s'il le rapproche de l'image, reste vivante en lui,
d'une personne qui participait de cette mysticit et la faisait rayonner autour
d'elle. Mme si nous n'voquons pas telle ou telle grande figure, nous savons
qu'il nous serait possible de l'voquer ; elle exerce ainsi sur nous une attraction virtuelle. Mme si nous nous dsintressons des personnes, il reste la
formule gnrale de la moralit qu'accepte aujourd'hui l'humanit civilise :
cette formule englobe deux choses, un systme d'ordres dicts par des exigences sociales impersonnelles, et un ensemble d'appels lancs la conscience de
chacun de nous par des personnes qui reprsentent ce qu'il y eut de meilleur
dans l'humanit. L'obligation qui s'attache l'ordre est, dans ce qu'elle a
d'original et de fondamental, infra-intellectuelle. L'efficacit de l'appel tient
la puissance de l'motion qui fut jadis provoque, qui l'est encore ou qui
pourrait l'tre : cette motion, ne ft-ce que parce qu'elle est indfiniment
rsoluble en ides, est plus qu'ide ; elle est supra-intellectuelle. Les deux
forces, s'exerant dans des rgions diffrentes de l'me, se projettent sur le
plan intermdiaire, qui est celui de l'intelligence. Elles seront dsormais
remplaces par leurs projections. Celles-ci s'entremlent et se compntrent. Il
en rsulte une transposition des ordres et des appels en termes de raison pure.
La justice se trouve ainsi sans cesse largie par la charit ; la charit prend de
plus en plus la forme de la simple justice ; les lments de la moralit deviennent homognes, comparables et presque commensurables entre eux; les
problmes moraux s'noncent avec prcision et se rsolvent avec mthode.
L'humanit est invite se placer un niveau dtermin, - plus haut qu'une
socit animale, o l'obligation ne serait que la force de l'instinct, mais moins
haut qu'une assemble de dieux, o tout serait lan crateur. Considrant alors
les manifestations de la vie morale ainsi organise, on les trouvera parfaitement cohrentes entre elles, capables par consquent de se ramener des
principes. La vie morale sera une vie rationnelle.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
46
Tout le monde se mettra d'accord sur ce point. Mais de ce qu'on aura
constat le caractre rationnel de la conduite morale, il ne suivra pas que la
morale ait son origine ou mme son fondement dans la pure raison. La grosse
question est de savoir pourquoi nous sommes obligs dans des cas o il ne
suffit nullement de se laisser aller pour faire son devoir.
Que ce soit alors la raison qui parle, je le veux bien; mais si elle s'exprimait uniquement en son nom, si elle faisait autre chose que formuler
rationnellement l'action de certaines forces qui se tiennent derrire elle,
comment lutterait-elle contre la passion ou l'intrt ? Le philosophe qui pense
qu'elle se suffit elle-mme, et qui prtend le dmontrer, ne russit dans sa
dmonstration que s'il rintroduit ces forces sans le dire : elles sont d'ailleurs
rentres son insu, subrepticement. Examinons en effet sa dmonstration.
Elle revt deux formes, selon qu'il prend la raison vide ou qu'il lui laisse une
matire, selon qu'il voit dans l'obligation morale la ncessit pure et simple de
rester d'accord avec soi-mme ou une invitation poursuivre logiquement une
certaine fin. Considrons ces deux formes tour tour. Lorsque Kant nous dit
qu'un dpt doit tre restitu parce que, si le dpositaire se l'appropriait, ce ne
serait plus un dpt, il joue videmment sur les mots. Ou bien il entend par
dpt le fait matriel de remettre une somme d'argent entre les mains d'un
ami, par exemple, en l'avertissant qu'on viendra la rclamer plus tard; mais ce
fait matriel tout seul, avec cet avertissement tout seul, aura pour consquence
de dterminer le dpositaire rendre la somme s'il n'en a pas besoin, et se
l'approprier purement et simplement s'il est en mal d'argent : les deux procds sont galement cohrents, du moment que le mot dpt n'voque
qu'une image matrielle sans accompagnement d'ides morales. Ou bien les
considrations morales sont l : l'ide que le dpt a t confi et qu'une
confiance ne doit pas tre trahie ; l'ide que le dpositaire s'est engag ,
qu'il a donn sa parole ; l'ide que, mme s'il n'a rien dit, il est li par un
contrat tacite ; l'ide qu'il existe un droit de proprit, etc. Alors, en
effet, on se contredirait soi-mme en acceptant un dpt et en refusant de le
rendre ; le dpt ne serait plus un dpt ; le philosophe pourrait dire que
l'immoral est ici de l'irrationnel. Mais c'est que le mot dpt serait pris
avec l'acception qu'il a dans un groupement humain o existent des ides proprement morales, des conventions et des obligations : ce n'est plus la
ncessit vide de ne pas se contredire que se ramnera l'obligation morale,
puisque la contradiction consisterait simplement ici rejeter, aprs l'avoir
accepte, une obligation morale qui se trouverait tre, par l mme, prexistante. - Mais laissons de ct ces subtilits. La prtention de fonder la morale
sur le respect de la logique a pu natre chez des philosophes et des savants
habitus s'incliner devant la logique en matire spculative et ports ainsi
croire qu'en toute matire, et pour l'humanit tout entire, la logique s'impose
avec nue autorit souveraine. Mais du fait que la science doit respecter la
logique des choses et la logique en gnral si elle veut aboutir dans ses
recherches, de ce que tel est l'intrt du savant en tant que savant, on ne peut
conclure l'obligation pour nous de mettre toujours de la logique dans notre
conduite, comme si tel tait l'intrt de l'homme en gnral ou mme du
savant en tant qu'homme. Notre admiration pour la fonction spculative de
l'esprit peut tre grande ; mais quand des philosophes avancent qu'elle suffirait faire taire l'gosme et la passion, ils nous montrent - et nous devons les
en fliciter -qu'ils n'ont jamais entendu rsonner bien fort chez eux la voix de
l'un ni de l'autre. Voil pour la morale qui se rclamerait de la raison
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
47
envisage comme une pure forme, sans matire. - Avant de considrer celle
qui adjoint une matire cette forme, remarquons que bien souvent on s'en
tient la premire quand on croit arriver la seconde. Ainsi font les philosophes qui expliquent l'obligation morale par la force avec laquelle s'imposerait
l'ide du Bien. S'ils prennent cette ide dans une socit organise, o les
actions humaines sont dj classes selon leur plus ou moins grande aptitude
maintenir la cohsion sociale et faire progresser l'humanit, et o surtout
certaines forces dfinies produisent cette cohsion et assurent ce progrs, ils
pourront dire, sans doute, qu'une activit est d'autant plus morale qu'elle est
plus conforme au bien ; et ils pourront ajouter aussi que le bien est conu
comme obligatoire. Mais c'est que le bien sera simplement la rubrique sous
laquelle on convient de ranger les actions qui prsentent l'une ou l'autre
aptitude, et auxquelles on se sent dtermin par les forces d'impulsion et
d'attraction que nous avons dfinies. La reprsentation d'une hirarchie de ces
diverses conduites, de leurs valeurs respectives par consquent, et d'autre part
la quasi-ncessit avec laquelle elles s'imposent, auront donc prexist l'ide
du bien, qui ne surgira qu'aprs coup pour fournir une tiquette ou un nom :
celle-ci, laisse elle-mme, n'et pu servir les classer, encore moins les
imposer. Que si, au contraire, on veut que l'ide du Bien soit la source de
toute obligation et de toute aspiration, et qu'elle serve aussi qualifier les
actions humaines, il faudra qu'on nous dise quel signe on reconnat qu'une
conduite lui est conforme; il faudra donc qu'on nous dfinisse le Bien; et nous
ne voyons pas comment on pourrait le dfinir sans postuler une hirarchie des
tres ou tout au moins des actions, une plus ou moins grande lvation des uns
et des autres : mais si cette hirarchie existe par elle-mme, il est inutile de
faire appel l'ide du Bien pour l'tablir; d'ailleurs nous ne voyons pas
pourquoi cette hirarchie devrait tre conserve, pourquoi nous serions tenus
de la respecter ; on ne pourra invoquer en sa faveur que des raisons esthtiques, allguer qu'une conduite est plus belle qu'une autre, qu'elle nous
place plus ou moins haut dans la srie des tres : mais que rpondrait-on
l'homme qui dclarerait mettre au-dessus de tout la considration de son
intrt ? En y regardant de prs, on verrait que cette morale ne s'est jamais
suffi elle-mme. Elle est simplement venue se surajouter, comme un complment artistique, des obligations qui lui prexistaient et qui la rendaient
possible. Quand les philosophes grecs attribuent une dignit minente la
pure ide du Bien et plus gnralement la vie contemplative, ils parlent pour
une lite qui se constituerait l'intrieur de la socit et qui commencerait par
prendre pour accorde la vie sociale. On a dit que cette morale ne parlait pas
de devoir, ne connaissait pas l'obligation telle que nous l'entendons. Il est trs
vrai qu'elle n'en parlait pas ; mais c'est justement parce qu'elle la considrait
comme allant de soi. Le philosophe tait cens avoir d'abord accompli,
comme tout le monde, le devoir tel que le lui imposait la cit. Alors seulement
survenait une morale destine embellir sa vie en la traitant comme une
oeuvre d'art. Bref, et pour tout rsumer, il ne peut tre question de fonder la
morale sur le culte de la raison. - Resterait alors, comme nous l'annoncions,
examiner si elle pourrait reposer sur la raison en tant que celle-ci prsenterait
notre activit une fin dtermine, conforme la raison mais s'y surajoutant,
une fin que la raison nous enseignerait poursuivre mthodiquement. Mais il
est ais de voir qu'aucune fin - pas mme la double fin que nous avons indique, pas mme le double souci de maintenir la cohsion sociale et de faire
progresser l'humanit - ne s'imposera d'une manire obligatoire en tant que
simplement propose par la raison. Si certaines forces rellement agissantes et
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
48
pesant effectivement sur notre volont sont dans la place, la raison pourra et
devra intervenir pour en coordonner les effets, mais elle ne saurait rivaliser
avec ces forces, puisqu'on peut toujours raisonner avec elle, opposer ses
raisons d'autres raisons, ou mme simplement refuser la discussion et
rpondre par un sic volo, sic jubeo . A vrai dire, une morale qui croit
fonder l'obligation sur des considrations purement rationnelles rintroduit
toujours son insu, comme nous l'avons dj dit et comme nous allons le
rpter, des forces d'un ordre diffrent. C'est justement pourquoi elle russit
avec une telle facilit. L'obligation vraie est dj l, et ce que la raison viendra
poser sur elle prendra naturellement un caractre obligatoire. La socit, avec
ce qui la maintient et ce qui la pousse en avant, est dj l, et c'est pourquoi la
raison pourra adopter comme principe de la morale l'une quelconque des fins
que poursuit l'homme en socit ; en construisant un systme bien cohrent de
moyens destins a raliser cette fin, elle retrouvera tant bien que mal la
morale telle que le sens commun la conoit, telle que l'humanit en gnral la
pratique ou prtend la pratiquer. C'est que chacune de ces fins, tant prise par
elle dans la socit, est socialise et, par l mme, grosse de toutes les autres
fins qu'on peut s'y proposer. Ainsi, mme si l'on rige en principe de la morale
l'intrt personnel, il ne sera pas difficile de construire une morale raisonnable, qui ressemble suffisamment la morale courante, comme le prouve le
succs relatif de la morale utilitaire. L'gosme, en effet, pour l'homme vivant
en socit, comprend l'amour-propre, le besoin d'tre lou, etc. ; de sorte que
le pur intrt personnel est devenu a peu prs indfinissable, tant il y entre
d'intrt gnral, tant il est difficile de les isoler l'un de l'autre. Qu'on songe
tout ce qu'il y a de dfrence pour autrui dans ce qu'on appelle amour de soi,
et mme dans la jalousie et l'envie ! Celui qui voudrait pratiquer l'gosme
absolu devrait s'enfermer en lui-mme, et ne plus se soucier assez du prochain
pour le jalouser ou l'envier. il entre de la sympathie dans ces formes de la
haine, et les vices mmes de l'homme vivant en socit ne sont pas sans
impliquer quelque vertu: tous sont saturs de vanit, et vanit signifie d'abord
sociabilit. A plus forte raison pourra-t-on dduire approximativement la
morale de sentiments tels que celui de l'honneur, ou la sympathie, ou la piti.
Chacune de ces tendances, chez l'homme vivant en socit, est charge de ce
que la morale sociale y a dpos ; et il faudrait l'avoir vide de ce contenu, au
risque de la rduire bien peu de chose, pour ne pas commettre une ptition
de principe en expliquant par elle la morale. La facilit avec laquelle on
compose des thories de ce genre devrait veiller nos soupons : si les fins les
plus diverses peuvent ainsi tre transmues par les philosophes en fins
morales, c'est vraisemblablement - comme ils ne tiennent pas encore la pierre
philosophale - qu'ils avaient commenc par mettre de l'or au fond de leur
creuset. Comme aussi il est vident qu'aucune de ces doctrines ne rendra
compte de l'obligation ; nous pourrons tre tenus l'adoption de certains
moyens si nous voulons raliser telle ou telle fin ; mais s'il nous plat de
renoncer la fin, comment nous imposer les moyens ? Pourtant, en adoptant
l'une quelconque de ces fins comme principe de la morale, les philosophes en
ont tir des systmes de maximes qui, sans aller jusqu' prendre la forme
d'impratifs, s'en rapprochent assez pour qu'on puisse s'en contenter. La raison
en est bien simple. Ils ont envisag la poursuite de ces fins, encore une fois,
dans une socit o il y a des pressions dcisives et des aspirations complmentaires qui les prolongent. Pression et attraction, en se dterminant,
aboutiraient l'un quelconque de ces systmes de maximes, puisque chacun
d'eux vise la ralisation d'une fin qui est la fois individuelle et sociale.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
49
Chacun de ces systmes prexiste donc dans l'atmosphre sociale la venue
du philosophe; il comprend des maximes qui se rapprochent suffisamment par
leur contenu de celles que le philosophe formulera, et qui sont, elles, obligatoires. Retrouves par la philosophie, mais non plus sous la forme d'un
commandement puisque ce ne sont plus que des recommandations en vue de
la poursuite intelligente d'une fin que l'intelligence pourrait aussi bien rejeter,
elles sont happes par la maxime plus vague, ou mme simplement virtuelle,
qui y ressemble, mais qui est charge d'obligation. Elles deviennent ainsi
obligatoires ; mais l'obligation n'est pas descendue, comme on pourrait le
croire, d'en haut, c'est--dire du principe d'o des maximes ont t rationnellement dduites ; elle est remonte d'en bas, je veux dire du fond de pressions,
prolongeable en aspirations, sur lequel la socit repose. Bref, les thoriciens
de la morale postulent la socit et par consquent les deux forces auxquelles
la socit doit sa stabilit et son mouvement. Profitant de ce que toutes les fins
sociales se compntrent et de ce que chacune d'elles, pose en quelque sorte
sur cet quilibre et sur ce mouvement, semble se doubler de ces deux forces,
ils n'ont pas de peine reconstituer le contenu de la morale avec l'une
quelconque des fins prise pour principe, et montrer alors que cette morale
est obligatoire. C'est qu'ils se sont donn par avance, avec la socit, la matire de cette morale et sa forme, tout ce qu'elle contient et toute l'obligation dont
elle s'enveloppe.
En creusant maintenant sous cette illusion commune toutes les morales
thoriques, voici ce qu'on trouverait. L'obligation est une ncessit avec
laquelle on discute, et qui s'accompagne par consquent d'intelligence et de
libert. La ncessit, d'ailleurs, est analogue ici celle qui s'attache la production d'un effet physiologique ou mme physique : dans une humanit que
la nature n'aurait pas faite intelligente, et o l'individu n'aurait aucune
puissance de choix, l'action destine maintenir la conservation et la cohsion
du groupe s'accomplirait ncessairement ; elle s'accomplirait sous l'influence
d'une force bien dtermine, la mme qui fait que chaque fourmi travaille
pour la fourmilire et chaque cellule d'un tissu pour l'organisme. Mais l'intelligence intervient, avec la facult de choisir : c'est une autre force, toujours
actuelle, qui maintient la prcdente l'tat de virtualit ou plutt de ralit
peine visible dans son action, sensible pourtant dans sa pression : telles, les
alles et venues du balancier, dans une horloge, empchent la tension du
ressort de se manifester par une dtente brusque et rsultent pourtant de cette
tension mme, tant des effets qui exercent une action inhibitrice ou rgulatrice sur leurs causes. Que va donc faire l'intelligence ? C'est une facult que
l'individu emploie naturellement le tirer des difficults de la vie ; elle ne
suivra pas la direction d'une force qui travaille au contraire pour l'espce et
qui, si elle prend en considration l'individu, le fait dans l'intrt de l'espce.
Elle ira tout droit aux solutions gostes. Mais ce ne sera que son premier
mouvement. Elle ne pourra pas ne pas tenir compte de la force dont elle subit
la pression invisible. Elle se persuadera donc elle-mme qu'un gosme
intelligent doit laisser leur part tous les autres gosmes. Et si c'est l'intelligence d'un philosophe, elle construira une morale thorique o l'interpntration de l'intrt personnel et de l'intrt gnral sera dmontre, et o
l'obligation se ramnera la ncessit, sentie par nous, de penser autrui si
nous voulons nous rendre intelligemment utiles nous. mmes. Mais nous
pourrons toujours rpondre qu'il ne nous plat pas d'entendre ainsi notre
intrt, et l'on ne voit pas alors pourquoi nous nous sentirions encore obligs.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
50
Nous sommes obligs cependant, et l'intelligence le, sait bien, et c'est
pourquoi elle a tent la dmonstration. Mais la vrit est que sa dmonstration
ne semble aboutir que parce qu'elle livre passage quelque chose dont elle ne
parle pas, et qui est l'essentiel : une ncessit subie et sentie, que le raisonnement avait refoule et qu'un raisonnement antagoniste ramne. Ce qu'il y a de
proprement obligatoire dans l'obligation ne vient donc pas de l'intelligence.
Celle-ci n'explique, de l'obligation, que ce qu'on y trouve d'hsitation. L o
elle parat fonder l'obligation, elle se borne la maintenir en rsistant une
rsistance, en s'empchant d'empcher. Nous verrons d'ailleurs, dans le
prochain chapitre, quels auxiliaires elle s'adjoint. Pour le moment, reprenons
une comparaison qui nous a dj servi. Une fourmi qui accomplit son rude
labeur comme si elle ne pensait jamais elle, comme si elle ne vivait que pour
la fourmilire, est vraisemblablement en tat somnambulique ; elle obit une
ncessit inluctable. Supposez qu'elle devienne brusquement intelligente :
elle raisonnera sur ce qu'elle fait, se demandera pourquoi elle le fait, se dira
qu'elle est bien sotte de ne pas se donner du repos et du bon temps. Assez de
sacrifices ! Le moment est venu de penser soi. Voil l'ordre naturel boulevers. Mais la nature veille. Elle avait pourvu la fourmi de l'instinct social ;
elle vient d'y joindre, peut-tre parce que l'instinct se trouvait en avoir
momentanment besoin, une lueur d'intelligence. Pour peu que l'intelligence
ait drang l'instinct, vite il faudra qu'elle s'emploie remettre les choses en
place et dfaire ce qu'elle a fait. Un raisonnement tablira donc que la
fourmi a tout intrt travailler pour la fourmilire, et ainsi paratra fonde
l'obligation. Mais la vrit est qu'un tel fondement serait bien peu solide, et
que l'obligation prexistait dans toute sa force : l'intelligence a simplement
fait obstacle un obstacle qui venait d'elle. Le philosophe de la fourmilire
n'en rpugnerait pas moins l'admettre ; il persisterait sans doute attribuer
un rle positif, et non pas ngatif, l'intelligence. Ainsi ont fait le plus
souvent les thoriciens de la morale, soit parce que c'taient des intellectuels
qui craignaient de ne pas concder l'intelligence assez de place, soit plutt
parce que l'obligation leur apparaissait comme chose simple, indcomposable
: au contraire, si l'on y voit une quasi-ncessit contrarie ventuellement par
une rsistance, on conoit que la rsistance vienne de l'intelligence, la
rsistance la rsistance galement, et que la ncessit, qui est l'essentiel, ait
une autre origine. A vrai dire, aucun philosophe ne peut s'empcher de poser
cette ncessit d'abord ; mais le plus souvent il la pose implicitement, sans le
dire. Nous l'avons pose en le disant. Nous la rattachons d'ailleurs un
principe qu'il est impossible de ne pas admettre. A quelque philosophie, en
effet, qu'on se rattache, on est bien forc de reconnatre que l'homme est un
tre vivant, que l'volution de la vie, sur ses deux principales lignes, s'est
accomplie dans la direction de la vie sociale, que l'association est la forme la
plus gnrale de l'activit vivante puisque la vie est organisation, et que ds
lors on passe par transitions insensibles des rapports entre cellules dans un
organisme aux relations entre individus dans la socit. Nous nous bornons
donc noter de l'incontest, de l'incontestable. Mais, ceci une fois admis,
toute thorie de l'obligation devient inutile en mme temps qu'inoprante
inutile, parce que l'obligation est une ncessit de la vie inoprante, parce que
l'hypothse introduite peut tout au plus justifier aux yeux de l'intelligence (et
justifier bien incompltement) une obligation qui prexistait cette reconstruction intellectuelle.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
51
La vie aurait d'ailleurs pu s'en tenir l, et ne rien faire de plus que de
constituer des socits closes dont les membres eussent t lis les uns aux
autres par des obligations strictes. Composes d'tres intelligents, ces socits
auraient prsent une variabilit qu'on ne trouve pas dans les socits animales, rgies par l'instinct ; mais la variation ne serait pas alle jusqu' encourager le rve d'une transformation radicale; l'humanit ne se ft pas modifie
au point qu'une socit unique, embrassant tous les hommes, appart comme
possible. Par le fait, celle-ci n'existe pas encore, et n'existera peut-tre jamais :
en donnant l'homme la conformation morale qu'il lui fallait pour vivre en
groupe, la nature a probablement fait pour l'espce tout ce qu'elle pouvait.
Mais de mme qu'il s'est trouv des hommes de gnie pour reculer les bornes
de l'intelligence, et qu'il a t concd par l des individus, de loin en loin,
beaucoup plus qu'il n'avait t possible de donner tout d'un coup l'espce,
ainsi des mes privilgies ont surgi qui se sentaient apparentes toutes les
mes et qui, au lieu de rester dans les limites du groupe et de s'en tenir la
solidarit tablie par la nature, se portaient vers l'humanit en gnral dans un
lan d'amour. L'apparition de chacune d'elles tait comme la cration d'une
espce nouvelle compose d'un individu unique, la pousse vitale aboutissant
de loin en loin, dans un homme dtermin, un rsultat qui n'et pu tre
obtenu tout d'un coup pour l'ensemble de l'humanit. Chacune d'elles marquait
ainsi un certain point atteint par l'volution de la vie ; et chacune d'elles
manifestait sous une forme originale un amour qui parat tre l'essence mme
de l'effort crateur. L'motion cratrice qui soulevait ces mes privilgies, et
qui tait un dbordement de vitalit, s'est rpandue autour d'elles : enthousiastes, elles rayonnaient un enthousiasme qui ne s'est jamais compltement
teint et qui peut toujours retrouver sa flamme. Aujourd'hui, quand nous
ressuscitons par la pense ces grands hommes de bien, quand nous les coutons parler et quand nous les regardons faire, nous sentons qu'ils nous
communiquent de leur ardeur et qu'ils nous entranent dans leur mouvement :
ce n'est plus une coercition plus ou moins attnue, c'est un plus ou moins
irrsistible attrait. Mais cette seconde force, pas plus que la premire, n'a
besoin d'explication. Vous ne pouvez pas ne pas vous donner la demi-contrainte exerce par des habitudes qui correspondent symtriquement
l'instinct, vous ne pouvez pas ne pas poser ce soulvement de l'me qu'est
l'motion: dans un cas vous avez l'obligation originelle, et, dans l'autre,
quelque chose qui en devient le prolongement; mais, dans les deux cas, vous
tes devant des forces qui ne sont pas proprement et exclusivement morales,
et dont le moraliste n'a pas faire la gense. Pour avoir voulu la faire, les
philosophes ont mconnu le caractre mixte de l'obligation sous sa forme
actuelle; ils ont ensuite d attribuer telle ou telle reprsentation de l'intelligence la puissance d'entraner la volont : comme si une ide pouvait jamais
demander catgoriquement sa propre ralisation ! comme si l'ide tait autre
chose ici que l'extrait intellectuel commun, ou mieux la projection sur le plan
intellectuel, d'un ensemble de tendances et d'aspirations dont les unes sont audessus et les autres au-dessous de la pure intelligence ! Rtablissons la dualit
d'origine : les difficults s'vanouissent. Et la dualit elle-mme se rsorbe
dans l'unit, car pression sociale et lan d'amour ne sont que deux
manifestations complmentaires de la vie, normalement applique conserver
en gros la forme sociale qui fut caractristique de l'espce humaine ds
l'origine, mais exceptionnellement capable de la transfigurer, grce des
individus dont chacun reprsente, comme et fait l'apparition d'une nouvelle
espce, un effort d'volution cratrice.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
52
De cette double origine de la morale les ducateurs n'ont peut-tre pas tous
la vision complte, mais ils en aperoivent quelque chose ds qu'ils veulent
rellement inculquer la morale leurs lves, et non pas seulement leur en
parler. Nous ne nions pas l'utilit, la ncessit mme d'un enseignement moral
qui s'adresse la pure raison, qui dfinisse les devoirs et les rattache un
principe dont il suit, dans le dtail, les diverses applications. C'est sur le plan
de l'intelligence, et sur celui-l seulement, que la discussion est possible, et il
n'y a pas de moralit complte sans rflexion, analyse, discussion avec les
autres comme avec soi-mme. Mais si un enseignement qui s'adresse l'intelligence est indispensable pour donner au sens moral de l'assurance et de la
dlicatesse, s'il nous rend pleinement capables de raliser notre intention l o
notre intention est bonne, encore faut-il qu'il y ait d'abord intention, et l'intention marque une direction de la volont autant et plus que de l'intelligence.
Comment aura-t-on prise sur la volont ? Deux voies s'ouvrent l'ducateur.
L'une est celle du dressage, le mot tant pris dans son sens le plus lev ;
l'autre est celle de la mysticit, le terme ayant au contraire ici sa signification
la plus modeste. Par la premire mthode on inculque une morale faite d'habitudes impersonnelles ; par la seconde on obtient l'imitation d'une personne, et
mme une union spirituelle, une concidence plus ou moins complte avec
elle. Le dressage originel, celui qui avait t voulu par la nature, consistait
dans l'adoption des habitudes du groupe ; il tait automatique ; il se faisait de
lui-mme l o l'individu se sentait moiti confondu avec la collectivit. A
mesure que la socit se diffrenciait par l'effet d'une division du travail, elle
dlguait aux groupements ainsi constitus l'intrieur d'elle la tche de
dresser l'individu, de le mettre en harmonie avec eux et par l avec elle ; mais
il s'agissait toujours d'un systme d'habitudes contractes au profit seulement
de la socit. Qu'une moralit de ce genre suffise la rigueur, si elle est
complte, cela n'est pas douteux. Ainsi, l'homme strictement insr dans le
cadre de son mtier ou de sa profession, qui serait tout entier son labeur
quotidien, qui organiserait sa vie de manire fournir la plus grande quantit
et la meilleure qualit possible de travail, s'acquitterait gnralement ipso
facto de beaucoup d'autres obligations. La discipline aurait fait de lui un
honnte homme. Telle est la premire mthode; elle opre dans l'impersonnel.
L'autre la compltera au besoin; elle pourra mme la remplacer. Nous nhsitons pas l'appeler religieuse, et mme mystique ; mais il faut s'entendre sur
le sens des mots. On se plat dire que la religion est l'auxiliaire de la morale,
en ce qu'elle fait craindre ou esprer des peines ou des rcompenses. On a
peut-tre raison, mais on devrait ajouter que, de ce ct, la religion ne fait
gure autre chose que promettre une extension et un redressement de la justice
humaine par la justice divine : aux sanctions tablies par la socit, et dont le
jeu est si imparfait, elle en superpose d'autres, infiniment plus hautes, qui
doivent nous tre appliques dans la cit de Dieu quand nous aurons quitt
celle des hommes; toutefois, c'est sur le plan de la cit humaine qu'on se
maintient ainsi ; on fait intervenir la religion, sans doute, mais non pas dans ce
qu'elle a de plus spcifiquement religieux ; si haut qu'on s'lve, on envisage
encore l'ducation morale comme un dressage, et la moralit comme une
discipline ; c'est la premire des deux mthodes qu'on s'attache encore, on ne
s'est pas transport la seconde. D'autre part, c'est aux dogmes religieux, la
mtaphysique qu'ils impliquent, que nous pensons gnralement ds que le
mot religion est prononc : de sorte que lorsqu'on donne la religion pour
fondement la morale, on se reprsente un ensemble de conceptions, relatives
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
53
Dieu et au monde, dont l'acceptation aurait pour consquence la pratique du
bien. Mais il est clair que ces conceptions, prises en tant que telles, influent
sur notre volont et sur notre conduite comme peuvent le faire des thories,
c'est--dire des ides: nous sommes ici sur le plan intellectuel, et, comme on
l'a vu plus haut, ni l'obligation ni ce qui la prolonge ne saurait driver de l'ide
pure, celle-ci n'agissant sur notre volont que dans la mesure o il nous plat
de l'accepter et de la mettre en pratique. Que si l'on distingue cette mtaphysique de toutes les autres en disant que prcisment elle s'impose notre
adhsion, on a peut-tre encore raison, mais alors ce n'est plus son seul
contenu, la pure reprsentation intellectuelle que l'on pense ; on introduit
quelque chose de diffrent, qui soutient la reprsentation, qui lui communique
je ne sais quelle efficace, et qui est l'lment spcifiquement religieux: mais
c'est maintenant cet lment, et non pas la mtaphysique laquelle il est joint,
qui devient le fondement religieux de la morale. Nous avons bien affaire la
seconde mthode, mais c'est de l'exprience mystique qu'il s'agit. Nous voulons parler de l'exprience mystique envisage dans ce qu'elle a d'immdiat,
en dehors de toute interprtation. Les vrais mystiques s'ouvrent simplement au
flot qui les envahit. Srs d'eux-mmes, parce qu'ils sentent en eux quelque
chose de meilleur qu'eux, ils se rvlent grands hommes d'action, la surprise
de ceux pour qui le mysticisme n'est que vision, transport, extase. Ce qu'ils
ont laiss couler l'intrieur d'eux-mmes, c'est un flux descendant qui
voudrait, travers eux, gagner les autres hommes : le besoin de rpandre
autour d'eux ce qu'ils ont reu, ils le ressentent comme un lan d'amour.
Amour auquel chacun d'eux imprime la marque de sa personnalit. Amour qui
est alors en chacun d'eux une motion toute neuve, capable de transposer la
vie humaine dans un autre ton. Amour qui fait que chacun d'eux est aim ainsi
pour lui-mme, et que par lui, pour lui, d'autres hommes laisseront leur me
s'ouvrir l'amour de l'humanit. Amour qui pourra aussi bien se transmettre
par l'intermdiaire d'une personne qui se sera attache eux ou leur souvenir
rest vivant, et qui aura conform sa vie ce modle. Allons plus loin. Si la
parole d'un grand mystique, ou de quelqu'un de ses imitateurs, trouve un cho
chez tel ou tel d'entre nous, n'est-ce pas qu'il peut y avoir en nous un mystique
qui sommeille et qui attend seulement une occasion de se rveiller ? Dans le
premier cas, la personne s'attache l'impersonnel et vise s'y insrer. Ici, elle
rpond l'appel d'une personnalit, qui peut tre celle d'un rvlateur de la vie
morale, ou celle d'un de ses imitateurs, ou mme, dans certaines circonstances, la sienne.
Qu'on pratique d'ailleurs l'une ou l'autre mthode, dans les deux cas on
aura tenu compte du fond de la nature humaine, prise statiquement en ellemme ou dynamiquement dans ses origines. L'erreur serait de croire que
pression et aspiration morales trouvent leur explication dfinitive dans la vie
sociale considre comme un simple fait. On se plat dire que la socit
existe, que ds lors elle exerce ncessairement sur ses membres une contrainte, et que cette contrainte est l'obligation. Mais d'abord, pour que la
socit existe, il faut que l'individu apporte tout un ensemble de dispositions
innes ; la socit ne s'explique donc pas elle-mme ; on doit par consquent
chercher au-dessous des acquisitions sociales, arriver la vie, dont les
socits humaines ne sont, comme l'espce humaine d'ailleurs, que des
manifestations. Mais ce n'est pas assez dire : il faudra creuser plus profondment encore si l'on veut comprendre, non plus seulement comment la
socit oblige les individus, mais encore comment l'individu peut juger la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
54
socit et obtenir d'elle une transformation morale. Si la socit se suffit
elle-mme, elle est l'autorit suprme. Mais si elle n'est qu'une des dterminations de la vie, on conoit que la vie, qui a d dposer l'espce humaine
en tel ou tel point de son volution, communique une impulsion nouvelle
des individualits privilgies qui se seront retrempes en elle pour aider la
socit aller plus loin. Il est vrai qu'il aura fallu pousser jusqu'au principe
mme de la vie. Tout est obscur, si l'on s'en tient de simples manifestations,
qu'on les appelle toutes ensemble sociales ou que l'on considre plus particulirement, dans l'homme social, l'intelligence. Tout s'claire au contraire, si
l'on va chercher, par-del ces manifestations, la vie elle-mme. Donnons donc
au mot biologie le sens trs comprhensif qu'il devrait avoir, qu'il prendra
peut-tre un jour, et disons pour conclure que toute morale, pression ou
aspiration, est d'essence biologique.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
55
Chapitre II
La religion statique
Retour la table des matires
Le spectacle de ce que furent les religions, et de ce que certaines sont
encore, est bien humiliant pour l'intelligence humaine. Quel tissu d'aberrations ! L'exprience a beau dire c'est faux et le raisonnement c'est absurde , l'humanit ne s'en cramponne que davantage l'absurdit et l'erreur.
Encore si elle s'en tenait l ! Mais on a vu la religion prescrire l'immoralit,
imposer des crimes. Plus elle est grossire, plus elle tient matriellement de
place dans la vie d'un peuple. Ce qu'elle devra partager plus tard avec la
science, l'art, la philosophie, elle le demande et l'obtient d'abord pour elle
seule. Il y a l de quoi surprendre, quand on a commenc par dfinir l'homme
un tre intelligent.
Notre tonnement grandit, quand nous voyons que la superstition la plus
basse a t pendant si longtemps un fait universel. Elle subsiste d'ailleurs
encore. On trouve dans le pass, on trouverait mme aujourd'hui des socits
humaines qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de
socit sans religion.
Quelle ne devrait pas tre notre confusion, maintenant, si nous nous comparions l'animal sur ce point ! Trs probablement l'animal ignore la supers-
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
56
tition. Nous ne savons gure ce qui se passe dans des consciences autres que
la ntre ; mais comme les tats religieux se traduisent d'ordinaire par des
attitudes et par des actes, nous serions bien avertis par quelque signe si
l'animal tait capable de religiosit. Force nous est donc d'en prendre notre
parti. L'homo sapiens, seul tre dou de raison, est le seul aussi qui puisse
suspendre son existence des choses draisonnables.
On parle bien d'une mentalit primitive qui serait aujourd'hui celle des
races infrieures, qui aurait jadis t celle de l'humanit en gnral, et sur le
compte de laquelle il faudrait mettre la superstition. Si l'on se borne ainsi
grouper certaines manires de penser sous une dnomination commune et
relever certains rapports entre elles, on fait uvre utile et inattaquable : utile,
en ce que l'on circonscrit un champ d'tudes ethnologiques et psychologiques
qui est du plus haut intrt ; inattaquable, puisque l'on ne fait que constater
l'existence de certaines croyances et de certaines pratiques dans une humanit
moins civilise que la ntre. L semble d'ailleurs s'en tre tenu M. Lvy-Bruhl
dans ses remarquables ouvrages, surtout dans les derniers. Mais on laisse alors
intacte la question de savoir comment des croyances ou des pratiques aussi
peu raisonnables ont pu et peuvent encore tre acceptes par des tres
intelligents. A cette question nous ne pouvons pas nous empcher de chercher
une rponse. Bon gr mal gr, le lecteur des beaux livres de M. Lvy-Bruhl
tirera d'eux la conclusion que l'intelligence humaine a volu ; la logique
naturelle n'aurait pas toujours t la mme ; la mentalit primitive correspondrait une structure fondamentale diffrente, que la ntre aurait supplante et qui ne se rencontre aujourd'hui que chez des retardataires. Mais on
admet alors que les habitudes d'esprit acquises par les individus au cours des
sicles ont pu devenir hrditaires, modifier la nature et donner une nouvelle
mentalit l'espce. Rien de plus douteux. A supposer qu'une habitude
contracte par les parents se transmette jamais l'enfant, c'est un fait rare, d
tout un concours de circonstances accidentellement runies : aucune modification de l'espce ne sortira de l. Mais alors, la structure de l'esprit restant
la mme, l'exprience acquise par les gnrations successives, dpose dans le
milieu social et restitue par ce milieu chacun de nous, doit suffire
expliquer pourquoi nous ne pensons pas comme le non-civilise, pourquoi
l'homme d'autrefois diffrait de l'homme actuel. L'esprit fonctionne de mme
dans les deux cas, mais il ne s'applique peut-tre pas la mme matire,
probablement parce que la socit n'a pas, ici et l, les mmes besoins. Telle
sera bien la conclusion de nos recherches. Sans anticiper sur elle, bornonsnous dire que l'observation des primitifs pose invitablement la question
des origines psychologiques de la superstition, et que la structure gnrale de
l'esprit humain - l'observation par consquent de l'homme actuel et civilis nous paratra fournir des lments suffisants la solution du problme.
Nous nous exprimerons peu prs de mme sur la mentalit collective ,
et non plus primitive . D'aprs mile Durkheim, il n'y a pas chercher
pourquoi les choses auxquelles telle ou telle religion demande de croire ont
un aspect si dconcertant pour les raisons individuelles. C'est tout simplement
que la reprsentation qu'elle en offre n'est pas 1'oeuvre de ces raisons, mais de
l'esprit collectif. Or il est naturel que cet esprit se reprsente la ralit autrement que ne fait le ntre, puisqu'il est d'une autre nature. La socit a sa
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
57
manire d'tre qui lui est propre, donc sa manire de penser 1 . Nous admettrons volontiers, quant nous, l'existence de reprsentations collectives, dposes dans les institutions, le langage et les murs. Leur ensemble constitue
l'intelligence sociale, complmentaire des intelligences individuelles. Mais
nous ne voyons pas comment ces deux mentalits seraient discordantes, et
comment l'une des deux pourrait dconcerter l'autre. L'exprience ne dit
rien de semblable, et la sociologie ne nous parat avoir aucune raison de le
supposer. Si l'on jugeait que la nature s'en est tenue l'individu, que la socit
est ne d'un accident ou d'une convention, on pourrait pousser la thse
jusqu'au bout et prtendre que cette rencontre d'individus, comparable celle
des corps simples qui s'unissent dans une combinaison chimique, a fait surgir
une intelligence collective dont certaines reprsentations drouteront la raison
individuelle. Mais personne n'attribue plus la socit une origine accidentelle ou contractuelle. S'il y avait un reproche faire la sociologie, ce serait
plutt d'appuyer trop dans l'autre sens : tel de ses reprsentants verrait dans
l'individu une abstraction, et dans le corps social l'unique ralit. Mais alors,
comment la mentalit collective ne serait-elle pas prfigure dans la mentalit
individuelle ? Comment la nature, en faisant de l'homme un animal politique , aurait-elle dispos les intelligences humaines de telle manire qu'elles
se sentent dpayses quand elles pensent politiquement ? Pour notre part,
nous estimons qu'on ne tiendra jamais assez compte de sa destination sociale
quand on tudiera l'individu. C'est pour avoir nglig de le faire que la
psychologie a si peu progress dans certaines directions. Je ne parle pas de
l'intrt qu'il y aurait approfondir certains tats anormaux ou morbides qui
impliquent entre les membres d'une socit, comme entre les abeilles de la
ruche, une invisible anastomose : en dehors de la ruche l'abeille s'tiole et
meurt; isol de la socit ou ne participant pas assez son effort, l'homme
souffre d'un mal peut-tre analogue, bien peu tudi jusqu' prsent, qu'on
appelle l'ennui ; quand l'isolement se prolonge, comme dans la rclusion
pnale, des troubles mentaux caractristiques se dclarent. Ces phnomnes
mriteraient dj que la psychologie leur ouvrt un compte spcial ; il se
solderait par de beaux bnfices. Mais ce n'est pas assez dire. L'avenir d'une
science dpend de la manire dont elle a d'abord dcoup son objet. Si elle a
eu la chance de trancher selon les articulations naturelles, ainsi que le bon
cuisinier dont parle Platon, peu importe le nombre des morceaux qu'elle aura
faits : comme le dcoupage en parties aura prpar l'analyse en lments, on
possdera finalement une reprsentation simplifie de l'ensemble. C'est de
quoi notre psychologie ne s'est pas avise quand elle a recul devant certaines
subdivisions. Par exemple, elle pose des facults gnrales de percevoir,
d'interprter, de comprendre, sans se demander si ce ne seraient pas des
mcanismes diffrents qui entreraient en jeu selon que ces facults s'appliquent des personnes ou des choses, selon que l'intelligence est immerge
ou non dans le milieu social. Pourtant le commun des hommes esquisse dj
cette distinction et l'a mme consigne dans son langage : ct des sens, qui
nous renseignent sur les choses, il met le bon sens, qui concerne nos relations
avec les personnes. Comment ne pas remarquer que l'on peut tre profond
mathmaticien, savant physicien, psychologue dlicat en tant que s'analysant
soi-mme, et pourtant comprendre de travers les actions d'autrui, mal calculer
les siennes, ne jamais s'adapter au milieu, enfin manquer de bon sens ? La
folie des perscutions, plus prcisment le dlire d'interprtation, est l pour
1
Anne sociologique, vol. II, pages 29 et suivantes.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
58
montrer que le bon sens peut tre endommag alors que la facult de raisonner
demeure intacte. La gravit de cette affection, sa rsistance obstine tout
traitement, le fait qu'on en trouve gnralement des prodromes dans le plus
lointain pass du malade, tout cela semble bien indiquer qu'il s'agit d'une
insuffisance psychique profonde, congnitale, et nettement dlimite. Le bon
sens, qu'on pourrait appeler le sens social, est donc inn l'homme normal,
comme la facult de parler, qui implique galement l'existence de la socit et
qui n'en est pas moins dessine dans les organismes individuels. Il est
d'ailleurs difficile d'admettre que la nature, qui a institu la vie sociale
l'extrmit de deux grandes lignes d'volution aboutissant respectivement
l'hymnoptre et l'homme, ait rgl par avance tous les dtails de l'activit
de chaque fourmi dans la fourmilire et nglig de donner l'homme des
directives, au moins gnrales, pour la coordination de sa conduite celle de
ses semblables. Les socits humaines diffrent sans doute des socits
d'insectes en ce qu'elles laissent indtermines les dmarches de l'individu,
comme d'ailleurs celles de la collectivit. Mais cela revient dire que ce sont
les actions qui sont prformes dans la nature de l'insecte, et que c'est la
fonction seulement qui l'est chez l'homme. La fonction n'en est pas moins l,
organise dans l'individu pour qu'elle s'exerce dans la socit. Comment alors
y aurait-il une mentalit sociale survenant par surcrot, et capable de dconcerter la mentalit individuelle ? Comment la premire ne serait-elle pas
immanente la seconde ? Le problme que nous posions, et qui est de savoir
comment des superstitions absurdes ont pu et peuvent encore gouverner la vie
d'tres raisonnables, subsiste donc tout entier. Nous disions qu'on a beau
parler de mentalit primitive, le problme n'en concerne pas moins la psychologie de l'homme actuel. Nous ajouterons qu'on a beau parler de reprsentations collectives, la question ne s'en pose pas moins la psychologie de
l'homme individuel.
Mais, justement, la difficult ne tiendrait-elle pas d'abord ce que notre
psychologie ne se soucie pas assez de subdiviser son objet selon les lignes
marques par la nature ? Les reprsentations qui engendrent des superstitions
ont pour caractre commun d'tre fantasmatiques. La psychologie les rapporte
une facult gnrale, l'imagination. Sous la mme rubrique elle classera
d'ailleurs les dcouvertes et les inventions de la science, les ralisations de
l'art. Mais pourquoi grouper ensemble des choses aussi diffrentes, leur
donner le mme nom, et suggrer ainsi l'ide d'une parent entre elles ? C'est
uniquement pour la commodit du langage, et pour la raison toute ngative
que ces diverses oprations ne sont ni perception, ni mmoire, ni travail
logique de l'esprit. Convenons alors de mettre part les reprsentations
fantasmatiques, et appelons fabulation ou fiction l'acte qui les fait
surgir. Ce sera un premier pas vers la solution du problme. Remarquons
maintenant que la psychologie, quand elle dcompose l'activit de l'esprit en
oprations, ne s'occupe pas assez de savoir quoi sert chacune d'elles : c'est
justement pourquoi la subdivision est trop souvent insuffisante ou artificielle.
L'homme peut sans doute rver ou philosopher, mais il doit vivre d'abord ; nul
doute que notre structure psychologique ne tienne la ncessit de conserver
et de dvelopper la vie individuelle et sociale. Si la psychologie ne se rgle
pas sur cette considration, elle dformera ncessairement son objet. Que
dirait-on du savant qui ferait l'anatomie des organes et l'histologie des tissus,
sans se proccuper de leur destination ? Il risquerait de diviser faux, de
grouper faux. Si la fonction ne se comprend que par la structure, on ne peut
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
59
dmler les grandes lignes de la structure sans une ide de la fonction. Il ne
faut donc pas traiter l'esprit comme s'il tait ce qu'il est pour rien, pour le
plaisir . Il ne faut pas dire : sa structure tant telle, il en a tir tel parti. Le
parti qu'il en tirera est au contraire ce qui a d dterminer sa structure ; en tout
cas, le fil conducteur de la recherche est l. Considrons alors, dans le
domaine vaguement et sans doute artificiellement dlimit de l' imagination , la dcoupure naturelle que nous avons appele fabulation, et voyons
quoi elle peut bien s'employer naturellement. De cette fonction relvent le
roman, le drame, la mythologie avec tout ce qui la prcda. Mais il n'y a pas
toujours eu des romanciers et des dramaturges, tandis que l'humanit ne s'est
jamais passe de religion. Il est donc vraisemblable que pomes et fantaisies
de tout genre sont venus par surcrot, profitant de ce que l'esprit savait faire
des fables, mais que la religion tait la raison d'tre de la fonction fabulatrice :
par rapport la religion, cette facult serait effet et non pas cause. Un besoin,
peut-tre individuel, en tout cas social, a d exiger de l'esprit ce genre d'activit. Demandons-nous quel tait le besoin. Il faut remarquer que la fiction,
quand elle a de l'efficace, est comme une hallucination naissante : elle peut
contrecarrer le jugement et le raisonnement, qui sont les facults proprement
intellectuelles. Or, qu'et fait la nature, aprs avoir cr des tres intelligents,
si elle avait voulu parer certains dangers de l'activit intellectuelle sans
compromettre l'avenir de l'intelligence ? L'observation nous fournit la rponse. Aujourd'hui, dans le plein panouissement de la science, nous voyons les
plus beaux raisonnements du monde s'crouler devant une exprience : rien ne
rsiste aux faits. Si donc l'intelligence devait tre retenue, au dbut, sur une
pente dangereuse pour l'individu et la socit, ce ne pouvait tre que par des
constatations apparentes, par des fantmes de faits : dfaut d'exprience
relle, c'est une contrefaon de l'exprience qu'il fallait susciter. Une fiction, si
l'image est vive et obsdante, pourra prcisment imiter la perception et, par
l, empcher ou modifier l'action. Une exprience systmatiquement fausse,
se dressant devant l'intelligence, pourra l'arrter au moment o elle irait trop
loin dans les consquences qu'elle tire de l'exprience vraie. Ainsi aurait donc
procd la nature. Dans ces conditions, on ne s'tonnerait pas de trouver que
l'intelligence, aussitt forme, a t envahie par la superstition, qu'un tre
essentiellement intelligent est naturellement superstitieux, et qu'il n'y a de
superstitieux que les tres intelligents.
Il est vrai qu'alors de nouvelles questions se poseront. Il faudra d'abord se
demander plus prcisment quoi sert la fonction fabulatrice, et quel danger
la nature devait parer. Sans encore approfondir ce point, remarquons que
l'esprit humain peut tre dans le vrai ou dans le faux, mais que dans un cas
comme dans l'autre, quelle que soit la direction o il s'est engag, il va droit
devant lui : de consquence en consquence, d'analyse en analyse, il s'enfonce
davantage dans l'erreur, comme il s'panouit plus compltement dans la vrit.
Nous ne connaissons qu'une humanit dj volue, car les primitifs que
nous observons aujourd'hui sont aussi vieux que nous, et les documents sur
lesquels travaille l'histoire des religions sont d'un passe relativement rcent.
L'immense varit des croyances auxquelles nous avons affaire est donc le
rsultat d'une longue prolifration. De leur absurdit ou de leur tranget on
peut sans doute conclure une certaine orientation vers l'trange ou l'absurde
dans la marche d'une certaine fonction de l'esprit ; mais ces caractres ne sont
probablement aussi accentus que parce que la marche s'est prolonge aussi
loin : ne considrer que la direction mme, on sera moins choqu de ce que
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
60
la tendance a d'irrationnel et l'on en saisira peut-tre l'utilit. Qui sait mme si
les erreurs o elle a abouti ne sont pas les dformations, alors avantageuses
l'espce, d'une vrit qui devait apparatre plus tard certains individus ? Mais
ce n'est pas tout. Une seconde question se pose, laquelle il faudra mme
rpondre auparavant : d'o vient cette tendance ? Se rattache-t-elle d'autres
manifestations de la vie ? Nous parlions d'une intention de la nature . c'tait
une mtaphore, commode en psychologie comme elle l'est en biologie ; nous
marquions ainsi que le dispositif observ sert l'intrt de l'individu ou de
l'espce. Mais l'expression est vague, et nous dirions, pour plus de prcision,
que la tendance considre est un instinct, si ce n'tait justement la place
d'un instinct que surgissent dans l'esprit ces images fantasmatiques. Elles
jouent un rle qui aurait pu tre dvolu l'instinct et qui le serait, sans doute,
chez un tre dpourvu d'intelligence. Disons provisoirement que c'est de
l'instinct virtuel, entendant par l qu' l'extrmit d'une autre ligne d'volution,
dans les socits d'insectes, nous voyons l'instinct provoquer mcaniquement
une conduite comparable, pour son utilit, celle que suggrent l'homme,
intelligent et libre, des images quasi hallucinatoires. Mais voquer ainsi des
dveloppements divergents et complmentaires qui aboutiraient d'un ct
des instincts rels et, de l'autre, des instincts virtuels, n'est-ce pas se
prononcer sur l'volution de la vie ?
Tel est en effet le problme plus vaste que notre seconde question pose. Il
tait d'ailleurs implicitement contenu dans la premire. Comment rapporter
un besoin vital les fictions qui se dressent devant l'intelligence, et parfois
contre elle, si l'on n'a pas dtermin les exigences fondamentales de la vie ?
Ce mme problme, nous le retrouverons, plus explicite, quand surgira une
question que nous ne pourrons pas viter : comment la religion a-t-elle
survcu au danger qui la fit natre ? Comment, au lieu de disparatre, s'est-elle
simplement transforme ? Pourquoi subsiste-t-elle, alors que la science est
venue combler le vide, dangereux en effet, que l'intelligence laissait entre sa
forme et sa matire ? Ne serait-ce pas qu'au-dessous du besoin de stabilit que
la vie manifeste, dans cet arrt ou plutt dans ce tournoiement sur place qu'est
la conservation d'une espce, il y a quelque exigence d'un mouvement en
avant, un reste de pousse, un lan vital ? Mais les deux premires questions
suffiront pour le moment. L'une et l'autre nous ramnent aux considrations
que nous avons prsentes autrefois sur l'volution de la vie. Ces considrations n'taient nullement hypothtiques, comme certains ont paru le croire.
En parlant d'un lan vital et d'une volution cratrice, nous serrions
l'exprience d'aussi prs que nous le pouvions. On commence s'en apercevoir, puisque la science positive, par le seul fait d'abandonner certaines thses
ou de les donner pour de simples hypothses, se rapproche davantage de nos
vues. En se les appropriant, elle ne ferait que reprendre son bien.
Revenons donc sur quelques-uns des traits saillants de la vie, et marquons
le caractre nettement empirique de la conception d'un lan vital . Le
phnomne vital est-il rsoluble. disions-nous, en faits physiques et
chimiques ? Quand le physiologiste l'affirme, il entend par l, consciemment
ou inconsciemment, que le rle de la physiologie est de rechercher ce qu'il y a
de physique et de chimique dans le vital, qu'on ne saurait assigner d'avance un
terme cette recherche, et que ds lors il faudra procder comme si la
recherche ne devait pas avoir de terme : ainsi seulement on ira de l'avant. Il
pose donc une rgle de mthode ; il n'nonce pas un fait. Tenons-nous en
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
61
alors l'exprience : nous dirons - et plus d'un biologiste le reconnat - que la
science est aussi loin que jamais d'une explication physico-chimique de la vie.
C'est ce que nous constations d'abord quand nous parlions d'un lan vital. Maintenant, la vie une fois pose, comment s'en reprsenter l'volution ? On
peut soutenir que le passage d'une espce l'autre s'est fait par une srie de
petites variations, toutes accidentelles, conserves par la slection et fixes
par l'hrdit. Mais si l'on songe au nombre norme de variations, coordonnes entre elles et complmentaires les unes des autres, qui doivent se
produire pour que l'organisme en profite ou mme simplement pour qu'il n'en
prouve aucun dommage, on se demande comment chacune d'elles, prise
part, se conservera par slection et attendra celles qui la complteraient. Toute
seule, elle ne sert le plus souvent rien ; elle peut mme gner ou paralyser la
fonction. En invoquant donc une composition du hasard avec le hasard, en
n'attribuant aucune cause spciale la direction prise par la vie qui volue, on
applique a priori le principe d'conomie qui se recommande la science
positive, mais on ne constate nullement un fait, et l'on vient tout de suite buter
contre d'insurmontables difficults. Cette insuffisance du darwinisme est le
second point que nous marquions quand nous parlions d'un lan vital : la
thorie nous opposions un fait ; nous constations que l'volution de la vie
s'accomplit dans des directions dtermines. - Maintenant, ces directions sontelles imprimes la vie par les conditions o elle volue ? Il faudrait admettre
alors que les modifications subies par l'individu passent ses descendants,
tout au moins assez rgulirement pour assurer par exemple la complication
graduelle d'un organe accomplissant de plus en plus dlicatement la mme
fonction. Mais l'hrdit de l'acquis est contestable et, supposer qu'elle
s'observe jamais, exceptionnelle ; c'est encore a priori, et pour les besoins de
la cause, qu'on la fait fonctionner avec cette rgularit. Reportons l'inn
cette transmissibilit rgulire - nous nous conformerons l'exprience, et
nous dirons que ce n'est pas l'action mcanique des causes extrieures, que
c'est une pousse interne, passant de germe germe travers les individus,
qui porte la vie, dans une direction donne, une complication de plus en plus
haute. Telle est la troisime ide qu'voquera l'image de l'lan vital. - Allons
plus loin. Quand on parle du progrs d'un organisme ou d'un organe s'adaptant
des conditions plus complexes, on veut le plus souvent que la complexit
des conditions impose sa forme la vie, comme le moule au pltre : cette
condition seulement, se dit-on, on aura une explication mcanique, et par
consquent scientifique. Mais, aprs s'tre donn la satisfaction d'interprter
ainsi l'adaptation en gnral, on raisonne dans les cas particuliers comme si
l'adaptation tait tout autre chose, - ce qu'elle est en effet, - la solution
originale, trouve par la vie, du problme que lui posent les conditions extrieures. Et cette facult de rsoudre des problmes, on la laisse inexplique.
En faisant alors intervenir un lan , nous ne donnions pas davantage,
l'explication ; mais nous signalions, au lieu de l'exclure systmatiquement en
gnral pour l'admettre et l'utiliser subrepticement dans chaque cas particulier,
ce caractre mystrieux de l'opration de la vie. - Mais ne faisions-nous rien
pour percer le mystre? Si la merveilleuse coordination des parties au tout ne
peut pas s'expliquer mcaniquement, elle n'exige pas non plus, selon nous,
qu'on la traite comme de la finalit. Ce qui, vu du dehors, est dcomposable
en une infinit de parties coordonnes les unes aux autres, apparatrait peuttre du dedans comme un acte simple : tel, un mouvement de notre main, que
nous sentons indivisible, sera peru extrieurement comme une courbe
dfinissable par une quation, c'est--dire comme une juxtaposition de points,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
62
en nombre infini, qui tous satisfont une mme loi. En voquant l'image d'un
lan, nous voulions suggrer cette cinquime ide, et mme quelque chose de
plus : l o notre analyse, qui reste dehors, dcouvre des lments positifs en
nombre de plus en plus grand que nous trouvons, par l mme, de plus en plus
tonnamment coordonns les uns aux autres, une intuition qui se transporterait
au dedans saisirait, non plus des moyens combins, mais des obstacles
tourns. Une main invisible, traversant brusquement de la limaille de fer, ne
ferait qu'carter de la rsistance, mais la simplicit mme de cet acte, vue du
ct rsistance, apparatrait comme la juxtaposition, effectue dans un ordre
dtermin, des brins de limaille. - Maintenant, ne peut-on rien dire de cet acte,
et de la rsistance qu'il rencontre ? Si la vie n'est pas rsoluble en faits physiques et chimiques, elle agit la manire d'une cause spciale, surajoute ce
que nous appelons ordinairement matire : cette matire est instrument, et elle
est aussi obstacle. Elle divise ce qu'elle prcise. Nous pouvons conjecturer
qu' une division de ce genre est due la multiplicit des grandes lignes
d'volution vitale. Mais pair l nous est suggr un moyen de prparer et de
vrifier l'intuition que nous voudrions avoir de la vie. Si nous voyons deux ou
trois grandes lignes d'volution se continuer librement ct de voies qui
finissent en impasse, et si, le long de ces lignes, se dveloppe de plus en plus
un caractre essentiel, nous pouvons conjecturer que la pousse vitale
prsentait d'abord ces caractres l'tat d'implication rciproque : instinct et
intelligence, qui atteignent leur point culminant aux extrmits des deux
principales lignes de l'volution animale, devront ainsi tre pris l'un dans
l'autre, avant leur ddoublement, non pas composs ensemble mais constitutifs d'une ralit simple sur laquelle intelligence et instinct ne seraient que
des points de vue. Telles sont, puisque nous avons commenc les numroter,
la sixime, la septime et la huitime reprsentations qu'voquera l'ide d'un
lan vital. - Encore n'avons-nous mentionn qu'implicitement l'essentiel :
l'imprvisibilit des formes que la vie cre de toutes pices, par des sauts dis.
continus, le long de son volution. Qu'on se place dans la doctrine du pur
mcanisme ou dans celle de la finalit pure, dans les deux cas les crations de
la vie sont prdtermines, l'avenir pouvant se dduire du prsent par un
calcul ou s'y dessinant sous forme d'ide, le temps tant par consquent sans
efficace. L'exprience pure ne suggre rien de semblable. Ni impulsion ni
attraction, semble-t-elle dire. Un lan peut prcisment suggrer quelque
chose de ce genre et faire penser aussi, par l'indivisibilit de ce qui en est
intrieurement senti et la divisibilit l'infini de ce qui en est extrieurement
peru, cette dure relle, efficace, qui est l'attribut essentiel de la vie. Telles taient les ides que nous enfermions dans l'image de l' lan vital .
les ngliger, comme on l'a fait trop souvent, on se trouve naturellement devant
un concept vide, comme celui du pur vouloir-vivre , et devant une mtaphysique strile. Si l'on tient compte d'elles, on a une ide charge de matire,
empiriquement obtenue, capable d'orienter la recherche, qui rsumera en gros
ce que nous savons du processus vital et qui marquera aussi ce que nous en
ignorons.
Ainsi envisage, l'volution apparat comme s'accomplissant par sauts
brusques, et la variation constitutive de l'espce nouvelle comme faite de
diffrences multiples, complmentaires les unes des autres, qui surgissent
globalement dans l'organisme issu du germe. C'est, pour reprendre notre
comparaison, un mouvement soudain de la main plonge dans la limaille et
qui provoque un rarrangement immdiat de tous les brins de fer. Si d'ailleurs
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
63
la transformation s'opre chez divers reprsentants d'une mme espce, elle
peut ne pas obtenir chez tous le mme succs. Rien ne dit que l'apparition de
l'espce humaine n'ait pas t due plusieurs sauts de mme direction
s'accomplissant et l dans une espce antrieure et aboutissant ainsi des
spcimens d'humanit assez diffrents ; chacun d'eux correspondrait une
tentative qui a russi, en ce sens que les variations multiples qui caractrisent
chacun d'eux sont parfaitement coordonnes les unes aux autres ; mais tous ne
se valent peut-tre pas, les sauts n'ayant pas franchi dans tous les cas la mme
distance. Ils n'en avaient pas moins la mme direction. On pourrait dire, en
vitant d'attribuer au mot un sens anthropomorphique, qu'ils correspondent
une mme intention de la vie.
Que d'ailleurs l'espce humaine soit sortie ou non d'une souche unique,
qu'il y ait un ou plusieurs spcimens irrductibles d'humanit, peu importe :
l'homme prsente toujours deux traits essentiels, l'intelligence et la sociabilit.
Mais, du point de vue o nous nous plaons, ces caractres prennent une
signification spciale. Ils n'intressent plus seulement le psychologue et le
sociologue. Ils appellent d'abord une interprtation biologique. Intelligence et
sociabilit doivent tre replaces dans l'volution gnrale de la vie.
Pour commencer par la sociabilit, nous la trouvons sous sa forme acheve
aux deux points culminants de l'volution, chez les insectes 'hymnoptres
tels que la fourmi et l'abeille, et chez l'homme. A l'tat de simple tendance,
elle est partout dans la rature. On a pu dire que l'individu tait dj une
socit : des protozoaires, forms d'une cellule unique, auraient constitu des
agrgats, lesquels, se rapprochant leur tour, auraient donn des agrgats
d'agrgats ; les organismes les plus diffrencis auraient ainsi leur origine
dans l'association d'organismes peine diffrencis et lmentaires. Il y a l
une exagration vidente ; le polyzosme est un fait exceptionnel et anormal. Mais il n'en est pas moins vrai que les choses se passent dans un
organisme suprieur comme si des cellules s'taient associes pour se partager
entre elles le travail. La hantise de la forme sociale, qu'on trouve dans un si
grand nombre d'espces, se rvle donc jusque dans la structure des individus.
Mais, encore une fois, ce n'est l qu'une tendance ; et si l'on veut avoir affaire
des socits acheves, organisations nettes d'individualits distinctes, il faut
prendre les deux types parfaits d'association que reprsentent une socit
d'insectes et une socit humaine, celle-l immuable 1 et celle-ci changeante,
l'une instinctive et l'autre intelligente, la premire comparable un organisme
dont les lments n'existent qu'en vue du tout, la seconde laissant tant de
marge aux individus qu'on ne sait si elle est faite pour eux ou s'ils sont faits
pour elle. Des deux conditions poses par Comte, ordre et progrs ,
l'insecte n'a voulu que l'ordre, tandis que c'est le progrs, parfois exclusif de
l'ordre et toujours d des initiatives individuelles, que vise une partie au
moins de l'humanit. Ces deux types achevs de vie sociale se font donc
pendant et se compltent. Mais on en dirait autant de l'instinct et de
l'intelligence, qui les caractrisent respectivement. Replacs dans l'volution
de la vie, ils apparaissent comme deux activits divergentes et complmentaires.
Il va sans dire que l'immutabilit n'est pas absolue, mais essentielle. Elle existe en
principe, mais elle admet cri fait des variations sur le thme une fois pos.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
64
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons expose dans un travail
antrieur. Rappelons seulement que la vie est un certain effort pour obtenir
certaines choses de la matire brute, et qu'instinct et intelligence, pris l'tat
achev, sont deux moyens d'utiliser cet effet un outil dans le premier cas,
l'outil fait partie de l'tre vivant dans l'autre, c'est un instrument inorganique,
qu'il a fallu inventer, fabriquer, apprendre manier. Posez l'utilisation, plus
forte raison la fabrication, plus forte raison encore l'invention, vous retrouverez un un tous les lments de l'intelligence, car sa destination explique sa
structure. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste une frange d'instinct autour de
l'intelligence, et que des lueurs d'intelligence subsistent au fond de l'instinct.
On peut conjecturer qu'ils commencrent par tre impliqus l'un dans l'autre,
et que, si l'on remontait assez haut dans le pass, on trouverait des instincts
plus rapprochs de l'intelligence que ceux de nos insectes, une intelligence
plus voisine de l'instinct que celle de nos vertbrs. Les deux activits, qui se
compntraient; d'abord, ont d se dissocier pour grandir ; mais quelque chose
de l'une est demeur adhrent l'autre. On en dirait d'ailleurs autant de toutes
les grandes manifestations de la vie. Chacune d'elles prsente le plus souvent
l'tat rudimentaire, ou latent, ou virtuel, les caractres essentiels de la
plupart des autres manifestations.
En tudiant alors, au terme d'un des grands efforts de la nature, ces
groupements d'tres essentiellement intelligents et partiellement libres que
sont les socits humaines, nous ne devrons pas perdre de vue l'autre point
terminus de l'volution, les socits rgies par le pur instinct, o l'individu sert
aveuglment l'intrt de la communaut. Cette comparaison n'autorisera
jamais des conclusions fermes ; mais elle pourra suggrer des interprtations.
Si des socits se rencontrent aux deux termes principaux du mouvement
volutif, et si l'organisme individuel est construit sur un plan qui annonce
celui des socits, c'est que la vie est coordination et hirarchie d'lments
entre lesquels le travail se divise : le social est au fond du vital. Si, dans ces
socits que sont dj les organismes individuels, l'lment doit tre prt se
sacrifier au tout, s'il en est encore ainsi dans ces socits de socits que
constituent, au bout de l'une des deux grandes lignes de l'volution, la ruche et
la fourmilire, si enfin ce rsultat s'obtient par l'instinct, qui n'est que le
prolongement du travail organisateur de la nature, c'est que la nature se
proccupe de la socit plutt que de l'individu. S'il n'en est plus de mme
chez l'homme, c'est que l'effort d'invention qui se manifeste dans tout le
domaine de la vie par la cration d'espces nouvelles a trouv dans l'humanit
seulement le moyen de se continuer par des individus auxquels est dvolue
alors, avec l'intelligence, la facult d'initiative, l'indpendance, la libert. Si
l'intelligence menace maintenant de rompre sur certains points la cohsion
sociale, et si la socit doit subsister, il faut que, sur ces points, il y ait
l'intelligence un contrepoids. Si ce contrepoids ne peut pas tre l'instinct luimme, puisque sa place est justement prise par l'intelligence, il faut qu'une
virtualit d'instinct ou, si l'on aime mieux, le rsidu d'instinct qui subsiste
autour de l'intelligence, produise le mme effet : il ne peut agir directement,
mais puisque l'intelligence travaille sur des reprsentations, il en suscitera
d' imaginaires qui tiendront tte la reprsentation du rel et qui russiront, par l'intermdiaire de l'intelligence mme, contrecarrer le travail
intellectuel. Ainsi s'expliquerait la fonction fabulatrice. Si d'ailleurs elle joue
un rle social, elle doit servir aussi l'individu, que la socit a le plus souvent
intrt mnager. On peut donc prsumer que, sous sa forme lmentaire et
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
65
originelle, elle apporte l'individu lui-mme un surcrot de force. Mais avant
d'arriver ce second point, considrons le premier.
Parmi les observations recueillies par la science psychique , nous
avions jadis not le fait suivant. Une dame se trouvait l'tage suprieur d'un
htel. Voulant descendre, elle s'engagea sur le palier. La barrire destine
fermer la cage de l'ascenseur tait justement ouverte. Cette barrire ne devant
s'ouvrir que si l'ascenseur est arrt l'tage, elle crut naturellement que
l'ascenseur tait l, et se prcipita pour le prendre. Brusquement elle se sentit
rejeter en arrire : l'homme charg de manuvrer l'appareil venait de se montrer, et la repoussait sur le palier. A ce moment elle sortit de sa distraction.
Elle constata, stupfaite, qu'il n'y avait ni homme ni appareil. Le mcanisme
s'tant drang, la barrire avait pu s'ouvrir l'tage o elle tait, alors que
l'ascenseur tait rest en bas. C'est dans le vide qu'elle allait se prcipiter : une
hallucination miraculeuse lui avait sauv la vie. Est-il besoin de dire que le
miracle s'explique aisment ? La dame avait raisonn juste sur un fait rel, car
la barrire tait effectivement ouverte et par consquent l'ascenseur aurait d
tre l'tage. Seule, la perception de la cage vide l'et tire de son erreur ;
mais cette perception serait arrive trop lard, l'acte conscutif au raisonnement
juste tant dj commenc. Alors avait surgi la personnalit instinctive,
somnambulique, sous-jacente celle qui raisonne. Elle avait aperu le danger.
Il fallait agir tout de suite. Instantanment elle avait rejet le corps en arrire,
faisant jaillir du mme coup la perception fictive, hallucinatoire, qui pouvait
le mieux provoquer et expliquer le mouvement en apparence injustifi.
Imaginons alors une humanit primitive et des socits rudimentaires.
Pour assurer ces groupements la cohsion voulue, la nature disposerait d'un
moyen bien simple : elle n'aurait qu' doter l'homme d'instincts appropris.
Ainsi fit-elle pour la ruche et pour la fourmilire. Son succs fut d'ailleurs
complet : les individus ne vivent ici que pour la communaut. Et son travail
fut facile, puisqu'elle n'eut qu' suivre sa mthode habituelle : l'instinct est en
effet coextensif la vie, et l'instinct social, tel qu'on le trouve chez l'insecte,
n'est que l'esprit de subordination et de coordination qui anime les cellules,
tissus et organes de tout corps vivant. Mais c'est un panouissement de
l'intelligence, et non plus un dveloppement de l'instinct, que tend la
pousse vitale dans la srie des vertbrs. Quand le terme du mouvement est
atteint chez l'homme, l'instinct n'est pas supprim, mais il est clips; il ne
reste de lui qu'une lueur vague autour du noyau, pleinement clair on plutt
lumineux, qu'est l'intelligence. Dsormais la rflexion permettra l'individu
d'inventer, la socit de progresser. Mais, pour que la socit progresse,
encore faut-il qu'elle subsiste. Invention signifie initiative, et un appel
l'initiative individuelle risque dj de compromettre la discipline sociale. Que
sera-ce, si l'individu dtourne sa rflexion de l'objet pour lequel elle est faite,
je veux dire de la tche accomplir, perfectionner, rnover, pour la diriger
sur lui-mme, sur la gne que la vie sociale lui impose, sur le sacrifice qu'il
fait la communaut ? Livr l'instinct, comme la fourmi ou l'abeille, il ft
rest tendu sur la fin extrieure atteindre ; il et travaill pour l'espce,
automatiquement, somnambuliquement. Dot d'intelligence, veill la
rflexion, il se tournera vers lui-mme et ne pensera qu' vivre agrablement.
Sans doute un raisonnement en forme lui dmontrerait qu'il est de son intrt
de promouvoir le bonheur d'autrui ; mais il faut des sicles de culture pour
produire un utilitaire comme Stuart Mill, et Stuart Mill n'a pas convaincu tous
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
66
les philosophes, encore moins le commun des hommes. La vrit est que
l'intelligence conseillera d'abord l'gosme. C'est de ce ct que l'tre intelligent se prcipitera si rien ne l'arrte. Mais la nature veille. Tout l'heure,
devant la barrire ouverte, un gardien avait surgi, qui interdisait l'entre et
repoussait le contrevenant. Ici ce sera un dieu protecteur de la cit, lequel
dfendra, menacera, rprimera. L'intelligence se rgle en effet sur des
perceptions prsentes ou sur ces rsidus plus ou moins imags de perceptions
qu'on appelle les souvenirs. Puisque l'instinct n'existe plus qu' l'tat de trace
ou de virtualit, puisqu'il n'est pas assez fort pour provoquer des actes ou pour
les empcher, il devra susciter une perception illusoire ou tout au moins une
contrefaon de souvenir assez prcise, assez frappante, pour que l'intelligence
se dtermine par elle. Envisage de ce premier point de vue, la religion est
donc une raction dfensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de
l'intelligence.
Mais nous n'obtenons ainsi qu'une figuration stylise de ce qui se passe
effectivement. Pour plus de clart, nous avons suppose dans la socit une
brusque rvolte de l'individu, et dans l'imagination individuelle la soudaine
apparition d'un dieu qui empche ou qui dfend. Les choses prennent sans
doute cette forme dramatique, un moment donn et pour un certain temps,
dans une humanit dj avance sur la route de la civilisation. Mais la ralit
n'volue vers la prcision du drame que par l'intensification de l'essentiel et
par l'limination du surabondant. En fait, dans les groupements humains tels
qu'ils ont pu sortir des mains de la nature, la distinction entre ce qui importe et
ce qui n'importe pas la cohsion du groupe n'est pas aussi nette, les consquences d'un acte accompli par l'individu ne paraissent pas aussi strictement
individuelles, la force d'inhibition qui surgit au moment o l'acte va
s'accomplir ne s'incarne pas aussi compltement dans une personne. Arrtonsnous sur ces trois points.
Dans des socits telles que les ntres, il y a des coutumes et il y a des
lois. Sans doute les lois sont souvent des coutumes consolides ; mais une
coutume ne se transforme en loi que lorsqu'elle prsente un intrt dfini,
reconnu et formulable ; elle tranche ds lors sur les autres. La distinction est
donc nette entre l'essentiel et l'accidentel : il y a d'un ct ce qui est simplement usage, de l'autre ce qui est obligation lgale et mme morale. Il ne peut
pas en tre ainsi dans des socits moins volues qui n'ont que des coutumes,
les unes justifies par un besoin rel, la plupart dues au simple hasard ou
une extension irrflchie des premires. Ici tout ce qui est usuel est ncessairement obligatoire, puisque la solidarit sociale, n'tant pas condense dans
des lois, l'tant encore moins dans des principes, se diffuse sur la commune
acceptation des usages. Tout ce qui est habituel aux membres du groupe, tout
ce que la socit attend des individus, devra donc prendre un caractre religieux, s'il est vrai que par l'observation de la coutume, et par elle seulement,
l'homme est attach aux autres hommes et dtach ainsi de lui-mme. Soit dit
en passant, la question des rapports de la morale avec la religion se simplifie
ainsi beaucoup quand on considre les socits rudimentaires. Les religions
primitives ne Peuvent tre dites immorales, ou indiffrentes la morale, que
si l'on prend la religion telle qu'elle fut d'abord, pour la comparer la morale
telle qu'elle est devenue plus tard. A l'origine, la coutume est toute la morale ;
et comme la religion interdit de s'en carter, la morale est coextensive la
religion. En vain donc on nous objecterait que les interdictions religieuses
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
67
n'ont pas toujours concern ce qui nous apparat aujourd'hui comme immoral
ou comme antisocial. La religion primitive, vue par le ct que nous envisageons d'abord, est une prcaution contre le danger que l'on court, ds qu'on
pense, de ne penser qu' soi. C'est donc bien une raction dfensive de la
nature contre l'intelligence.
D'autre part, l'ide de responsabilit individuelle est loin d'tre aussi simple qu'on pourrait le croire. Elle implique une reprsentation relativement
abstraite de l'activit de l'individu, que l'on tient pour indpendante parce
qu'on l'a isole de l'activit sociale. Mais telle est d'abord la solidarit entre les
membres du groupe que tous doivent se sentir participer dans une certaine
mesure la dfaillance d'un seul, au moins dans les cas qu'ils tiennent pour
graves : le mal moral, si l'on peut dj employer ce terme, fait l'effet d'un mal
physique qui s'tendrait de proche en proche et affecterait la socit entire,
par contamination. Si donc une puissance vengeresse surgit, ce sera pour
frapper la socit dans son ensemble, sans s'appesantir uniquement sur le
point d'o le mal tait parti : le tableau de la Justice poursuivant le coupable
est relativement moderne, et nous avons trop simplifi les choses en montrant
l'individu arrt, au moment de rompre le lien social, par la crainte religieuse
d'un chtiment qu'il serait seul subir. Il n'en est pas moins vrai que les
choses tendent prendre cette forme, et qu'elles la prendront de plus en plus
explicitement mesure que la religion, fixant ses propres contours, deviendra
plus franchement mythologique. Le mythe portera d'ailleurs toujours la trace
de ses origines ; jamais il ne distinguera compltement entre l'ordre physique
et l'ordre moral ou social, entre la rgularit voulue, qui vient de l'obissance
de tous une loi, et celle que manifeste le cours de la nature. Thmis, desse
de la justice humaine, est la mre des Saisons (Hrai) et de Dik, qui
reprsente aussi bien la loi physique que la loi morale. De cette confusion
nous sommes peine librs aujourd'hui; la trace en subsiste dans notre
langage. Murs et morale, rgle au sens de constance et rgle au sens
d'impratif : l'universalit de fait et l'universalit de droit s'expriment peu
prs de la mme manire. Le mot ordre ne signifie-t-il pas, tout la fois,
arrangement et commandement ?
Enfin nous parlions d'un dieu qui surgirait pour interdire, prvenir ou
punir. La force morale d'o part la rsistance, et au besoin la vengeance,
s'incarnerait donc dans une personne. Qu'elle tende bien ainsi, tout naturellement, prendre aux yeux de l'homme une forme humaine, cela n'est pas
douteux ; mais, si la mythologie est un produit de la nature, c'en est le produit
tardif, comme la plante fleurs, et les dbuts de la religion ont t plus
modestes. Un examen attentif de ce qui se passe dans notre conscience nous
montre qu'une rsistance intentionnelle, et mme une vengeance, nous apparaissent d'abord comme des entits qui se suffisent; s'entourer d'un corps
dfini, comme celui d'une divinit vigilante et vengeresse, est dj pour elles
un luxe ; la fonction fabulatrice de l'esprit ne s'exerce sans doute avec un
plaisir d'art que sur des reprsentations ainsi vtues, mais elle ne les forme pas
du premier coup; elle les prend d'abord toutes nues. Nous aurons nous
appesantir sur ce point, qui n'a pas suffisamment attir l'attention des psychologues. Il n'est pas dmontr que l'enfant qui s'est cogn une table, et qui lui
rend le coup reu d'elle, voie en elle une personne. Il s'en faut d'ailleurs que
tous les psychologues acceptent aujourd'hui cette interprtation. Mais, aprs
avoir trop concd ici l'explication mythologique, ils ne vont pas assez loin
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
68
maintenant quand ils supposent que l'enfant cde simplement un besoin de
frapper que susciterait la colre. La vrit est qu'entre l'assimilation de la table
une personne, et la perception de la table comme chose inerte, il y a une
reprsentation intermdiaire qui n'est ni celle d'une chose ni celle d'une personne : c'est l'image de l'acte qu'accomplit la table en cognant, ou mieux
l'image de l'acte de cogner amenant avec lui -comme un bagage qu'il porterait
sur le dos - la table qui est derrire. L'acte de cogner est un lment de
personnalit, mais non pas encore une personnalit complte. L'escrimeux qui
voit arriver sur lui la pointe de son adversaire sait bien que c'est le mouvement
de la pointe qui a entran l'pe, l'pe qui a tir avec elle le bras, le bras qui
a allong le corps en s'allongeant lui-mme : on -ne se fend comme il faut, et
l'on ne sait porter un coup droit, que du jour o l'on sent ainsi les choses. Les
placer dans l'ordre inverse est reconstruire et par consquent philosopher ; en
tout cas c'est expliciter l'implicite, au lieu de s'en tenir aux exigences de
l'action pure, ce qui est immdiatement donn et vritablement primitif. Quand nous lisons sur un criteau Dfense de passer , nous percevons
l'interdiction d'abord ; elle est en pleine lumire ; derrire elle seulement il y a
dans la pnombre, vaguement imagin, le garde qui dressera procs-verbal.
Ainsi les interdictions qui protgent l'ordre social sont d'abord lances en
avant, telles quelles ; ce sont dj, il est vrai, plus que de simples formules; ce
sont des rsistances, des pressions et des pousses ; mais la divinit qui
interdit, et qui tait masque par elles, n'apparatra que plus tard, mesure que
se compltera le travail de la fonction fabulatrice. Ne nous tonnons donc pas
de rencontrer chez les non-civiliss des interdictions qui sont des rsistances
semi-physiques et semi-morales certains actes individuels : l'objet qui
occupe le centre d'un champ de rsistance sera dit, tout la fois, sacr et
dangereux , quand se seront constitues ces deux notions prcises, quand la
distinction sera nette entre une force de rpulsion physique et une inhibition
morale ; jusque-l il possde les deux proprits fondues en une seule ; il est
tabou, pour employer le terme polynsien que la science des religions nous a
rendu familier. L'humanit primitive a-t-elle conu le tabou de la mme
manire que les primitifs d'aujourd'hui ? Entendons-nous d'abord sur le
sens des mots. Il n'y aurait pas d'humanit primitive si les espces s'taient
formes par transitions insensibles aucun moment prcis l'homme n'aurait
merg de l'animalit ; mais c'est l une hypothse arbitraire, qui se heurte
tant d'invraisemblances et repose sur de telles quivoques que nous la croyons
insoutenable 1 ; suivre le fil conducteur des faits et des analogies, on arrive
bien plutt une volution discontinue, qui procde par sauts, obtenant
chaque arrt une combinaison parfaite en son genre, comparable aux figures
qui se succdent quand on tourne un kalidoscope ; il y a donc bien un type
d'humanit primitive, encore que l'espce humaine ait pu se constituer par
plusieurs sauts convergents accomplis de divers points et n'arrivant pas tous
aussi prs de la ralisation du type. D'autre part, l'me primitive nous chapperait compltement aujourd'hui s'il y avait eu transmission hrditaire des
habitudes acquises. Notre nature morale, prise l'tat brut, diffrerait alors
radicalement de celle de nos plus lointains anctres. Mais c'est encore sous
l'influence d'ides prconues, et pour satisfaire aux exigences d'une thorie,
qu'on parle d'habitudes hrditaires et surtout qu'on croit la transmission assez
rgulire pour oprer une transformation. La vrit est que, si la civilisation a
profondment modifi l'homme, c'est en accumulant dans le milieu social,
1
Voir L'volution cratrice, principalement les deux premiers chapitres.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
69
comme dans un rservoir, des habitudes et des connaissances que la socit
verse dans l'individu chaque gnration nouvelle. Grattons la surface, effaons ce qui nous vient d'une ducation de tous les instants : nous retrouverons
au fond de nous, ou peu s'en faut, l'humanit primitive. De cette humanit, les
primitifs que nous observons aujourd'hui nous offrent-ils l'image ? Ce
n'est pas probable, puisque la nature est recouverte, chez eux aussi, d'une
couche d'habitudes que le milieu social a conserves pour les dposer en
chaque individu. Mais il y a lieu de croire que cette couche est moins paisse
que chez l'homme civilis, et qu'elle laisse davantage transparatre la nature.
La multiplication des habitudes au cours des sicles a d en effet s'oprer chez
eux d'une manire diffrente, en surface, par un passage de l'analogue
l'analogue et sous l'influence de circonstances accidentelles, taudis que le
progrs de la technique, des connaissances, de la civilisation enfin, se fait
pendant des priodes assez longues dans un seul et mme sens, en hauteur, par
des variations qui se superposent ou s'anastomosent, aboutissant ainsi des
transformations profondes et non plus seulement des complications superficielles. Ds lors on voit dans quelle mesure nous pouvons tenir pour primitive, absolument, la notion du tabou que nous trouvons chez les primitifs
d'aujourd'hui. A supposer qu'elle ait paru telle quelle dans une humanit
sortant des mains de la nature, elle ne s'appliquait pas toutes les mmes
choses, ni probablement autant de choses. Chaque tabou devait tre une
interdiction laquelle la socit trouvait un intrt dfini. Irrationnel du point
de vue de l'individu, puisqu'il arrtait net des actes intelligents sans s'adresser
l'intelligence, il tait rationnel en tant qu'avantageux la socit et
l'espce. C'est ainsi que les relations sexuelles, par exemple, ont pu tre utilement rgles par des tabous. Mais, justement parce qu'il n'tait pas fait appel
l'intelligence individuelle et qu'il s'agissait mme de la contrecarrer, celle-ci,
s'emparant de la notion du tabou, a d en faire toute sorte d'extensions
arbitraires, par des associations d'ides accidentelles, et sans s'inquiter de ce
qu'on pourrait appeler l'intention originelle de la nature. Ainsi, supposer que
le tabou ait toujours t ce qu'il est aujourd'hui, il ne devait pas concerner un
aussi grand nombre d'objets, ni donner des applications aussi draisonnables. Mais a-t-il conserv sa forme originelle ? L'intelligence des primitifs ne
diffre pas essentiellement de la ntre ; elle doit incliner, comme la ntre,
convertir le dynamique en statique et solidifier les actions en choses. On
peut donc prsumer que, sous son influence, les interdictions se sont installes
dans les choses auxquelles elles se rapportaient : ce n'taient que des rsistances opposes des tendances, mais comme la tendance a le plus souvent un
objet, c'est de l'objet, comme si elle sigeait en lui, que la rsistance a sembl
partir, devenant ainsi un attribut de sa substance. Dans les socits stagnantes,
cette consolidation s'est faite dfinitivement. Elle a pu tre moins complte,
elle tait en tout cas temporaire, dans des socits en mouvement, o
l'intelligence finirait par apercevoir derrire l'interdiction une personne.
Nous venons d'indiquer la premire fonction de la religion, celle qui
intresse directement la conservation sociale. Arrivons l'autre. C'est pour le
bien de la socit que nous allons encore la voir travailler, mais indirectement,
en stimulant et dirigeant les activits individuelles. Son travail sera d'ailleurs
plus compliqu, et nous aurons en numrer les formes. Mais dans cette
recherche nous ne risquons pas de nous garer, parce que nous tenons le fil
conducteur. Nous devons toujours nous dire que le domaine de la vie est
essentiellement celui de l'instinct, que sur une certaine ligne d'volution l'ins-
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
70
tinct a cd une partie de sa place l'intelligence, qu'une perturbation de la vie
peut s'ensuivre et que la nature n'a d'autre ressource alors que d'opposer
l'intelligence l'intelligence. La reprsentation intellectuelle qui rtablit ainsi
l'quilibre au profit de la nature est d'ordre religieux. Commenons par le cas
le plus simple.
Les animaux ne savent pas qu'ils doivent mourir. Sans doute il en est
parmi eux qui distinguent le mort du vivant : entendons par l que la perception du mort et celle du vivant ne dterminent pas chez eux les mmes
mouvements, les mmes actes, les mmes attitudes ; cela ne veut pas dire
qu'ils aient l'ide gnrale de la mort, non plus d'ailleurs que l'ide gnrale de
la vie, non plus qu'aucune autre ide gnrale, en tant du moins que reprsente l'esprit et non pas simplement joue par le corps. Tel animal fera le
mort pour chapper un ennemi ; mais c'est nous qui dsignons ainsi son
attitude ; quant lui, il ne bouge pas parce qu'il sent qu'en remuant il attirerait
ou ranimerait l'attention, qu'il provoquerait l'agression, que le mouvement
appelle le mouvement. On a cru trouver des cas de suicide chez les animaux; a
supposer qu'on ne se soit pas tromp, la distance est grande entre faire ce qu'il
faut pour mourir et savoir qu'on en mourra ; autre chose est accomplir un acte,
mme bien combin, mme appropri, autre chose imaginer l'tat qui s'ensuivra. Mais admettons mme que l'animal ait l'ide de la mort. Il ne se
reprsente certainement pas qu'il est destine a mourir, qu'il mourra de mort
naturelle si ce n'est pas de mort violente. Il faudrait pour cela une srie
d'observations faites sur d'autres animaux, puis une synthse, enfin un travail
de gnralisation qui offre dj un caractre scientifique. A supposer que
l'animal pt esquisser un tel effort, ce serait pour quelque chose qui en valt la
peine ; or, rien ne lui serait plus inutile que de savoir qu'il doit mourir. Il a
plutt intrt l'ignorer. Mais l'homme sait qu'il mourra. Tous les autres
vivants, cramponns la vie, en adoptent simplement l'lan. S'ils ne se
pensent pas eux-mmes sub specie aeterni, leur confiance, perptuel empitement du prsent sur l'avenir, est la traduction de cette pense en sentiment.
Mais avec l'homme apparat la rflexion, et par consquent la facult
d'observer sans utilit immdiate, de comparer entre elles des observations
provisoirement dsintresses, enfin d'induire et de gnraliser. Constatant
que tout ce qui vit autour de lui finit par mourir, il est convaincu qu'il mourra
lui-mme. La nature, en le dotant d'intelligence, devait bon gr mal gr
l'amener cette conviction. Mais cette conviction vient se mettre en travers du
mouvement de la nature. Si l'lan de vie dtourne tous les autres vivants de la
reprsentation de la mort, la pense de la mort doit ralentir chez l'homme le
mouvement de la vie. Elle pourra plus tard s'encadrer dans une philosophie
qui lvera l'humanit au. dessus d'elle-mme et lui donnera plus de force
pour agir. Mais elle est d'abord dprimante, et elle le serait encore davantage
si l'homme n'ignorait, certain qu'il est de mourir, la date o il mourra.
L'vnement a beau devoir se produire : comme on constate chaque instant
qu'il ne se produit pas, l'exprience ngative continuellement rpte se
condense en un doute peine conscient qui attnue les effets de la certitude
rflchie. Il n'en est pas moins vrai que la certitude de mourir, surgissant avec
la rflexion dans un monde d'tres vivants qui tait fait pour ne penser qu'
vivre, contrarie l'intention de la nature. Celle-ci va trbucher sur l'obstacle
qu'elle se trouve avoir plac sur son propre chemin. Mais elle se redresse
aussitt. A l'ide que la mort est invitable elle oppose l'image d'une continua-
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
71
tion de la vie aprs la mort 1 ; cette image, lance par elle dans le champ de
l'intelligence o vient de s'installer l'ide, remet les choses en ordre ; la neutralisation de l'ide par l'image manifeste alors l'quilibre mme de la nature, se
retenant de glisser. Nous nous retrouvons donc devant le jeu tout particulier
d'images et d'ides qui nous a paru caractriser la religion ses origines.
Envisage de ce second point de vue, la religion est une raction dfensive de
la nature contre la reprsentation, par l'intelligence, de l'invitabilit de la
mort.
A cette raction, la socit est intresse autant que l'individu. Non pas
seulement parce qu'elle bnficie de l'effort individuel et parce que cet effort
va plus loin quand l'ide d'un terme n'en vient pas contrarier l'lan, mais
encore et surtout parce qu'elle a besoin elle-mme de stabilit et de dure. Une
socit dj civilise s'adosse des lois, des institutions, des difices
mme qui sont faits pour braver le temps ; mais les socits primitives sont
simplement bties en hommes : que deviendrait leur autorit, si l'on ne
croyait pas la persistance des individualits qui les composent ? Il importe
donc que les morts restent prsents. Plus tard viendra le culte des anctres.
Les morts se seront alors rapprochs des dieux. Mais il faudra pour cela qu'il
y ait des dieux, au moins en prparation, qu'il y ait un culte, que l'esprit se soit
franchement orient dans la direction de la mythologie. A son point de dpart,
l'intelligence se reprsente simplement les morts comme mls aux vivants,
dans une socit laquelle ils peuvent encore faire du bien et du mal.
Sous quelle forme les voit-elle se survivre ? N'oublions pas que nous
cherchons au fond de l'me, par voie d'introspection, les lments constitutifs
d'une religion primitive. Tel de ces lments a pu ne jamais se produire dehors
l'tat pur. Il aura tout de suite rencontr d'autres lments simples, de mme
origine, avec lesquels il se sera compose ; ou bien il aura t pris, soit tout
seul soit avec d'autres, pour servir de matire au travail indfiniment continu
de la fonction fabulatrice. Il existe ainsi des thmes, simples ou complexes,
fournis par la nature ; et il y a, d'autre part, mille variations excutes sur eux
par la fantaisie humaine. Aux thmes eux-mmes se rattachent sans doute les
croyances fondamentales que la science des religions retrouve a peu prs
partout. Quant aux variations sur les thmes, ce sont les mythes et mme les
conceptions thoriques qui se diversifient l'infini selon les temps et les lieux.
Il n'est pas douteux que le thme simple que nous venons d'indiquer se compose tout de suite avec d'autres pour donner, avant les mythes et les thories,
la reprsentation primitive de l'me. Mais a-t-il une forme dfinie en dehors
de cette combinaison ? Si la question se pose, c'est parce que notre ide d'une
me survivant au corps recouvre aujourd'hui l'image, prsente la conscience immdiate, d'un corps pouvant se survivre lui-mme. Cette image
n'en existe pas moins, et il suffit d'un lger effort pour la ressaisir. C'est tout
simplement l'image visuelle du corps, dgage de l'image tactile. Nous avons
pris l'habitude de considrer la premire comme insparable de la seconde,
comme un reflet ou un effet. Dans cette direction s'est effectu le progrs de la
connaissance. Pour notre science, le corps est essentiellement ce qu'il est pour
1
Il va sans dire que l'image n'est hallucinatoire que sous la forme qu'elle prend pour le
primitif. Sur la question gnrale de la survie nous nous sommes expliqu dans des
travaux antrieurs ; nous y reviendrons dans celui-ci. Voir le chap. III, pp. 279 et suiv., et
le chap. IV, pp 337-338.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
72
le toucher ; il a une forme et une dimension dtermines, indpendantes de
nous ; il occupe une certaine place dans l'espace et ne saurait en changer sans
prendre le temps d'occuper une une les positions intermdiaires ; l'image
visuelle que nous en avons serait alors une apparence, dont il faudrait toujours
corriger les variations en revenant l'image tactile ; celle-ci serait la chose
mme, et l'autre ne ferait que la signaler. Mais telle n'est pas l'impression
immdiate. Un esprit non prvenu mettra l'image visuelle et l'image tactile au
mme rang, leur attribuera la mme ralit, et les tiendra pour relativement
indpendantes l'une de l'autre. Le primitif n'a qu' se pencher sur un tang
pour y apercevoir son corps tel qu'on le voit, dgag du corps que l'on touche.
Sans doute le corps qu'il touche est galement un corps qu'il voit : cela prouve
que la pellicule superficielle du corps, laquelle constitue le corps vu., est
susceptible de se ddoubler, et que l'un des deux exemplaires reste avec le
corps tactile. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a un corps dtachable de celui
qu'on touche, corps sans intrieur, sans pesanteur, qui s'est transport
instantanment au point o il est. Que ce corps subsiste aprs la mort, il n'y a
rien en lui, sans doute, qui nous invite le croire. Mais si nous commenons
par poser en principe que quelque chose doit subsister, ce sera videmment ce
corps et non pas l'autre, car le corps qu'on touche est. encore prsent, il reste
immobile et ne tarde pas se corrompre, tandis que la pellicule visible a pu se
rfugier n'importe o et demeurer vivante. L'ide que l'homme se survit
l'tat d'ombre ou de fantme est donc toute naturelle. Elle a d prcder,
croyons-nous, l'ide plus raffine d'un principe qui animerait le corps comme
un souffle ; ce souffle (anemos) s'est lui-mme peu peu spiritualis en me
(anima ou animus). Il est vrai que le fantme du corps parat incapable, par
lui-mme, d'exercer une pression sur les vnements humains, et qu'il faut
pourtant qu'il l'exerce, puisque c'est l'exigence d'une action continue qui a
fait croire la survie. Mais ici un nouvel lment intervient.
Nous ne dfinirons pas encore cette autre tendance lmentaire. Elle est
aussi naturelle que les deux prcdentes ; c'est galement une raction dfensive de la nature. Nous aurons en rechercher l'origine. Pour le moment, nous
n'en considrerons que le rsultat. Elle aboutit la reprsentation d'une force
rpandue dans l'ensemble de la nature et se partageant entre les objets et les
tres individuels. Cette reprsentation, la science des religions la tient gnralement pour primitive. On nous parle du mana polynsien, dont
l'analogue se retrouve ailleurs sous des noms divers : wakanda des Sioux,
orna des Iroquois, pantang des Malais, etc. Selon les uns, le mana
serait un principe universel de vie et constituerait en particulier, pour parler
notre langage, la substance des mes. Selon d'autres, ce serait plutt une force
qui viendrait par surcrot et que l'me, comme d'ailleurs toute autre chose,
pourrait capter, mais qui n'appartiendrait pas l'me essentiellement.
Durkheim, qui semble raisonner dans la premire hypothse, veut que le
mana fournisse le principe totmique par lequel communieraient les membres du clan; l'me serait une individualisation directe du totem et
participerait du mana par cet intermdiaire. Il ne nous appartient pas de
choisir entre les diverses interprtations. D'une manire gnrale, nous hsitons considrer comme primitive, nous voulons dire comme naturelle, une
reprsentation que nous ne formerions pas, aujourd'hui encore, naturellement.
No-us estimons que ce qui fut primitif n'a pas cess de l'tre, bien qu'un effort
d'approfondissement interne puisse tre ncessaire pour le retrouver. Mais,
sous quelque forme qu'on prenne la reprsentation dont il s'agit, nous ne
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
73
ferons aucune difficult pour admettre que l'ide d'une provision de force o
puiseraient les tres vivants et mme bon nombre d'objets inanims est une
des premires que l'esprit rencontre sur son chemin quand il suit une certaine
tendance, celle-l naturelle et lmentaire, que nous dfinirons un peu plus
loin. Tenons donc cette notion pour acquise. Voil l'homme pourvu de ce qu'il
appellera plus tard une me. Cette me survivra-t-elle au corps ? Il n'y aurait
aucune raison de le supposer si l'on s'en tenait elle. Rien ne dit qu'une
puissance telle que le mana doive durer plus longtemps que l'objet qui la
recle. Mais si l'on a commenc par poser en principe que l'ombre du corps
demeure, rien n'empchera d'y laisser le principe qui imprimait au corps la
force d'agir. On obtiendra une ombre active, agissante, capable d'influer sur
les vnements humains. Telle serait la conception primitive de la survie.
L'influence exerce ne serait d'ailleurs pas grande, si l'ide d'me ne venait
rejoindre l'ide d'esprit. Celle-ci drive d'une autre tendance naturelle, que
nous aurons aussi dterminer. Prenons-la aussi pour accorde, et constatons
qu'entre les deux notions vont se pratiquer des changes. Les esprits que l'on
suppose partout prsents dans la nature ne se rapprocheraient pas tant de la
forme humaine si l'on ne se reprsentait dj ainsi les mes. De leur ct, les
mes dtaches des corps seraient sans influence sur les phnomnes naturels
si elles n'taient du mme genre que les esprits, et plus ou moins capables de
prendre place parmi eux. Les morts vont alors devenir des personnages avec
lesquels il faut compter. Ils peuvent nuire. Ils peuvent rendre service. Ils
disposent, jusqu' un certain point, de ce que nous appelons les forces de la
nature. Au propre et au figur, ils font la pluie et le beau temps. On
s'abstiendra de ce qui les irriterait. On s'efforcera de capter leur confiance. On
imaginera mille moyens de les gagner, de les acheter, voire de les tromper.
Une fois engage dans cette voie, il n'est gure d'absurdit o ne puisse
tomber l'intelligence. La fonction fabulatrice travaille dj assez bien par ellemme : que sera-ce, si elle est aiguillonne par la crainte et par le besoin !
Pour carter un danger ou pour obtenir une faveur, on offrira au mort tout ce
que l'on croit qu'il dsire. On ira jusqu' couper des ttes, si cela peut lui tre
agrable. Les rcits des missionnaires sont pleins de dtails ce sujet.
Purilits, monstruosits, la liste est interminable des pratiques inventes ici
par la stupidit humaine. A ne voir qu'elles, on serait tent de prendre l'humanit en dgot. Mais il ne faut pas oublier que les primitifs d'aujourd'hui ou
d'hier, ayant vcu autant de sicles que nous, ont eu tout le temps d'exagrer et
comme d'exasprer ce qu'il pouvait y avoir d'irrationnel dans des tendances
lmentaires, assez naturelles. Les vrais primitifs taient sans doute plus
senss, s'ils s'en tenaient la tendance et ses effets immdiats. Tout change,
et, comme nous le disions plus haut, le changement se fera en surface s'il n'est
pas possible en profondeur. Il y a des socits qui progressent, - probablement
celles que des conditions d'existence dfavorables ont obliges un certain
effort pour vivre, et qui ont alors consenti, de loin en loin, accentuer leur
effort pour suivre un initiateur, un inventeur, un homme suprieur. Le changement est ici un accroissement d'intensit ; la direction en est relativement
constante ; on marche une efficacit de plus en plus haute. Il y a, d'autre
part, des socits qui conservent leur niveau, ncessairement assez bas. Comme elles changent tout de mme, il se produit en elles, non plus une intensification qui serait un progrs qualitatif, mais une multiplication ou une exagration du primitivement donn : l'invention, si l'on peut encore employer ce
mot, n'exige plus d'effort. D'une croyance qui rpondait un besoin on aura
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
74
passe a une croyance nouvelle qui ressemble extrieurement la prcdente,
qui en accentue tel caractre superficiel, mais qui ne sert plus rien. Ds lors,
pitinant sur place, on ajoute et l'on amplifie sans cesse. Par le double effet de
la rptition et de l'exagration, l'irrationnel devient de l'absurde, et l'trange
du monstrueux. Ces extensions successives ont d'ailleurs d tre accomplies,
elles aussi, par des individus ; mais plus n'tait besoin ici de supriorit intellectuelle pour inventer, ni pour accepter l'invention. La logique de l'absurde
suffisait, cette logique qui conduit l'esprit de plus en plus loin, des consquences de plus en plus extravagantes, quand il part d'une ide trange sans la
rattacher des origines qui en expliqueraient l'tranget et qui en empcheraient la prolifration. Nous avons tous eu l'occasion de rencontrer quelqu'une
de ces familles trs unies, trs satisfaites d'elles-mmes, qui se tiennent
l'cart, par timidit ou par ddain. Il n'est pas rare qu'on observe chez elles
certaines habitudes bizarres, phobies ou superstitions, qui pourraient devenir
graves si elles continuaient fermenter en vase clos. Chacune de ces singularits a son origine. C'est une ide qui sera venue tel ou tel membre de la
famille, et que les autres auront accepte de confiance. C'est une promenade
qu'on aura faite un dimanche, qu'on aura recommence le dimanche suivant,
et qui s'est impose alors pour tous les dimanches de l'anne : si par malheur
on y manquait une fois, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Pour rpter,
pour imiter, pour se fier, il suffit de se laisser aller; c'est la critique qui exige
un effort. - Donnez-vous alors quelques centaines de sicles au lieu de quelques annes ; grossissez normment les petites excentricits d'une famille qui
s'isole : vous vous reprsenterez sans peine ce qui a d se passer dans des
socits primitives qui sont restes closes et satisfaites de leur sort, au lieu de
s'ouvrir des fentres sur le dehors, de chasser les miasmes au fur et mesure
qu'ils se formaient dans leur atmosphre, et de faire un effort constant pour
largir leur horizon.
Nous venons de dterminer deux fonctions essentielles de la religion, et
nous avons rencontr, au cours de notre analyse, des tendances lmentaires
qui nous paraissent devoir expliquer les formes gnrales que la religion a
prises. Nous passons l'tude de ces formes gnrales, de ces tendances
lmentaires. Notre mthode restera d'ailleurs la mme. Nous posons une
certaine activit instinctive ; faisant surgir alors l'intelligence, nous cherchons
si une perturbation dangereuse s'ensuit ; dans ce cas, l'quilibre sera vraisemblablement rtabli par des reprsentations que l'instinct suscitera au sein de
l'intelligence perturbatrice : si de telles reprsentations existent, ce sont des
ides religieuses lmentaires. Ainsi, la pousse vitale ignore la mort. Que
l'intelligence jaillisse sous sa pression, l'ide de l'invitabilit de la mort apparat : pour rendre la vie son lan, une reprsentation antagoniste se dressera ;
et de l sortiront les croyances primitives au sujet de la mort. Mais si la mort
est l'accident par excellence, combien d'autres accidents la vie humaine
n'est-elle pas expose ! L'application mme de l'intelligence la vie n'ouvre-telle pas la porte l'imprvu et n'introduit-elle pas le sentiment du risque ?
L'animal est sr de lui-mme. Entre le but et l'acte, rien chez lui ne
s'interpose. Si sa proie est l, il se jette sur elle. S'il est l'afft, son attente est
une action anticipe et formera un tout indivis avec l'acte s'accomplissant. Si
le but dfinitif est lointain, comme il arrive quand l'abeille construit sa ruche,
c'est un but que l'animal ignore ; il ne voit que l'objet immdiat, et l'lan qu'il
a conscience de prendre est coextensif l'acte qu'il se propose d'accomplir.
Mais il est de l'essence de l'intelligence de combiner des moyens en vue d'une
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
75
fin lointaine, et d'entreprendre ce qu'elle ne se sent pas entirement matresse
de raliser. Entre ce qu'elle fait et le rsultat qu'elle veut obtenir il y a le plus
souvent, et dans l'espace et dans le temps, un intervalle qui laisse une large
place l'accident. Elle commence, et pour qu'elle termine il faut, selon
l'expression consacre, que les circonstances s'y prtent. De cette marge
d'imprvu elle peut d'ailleurs avoir pleine connaissance. Le sauvage qui lance
sa flche ne sait pas si elle touchera le but ; il n'y a pas ici, comme lorsque
l'animal se prcipite sur sa proie, continuit entre le geste et le rsultat ; un
vide apparat, ouvert l'accident, attirant l'imprvu. Sans doute, en thorie,
cela ne devrait pas tre. L'intelligence est faite pour agir mcaniquement sur la
matire ; elle se reprsente donc mcaniquement les choses ; elle postule ainsi
le mcanisme universel et conoit virtuellement une science acheve qui
permettrait de pr. voir, an moment o l'acte est dcoch, tout ce qu'il
rencontrera avant d'atteindre le but. Mais il est de l'essence d'un pareil idal de
n'tre jamais ralis et de servir tout au plus de stimulant au travail de
l'intelligence. En fait, l'intelligence humaine doit s'en tenir une action trs
limite sur une matire trs imparfaitement connue d'elle. Or la pousse vitale
est l, qui n'accepte pas d'attendre, qui n'admet pas l'obstacle. Peu lui importe
l'accident, l'imprvu, enfin l'indtermin qui est le long de la route; elle
procde par bonds et ne voit que le terme, l'lan dvorant l'intervalle. De cette
anticipation il faut pourtant bien que l'intelligence ait connaissance. Une
reprsentation va en effet surgir, celle de puissances favorables qui se superposeraient ou se substitueraient aux causes naturelles et qui prolongeraient en
actions voulues par elles, conformes nos vux, la dmarche naturellement
engage. Nous avons mis en mouvement un mcanisme, voil le dbut ; le
mcanisme se retrouvera dans la ralisation de l'effet souhait, voil la fin :
entre les deux s'insrerait une garantie extra-mcanique de succs. Il est vrai
que si nous imaginons ainsi des puissances amies, s'intressant notre
russite, la logique de l'intelligence exigera que nous posions des causes
antagonistes, des puissances dfavorables, pour expliquer notre chec. Cette
dernire croyance aura d'ailleurs son utilit pratique ; elle stimulera indirectement notre activit en nous invitant prendre garde. Mais ceci est du driv,
je dirais presque du dcadent. La reprsentation d'une force qui empche est
peine postrieure, sans doute, celle d'une force qui aide ; si celle-ci est
naturelle, celle-l s'en tire comme une consquence immdiate ; mais elle doit
surtout prolifrer dans les socits stagnantes comme celles que nous
appelons aujourd'hui primitives, o les croyances se multiplient indfiniment
par voie d'analogie, sans gard pour leur origine. La pousse vitale est
optimiste. Toutes les reprsentations religieuses qui sortent ici directement
d'elle pourraient donc se dfinir de la mme manire : ce sont des ractions
dfensives de la nature contre la reprsentation, par l'intelligence, d'une
marge dcourageante d'imprvu entre l'initiative prise et l'effet souhait.
Chacun de nous peut faire l'exprience, s'il lui plat : il verra la superstition
jaillir, sous ses yeux, de la volont de succs. Placez une somme d'argent sur
un numro de la roulette, et attendez que la bille touche la fin de sa course :
au moment o elle va parvenir peut-tre, malgr ses hsitations, au numro de
votre choix, votre main avance pour la pousser, puis pour l'arrter ; c'est votre
propre volont, projete hors de vous, qui doit combler ici l'intervalle entre la
dcision qu'elle a prise et le rsultat qu'elle attend ; elle en chasse ainsi l'accident. Frquentez maintenant les salles de jeu, laissez faire l'accoutumance,
votre main renonce bien vite se mouvoir ; votre volont se rtracte
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
76
l'intrieur d'elle-mme ; mais, mesure qu'elle quitte la place, une entit s'y
installe, qui mane d'elle et reoit d'elle une dlgation : c'est la veine, en
laquelle le parti pris de gagner se transfigure. La veine n'est pas une personne
complte ; il faut plus que cela pour faire une divinit. Mais elle en a certains
lments, juste assez pour que vous vous en remettiez elle.
A une puissance de ce genre le sauvage fait appel pour que sa flche touche le but. Franchissez les tapes d'une longue volution : vous aurez les
dieux protecteurs de la cit, qui doivent assurer la victoire aux combattants.
Mais remarquez que dans tous les cas c'est par des moyens rationnels, c'est
en se rglant sur des conscutions mcaniques de causes et d'effets, qu'on met
les choses en train. On commence par accomplir ce qui dpend de soi; c'est
seulement quand on ne se sent plus capable de s'aider soi-mme qu'on s'en
remet une puissance extra-mcanique, et-on mme plac ds l'abord sous
son invocation, puisqu'on la croyait prsente, l'acte dont on ne se sentait
nullement dispens par elle. Mais ce qui pourra tromper ici le psychologue,
c'est que la seconde causalit est la seule dont on parle. De, la premire on ne
dit rien, parce qu'elle va de soi. Elle rgit les actes qu'on accomplit avec la
matire pour instrument ; ou joue et l'on vit la croyance qui on a en elle ; a
quoi servirait de la traduire en mots et d'en expliciter l'ide ? Ce ne serait utile
que si l'on possdait dj une science capable d'en profiter. Mais la seconde
causalit il est bon de penser, parce qu'on y trouve tout au moins un encouragement et un stimulant. Si la science fournissait au non-civilis un dispositif
qui l'assurt mathmatiquement de toucher le but, c'est la causalit mcanique qu'il s'en tiendrait ( supposer, bien entendu, qu'il pt renoncer
instantanment des habitudes d'esprit invtres). En attendant cette science,
son action tire de la causalit mcanique tout ce qu'elle en peut tirer, car il
tend son arc et il vise ; mais sa pense va plutt la cause extra-mcanique
qui doit conduire la flche o il faut, parce que sa croyance en elle lui
donnera, dfaut de l'arme avec laquelle il serait sr d'atteindre le but, la
confiance en soi qui permet de mieux viser.
L'activit humaine se droule au milieu d'vnements sur lesquels elle
influe et dont aussi elle dpend. Ceux-ci sont prvisibles en partie et, pour une
large part, imprvisibles. Comme notre science largit de plus en plus le
champ de notre prvision, nous concevons la limite une science intgrale
pour laquelle il n'y aurait plus d'imprvisibilit. C'est pourquoi, aux yeux de la
pense rflchie de l'homme civilis (nous allons voir qu'il n'en est pas tout
fait ainsi pour sa reprsentation spontane) le mme enchanement mcanique
de causes et d'effets avec lequel il prend contact quand il agit sur les choses
doit s'tendre la totalit de l'univers. Il n'admet pas que le systme
d'explication, qui convient aux vnements physiques sur lesquels il a prise,
doive cder la place, quand il s'aventure plus loin, un systme tout diffrent,
celui dont il use dans la vie sociale quand il attribue des intentions bonnes
ou mauvaises, amicales ou hostiles, la conduite des autres hommes son
gard. S'il le fait, c'est son insu ; il ne se l'avoue pas lui-mme. Mais le
non-civilis, qui ne dispose que d'une science inextensible, taille l'exacte
mesure de l'action qu'il exerce sur la matire, ne peut pas jeter dans le champ
de l'imprvisible une science virtuelle qui le couvrirait tout entier et qui ouvre
tout de suite de larges perspectives son ambition. Plutt que de se dcourager, il tend ce domaine le systme d'explication dont il use dans ses
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
77
rapports avec ses semblables ; il y croira trouver des puissances amies, il y
sera expos aussi des influences malfaisantes ; de toute manire il n'aura pas
affaire un monde qui lui soit compltement tranger. Il est vrai que, si de
bons et de mauvais gnies doivent prendre la suite de l'action qu'il exerce sur
la matire, ils paratront influencer dj cette action elle-mme. Notre homme
parlera donc comme s'il ne comptait nulle part, pas mme pour ce qui dpend
de lui, sur un enchanement mcanique de causes et d'effets. Mais s'il ne
croyait pas ici un enchanement mcanique, nous ne le verrions pas, ds
qu'il agit, faire tout ce qu'il faut pour dclencher mcaniquement le rsultat.
Or, qu'il s'agisse de sauvages ou de civiliss, si l'on veut savoir le fond de ce
qu'un homme pense, il faut s'en rapporter ce qu'il fait et non pas ce qu'il
dit.
Dans les livres si intressants et si instructifs qu'il a consacrs la mentalit primitive , M. Lvy-Bruhl insiste sur l'indiffrence de cette mentalit
aux causes secondes , sur son recours immdiat des causes mystiques .
Notre activit quotidienne, dit-il, implique une tranquille et parfaite confiance dans l'invariabilit des lois naturelles. Bien diffrente est l'attitude
d'esprit du primitif. La nature au milieu de laquelle il vit se prsente lui sous
un tout autre aspect. Tous les objets et tous les tres y sont impliqus dans un
rseau de participations et d'exclusions mystiques 1. Et un peu plus loin :
Ce qui varie dans les reprsentations collectives, ce sont les forces occultes
auxquelles on attribue la maladie ou la mort qui sont survenues : tantt c'est
un sorcier qui est le coupable, tantt l'esprit d'un mort, tantt des forces plus
ou moins dfinies ou individualises... ; ce qui demeure semblable, et on
pourrait presque dire identique, c'est la prliaison entre la maladie et la mort
d'une part, et une puissance invisible de l'autre 2. A l'appui de cette ide,
l'auteur apporte les tmoignages concordants des voyageurs et des missionnaires, et il cite les plus curieux exemples.
Mais un premier point est frappant . c'est que, dans tous les cas allgus,
l'effet dont on parle, et qui est attribu par le primitif une cause occulte, est
un vnement concernant l'homme, plus particulirement un accident arriv
un homme, plus spcialement encore la mort ou la maladie d'un homme. De
l'action de l'inanim sur l'inanim ( moins qu'il ne s'agisse d'un phnomne,
mtorologique ou autre, dans lequel l'homme a pour ainsi dire des intrts) il
n'est jamais question. On ne nous dit pas que le primitif, voyant le vent
courber un arbre, la vague rouler des galets, son pied mme soulever de la
poussire, fasse intervenir autre chose que ce que nous appelons la causalit
mcanique. La relation constante entre l'antcdent et le consquent, qu'il
peroit l'un et l'autre, ne peut pas tre sans le frapper: elle lui suffit ici, et nous
ne voyons pas qu'il y superpose, encore moins qu'il y substitue, une causalit
mystique . Allons plus loin, laissons de ct, les faits physiques auxquels
le primitif assiste en spectateur indiffrent : ne peut-on pas dire, de lui aussi,
que son activit quotidienne implique une parfaite confiance dans l'invariabilit des lois naturelles ? Sans elle, il ne compterait pas sur le courant de la
rivire pour porter son canot, sur la tension de son arc pour lancer sa flche,
sur la hache pour entamer le tronc de l'arbre, sur ses dents pour mordre ou sur
ses jambes pour marcher. Il peut ne pas se reprsenter explicitement cette
1
2
La Mentalit primitive, Paris, 1922, pp. 17-18.
Ibid., p. 24.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
78
causalit naturelle ; il n'a aucun intrt le faire, n'tant ni physicien ni
philosophe ; mais il a foi en elle et il la prend pour support de son activit.
Allons plus loin encore. Quand le primitif fait appel une cause mystique
pour expliquer la mort, la maladie ou tout autre accident, quelle est au juste
l'opration laquelle il se livre ? Il voit par exemple qu'un homme a t tu
par un fragment de rocher qui s'est dtach au cours d'une tempte. Nie-t-il
que le rocher ait t dj fendu, que le vent ait arrach la pierre, que le choc
ait bris un crne ? videmment non. Il constate comme nous l'action de ces
causes secondes. Pourquoi donc introduit-il une cause mystique , telle que
la volont d'un esprit ou d'un sorcier, pour l'riger en cause principale ? Qu'on
y regarde de prs : on verra que ce que le primitif explique ici par une cause
surnaturelle , ce n'est pas l'effet physique, c'est sa signification humaine,
c'est son importance pour l'homme et plus particulirement pour un certain
homme dtermin, celui que la pierre crase. Il n'y a rien d'illogique, ni par
consquent de prlogique , ni mme qui tmoigne d'une impermabilit
l'exprience , dans la croyance qu'une cause doit tre proportionne son
effet, et qu'une fois constates la flure du rocher, la direction et la violence
du vent -choses purement physiques et insoucieuses de l'humanit - il reste
expliquer ce fait, capital pour nous, qu'est la mort d'un homme. La cause
contient minemment l'effet, disaient jadis les philosophes ; et si l'effet a une
signification humaine considrable, la cause doit avoir une signification au
moins gale; elle est en tout cas de mme ordre : c'est une intention. Que
l'ducation scientifique de l'esprit le dshabitue de cette manire de raisonner,
ce n'est pas douteux. Mais elle est naturelle ; elle persiste chez le civilis et se
manifeste toutes les fois que n'intervient pas la force antagoniste. Nous
faisions remarquer que le joueur, qui mise sur un numro de la roulette,
attribuera le succs ou l'insuccs la veine ou la dveine, c'est--dire une
intention favorable ou dfavorable : il n'en expliquera pas moins par des
causes naturelles tout ce qui se passe entre le moment o il place l'argent et le
moment o la bille s'arrte ; mais cette causalit mcanique il superposera,
la fin, un choix semi-volontaire qui fasse pendant au sien : l'effet dernier sera
ainsi de mme importance et de mme ordre que la premire cause, qui avait
galement t un choix. De ce raisonnement trs logique nous saisissons
d'ailleurs l'origine pratique quand nous voyons le joueur esquisser un mouvement de la main pour arrter la bille : c'est sa volont de succs, c'est la
rsistance cette volont qu'il va objectiver dans la veine ou la dveine pour
se trouver devant une puissance allie ou ennemie, et pour donner au jeu tout
son intrt. Mais bien plus frappante encore est la ressemblance entre la
mentalit du civilis et celle du primitif quand il s'agit de faits tels que ceux
que nous venons d'envisager : la mort, la maladie, l'accident grave. Un
officier qui a pris part la grande guerre nous disait qu'il avait toujours vu les
soldats redouter les balles plus que les obus, quoique le tir de l'artillerie ft de
beaucoup le plus meurtrier. C'est que par la balle on se sent vise, et que
chacun fait malgr lui le raisonnement suivant : Pour produire cet effet, si
important pour moi, que serait la mort ou la blessure grave, il faut une cause
de mme importance, il faut une intention. Un soldat qui fut prcisment
atteint par un clat d'obus nous racontait que son premier mouvement fut de
s'crier : Comme c'est bte ! Que cet clat d'obus projet par une cause
purement mcanique, et qui pouvait atteindre n'importe qui ou n'atteindre
personne, ft pourtant venu le frapper, lui et non pas un autre, c'tait illogique
au regard de son intelligence spontane. En faisant intervenir la mauvaise
chance , il et manifest mieux encore la parent de cette intelligence
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
79
spontane avec la mentalit primitive. Une reprsentation riche de matire,
comme l'ide d'un sorcier ou d'un esprit, doit sans doute abandonner la plus
grande partie de son contenu pour devenir celle de la mauvaise chance ;
elle subsiste cependant, elle n'est pas compltement vide, et par consquent
les deux mentalits ne diffrent pas essentiellement l'une de l'autre.
Les exemples si varis de mentalit primitive que M. Lvy-Bruhl a
accumuls dans ses ouvrages se groupent sous un certain nombre de
rubriques. Les plus nombreux sont ceux qui tmoignent, selon l'auteur, d'une
obstination du primitif ne rien admettre de fortuit. Qu'une pierre tombe et
vienne craser un passant, c'est qu'un esprit malin l'a dtache: il n'y a pas de
hasard. Qu'un homme soit arrach de son canot par un alligator, c'est qu'il a
t ensorcel : il n'y a pas de hasard. Qu'un guerrier soit tu ou bless d'un
coup de lance, c'est qu'il n'tait pas en tat de parer, c'est qu'on avait jet sur
lui un sort : il n'y a pas de hasard 1. La formule revient si souvent chez M.
Lvy-Bruhl qu'on peut la considrer comme donnant un des caractres
essentiels de la mentalit primitive. - Mais, dirons-nous l'minent philosophe, en reprochant au primitif de ne pas croire au hasard, ou tout au moins en
constatant, comme un trait caractristique de sa mentalit, qu'il n'y croit pas,
n'admettez-vous pas, vous, qu'il y a du hasard ? Et, en l'admettant, tes-vous
bien sr de ne pas retomber dans cette mentalit primitive que vous critiquez,
que vous voulez en tout cas distinguer essentiellement de la vtre ? J'entends
bien que vous ne faites pas du hasard une force agissante. Mais si c'tait pour
vous un pur nant, vous n'en parleriez pas. Vous tiendriez le mot pour
inexistant, comme la chose. Or le mot existe, et vous en usez, et il reprsente
pour vous quelque chose, comme d'ailleurs pour nous tous. Demandons-nous
ce qu'il peut bien reprsenter. Une norme tuile, arrache par le vent, tombe et
assomme un passant. Nous disons que c'est un hasard. Le dirions-nous, si la
tuile s'tait simplement brise sur le sol ? Peut-tre, mais c'est que nous
penserions vaguement alors un homme qui aurait pu se trouver l, ou parce
que, pour une raison ou pour une autre, ce point spcial du trottoir nous
intressait particulirement, de telle sorte que la tuile semble l'avoir choisi
pour y tomber. Dans les deux cas, il n'y a de hasard que parce qu'un intrt
humain est en Jeu et parce que les choses se sont passes comme si l'homme
avait t pris en considration 2 soit en vue de lui rendre service, soit plutt
avec l'intention de lui nuire. Ne pensez qu'au vent arrachant la tuile, la tuile
tombant sur le trottoir, au choc de la tuile contre le sol : vous ne voyez plus
que du mcanisme, le hasard s'vanouit. Pour qu'il intervienne, il faut que,
l'effet ayant une signification humaine, cette signification rejaillisse sur la
cause et la colore, pour ainsi dire, d'humanit. Le hasard est donc le mcanisme se comportant comme s'il avait une intention. On dira peut-tre que,
prcisment parce que nous employons le mot quand les choses se passent
comme s'il y avait eu intention, nous ne supposons pas alors une intention
relle, nous reconnaissons au contraire que tout s'explique mcaniquement. Et
ce serait trs juste, s'il n'y avait que la pense rflchie, pleinement consciente. Mais au-dessous d'elle est une pense spontane et semi-consciente,
qui superpose l'enchanement mcanique des causes et des effets quelque
1
2
Voir en particulier La -Mentalit primitive, p. 28, 36, 45, etc. Cf. Les fonctions mentales
dans les socits infrieures, p. 73.
Nous avons dvelopp cette conception du hasard dans un tours profess au Collge de
France en 1898, propos du Peri heimarmens d'Alexandre d'Aphrodisiade.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
80
chose de tout diffrent, non pas certes pour rendre compte de la chute de la
tuile, mais pour expliquer que la chute ait concid avec le passage d'un
homme, qu'elle ait justement choisi cet instant. L'lment de choix ou
d'intention est aussi restreint que possible, il recule mesure que la rflexion
veut le saisir ; il est fuyant et mme vanouissant ; mais s'il tait inexistant, on
ne parlerait que de mcanisme, il ne serait pas question de hasard. Le hasard
est donc une intention qui s'est vide de son contenu. Ce n'est plus qu'une
ombre ; mais la forme y est, dfaut de la matire. Tenons-nous ici une de ces
reprsentations que nous appelons rellement primitives , spontanment
formes par l'humanit en vert-Li d'une tendance naturelle ? Pas tout fait. Si
spontane qu'elle soit encore, l'ide de hasard n'arrive notre conscience
qu'aprs avoir travers la couche d'expriences accumules que la socit
dpose en nous, du jour o elle nous apprend parler. C'est dans ce trajet
mme qu'elle se vide, une science de plus en plus mcanistique expulsant
d'elle ce qu'elle contenait de finalit. Il faudrait donc la remplir, lui donner un
corps, si l'on voulait reconstituer la reprsentation originelle. Le fantme
d'intention deviendrait alors une intention vivante. Inversement, il faudrait
donner cette intention vivante beaucoup trop de contenu, la lester exagrment de matire, pour obtenir les entits malfaisantes ou bienfaisantes
auxquelles pensent les non-civiliss. Nous ne saurions trop le rpter: ces
superstitions impliquent d'ordinaire un grossissement, un paississement,
quelque chose enfin de caricatural. Elles marquent le plus souvent que le
moyen s'est dtach de sa fin. Une croyance d'abord utile, stimulatrice de la
volont, se sera transporte de l'objet o elle avait sa raison d'tre des objets
nouveaux, o elle ne sert plus rien, o elle pourrait mme devenir dangereuse. S'tant multiplie paresseusement, par une imitation tout extrieure
d'elle-mme, elle aura pour effet maintenant d'encourager la paresse.
N'exagrons rien, cependant. Il est rare que le primitif se sente dispens par
elle d'agir. Des indignes du Cameroun s'en prendront uniquement aux
sorciers si l'un des leurs a t dvor par un crocodile ; mais M. Lvy-Bruhl,
qui rapporte le fait, ajoute, sur le tmoignage d'un voyageur, que les crocodiles du pays n'attaquent presque jamais l'homme 1. Soyons convaincus que,
l o le crocodile est rgulirement dangereux, l'indigne s'abstient comme
nous d'entrer dans l'eau : l'animal lui fait alors peur, avec ou sans malfice. Il
n'en est pas moins vrai que, pour passer de cette mentalit primitive des
tats d'me qui seraient aussi bien les ntres, il y a le plus souvent deux
oprations accomplir. Il faut d'abord supposer abolie toute notre science. Il
faut ensuite se laisser aller une certaine paresse, se dtourner d'une explication qu'on devine plus raisonnable, mais qui exigerait un plus grand effort de
l'intelligence et surtout de la volont. Dans bien des cas une seule de ces
oprations suffit ; dans d'autres, nous devrons combiner les deux.
Considrons par exemple un des plus curieux chapitres de M. Lvy-Bruhl,
celui qui traite de la premire impression produite sur les primitifs par nos
armes feu, notre criture, nos livres, enfin ce que nous leur apportons. Cette
impression nous dconcerte d'abord. Nous serions en effet tents de l'attribuer
une mentalit diffrente de la ntre. Mais plus nous effacerons de notre
esprit la science graduellement et presque inconsciemment acquise, plus
l'explication primitive nous paratra naturelle. Voici des gens devant lesquels un voyageur ouvre un livre, et qui l'on dit que ce livre donne des
1
La Mentalit Primitive, p. 38.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
81
informations. Ils en concluent que le livre parle, et qu'en l'approchant de leur
oreille ils percevront un son. Mais attendre autre chose d'un homme tranger
notre civilisation, c'est lui demander beaucoup plus qu'une intelligence comme celle de la plupart d'entre nous, plus mme qu'une intelligence suprieure,
plus que du gnie - c'est vouloir qu'il rinvente l'criture. Car s'il se reprsentait la possibilit de dessiner un discours sur une feuille de papier, il
tiendrait le principe d'une criture alphabtique ou plus gnralement phontique ; il serait arriv, du premier coup, au point qui n'a pu tre atteint chez les
civiliss que par les efforts longtemps accumuls d'un grand nombre
d'hommes suprieurs. Ne parlons donc pas ici d'esprits diffrents du ntre.
Disons simplement qu'ils ignorent ce que nous avons appris.
Il y a maintenant, ajoutions-nous, des cas o l'ignorance s'accompagne
d'une rpugnance l'effort. Tels seraient ceux que M. Lvy-Bruhl a classs
sous la rubrique ingratitude des malades . Les primitifs qui ont t soigns
par des mdecins europens ne leur en savent aucun gr ; bien plus, ils attendent du mdecin une rtribution, comme si c'taient eux qui avaient rendu le
service. Mais n'ayant aucune ide de notre mdecine, ne sachant pas ce qu'est
une science double d'un art, voyant d'ailleurs que le mdecin est loin de
gurir toujours son malade, considrant enfin qu'il donne son temps et sa
peine, comment ne se diraient-ils pas que le mdecin a quelque intrt,
inconnu d'eux, a faire ce qu'il fait ? Comment aussi, plutt que de travailler
sortir de leur ignorance, n'adopteraient-ils pas naturellement l'interprtation
qui leur vient d'abord l'esprit et dont ils peuvent tirer profit ? Je le demande
l'auteur de La Mentalit primitive , et j'voquerai un souvenir trs ancien,
peine plus vieux cependant que notre vieille amiti. J'tais enfant, et j'avais
de mauvaises dents. Force tait de me conduire parfois chez le dentiste, lequel
svissait aussitt contre la dent coupable ; il l'arrachait sans piti. Entre nous
soit dit, cela ne me faisait pas grand mal, car il s'agissait de dents qui seraient
tombes d'elles-mmes ; mais je n'tais pas encore install dans le fauteuil
bascule que je poussais dj des cris pouvantables, pour le principe. Ma
famille avait fini par trouver le moyen de me faire taire. Bruyamment, dans le
verre qui servirait me rincer la bouche aprs l'opration (l'asepsie tait
inconnue en ces temps trs lointains) le dentiste jetait une pice de cinquante
centimes, dont le pouvoir d'achat tait alors de dix sucres d'orge. J'avais bien
six ou sept ans, et je n'tais pas plus sot qu'un autre. Jtais certainement de
force deviner qu'il y avait collusion entre le dentiste et ma famille pour
acheter mon silence, et que l'on conspirait autour de moi pour mon plus grand
bien. Mais il aurait fallu un lger effort de rflexion, et je prfrais ne pas le
donner, probablement par paresse, peut-tre aussi pour n'avoir pas changer
d'attitude vis--vis d'un homme contre lequel - c'est le cas de le dire - j'avais
une dent. Je me laissais donc simplement aller ne pas penser, et l'ide que je
devais me faire du dentiste se dessinait alors d'elle-mme dans mon esprit en
traits lumineux. C'tait videmment un homme dont le plus grand plaisir tait
d'arracher des dents, et qui allait jusqu' payer pour cela une somme de
cinquante centimes.
Mais fermons cette parenthse et rsumons-nous. A l'origine des croyances que nous venons d'envisager nous avons trouv une raction dfensive de
la nature contre un dcouragement qui aurait sa source dans l'intelligence.
Cette raction suscite, au sein de l'intelligence mme, des images et des ides
qui tiennent en chec la reprsentation dprimante, ou qui l'empchent de
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
82
s'actualiser. Des entits surgissent, qui n'ont pas besoin d'tre des personnalits compltes : il leur suffit d'avoir des intentions, ou mme de concider
avec elles. Croyance signifie donc essentiellement confiance ; l'origine
premire n'est pas la crainte, mais une assurance contre la crainte. Et d'autre
part ce n'est pas ncessairement une personne que la croyance prend pour
objet d'abord ; un anthropomorphisme partiel lui suffit. Tels sont les deux
points qui nous frappent quand nous considrons l'attitude naturelle de l'homme vis--vis d'un avenir auquel il pense par cela mme qu'il est intelligent, et
dont il s'alarmerait, en raison de ce qu'il y trouve d'imprvisible, s'il s'en tenait
la reprsentation que la pure intelligence lui en donne. Mais telles sont aussi
les deux constatations que l'on peut faire dans des cas o il ne s'agit plus de
l'avenir, mais du prsent, et o l'homme est le jouet de forces normment
suprieures a la sienne. De ce nombre sont les grands bouleversements, un
tremblement de terre, une inondation, un ouragan. Une thorie dj ancienne
faisait sortir la religion de la crainte qu'en pareil cas la nature nous inspire :
Primus in orbe deos fecit timor. On est all trop loin en la rejetant compltement ; l'motion de l'homme devant la nature est srement pour quelque
chose dans l'origine des religions. Mais, encore une fois, la religion est moins
de la crainte qu'une raction contre la crainte, et elle n'est pas tout de suite
croyance des dieux. Il ne sera pas inutile de procder ici cette double
vrification. Elle ne confirmera pas seulement nos prcdentes analyses ; elle
nous fera serrer de plus prs ces entits dont nous disions qu'elles participent
de la personnalit sans tre encore des personnes. Les dieux de la mythologie
pourront sortir d'elles ; on les obtiendra par voie d'enrichissement. Mais on
tirerait aussi bien d'elles, en les appauvrissant, cette force impersonnelle que
les primitifs, nous dit-on, mettent au fond des choses. Suivons donc notre
mthode habituelle. Demandons notre propre conscience, dbarrasse de
l'acquis, rendue sa simplicit originelle, comment elle rplique une agression de la nature. L'observation de soi est ici fort difficile, cause de la
soudainet des vnements graves ; les occasions qu'elle a de s'exercer fond
sont d'ailleurs rares. Mais certaines impressions d'autrefois dont nous n'avons
conserv qu'un souvenir confus, et qui taient dj superficielles et vagues,
deviendront peut-tre plus nettes et prendront plus de relief si nous les
compltons par l'observation que fit sur lui-mme un matre de la science
psychologique. William James se trouvait en Californie lors du terrible
tremblement de terre d'avril 1906, qui dtruisit une partie de San Francisco.
Voici la bien imparfaite traduction des pages vraiment intraduisibles qu'il
crivit ce sujet :
Quand je quittai Harvard pour l'Universit Stanford en dcembre le dernier au
revoir, ou peu s'en faut, fut celui de mon vieil ami B***, californien : J'espre, me
dit-il, qu'ils vous donneront aussi un petit bout de tremblement de terre pendant que
vous serez l-bas, de faon que vous fassiez connaissance avec cette toute
particulire institution californienne.
En consquence, lorsque, couch encore mais veill, vers cinq heures et demie
du matin, le 18 avril, dans mon petit appartement de la cit universitaire de Stanford,
je m'aperus que mon lit commenait osciller, mon premier sentiment fut de
reconnatre joyeusement la signification du mouvement Tiens, tiens ! me dis-je,
mais c'est ce vieux tremblement de terre de B***. Il est donc venu tout de mme ?
Puis, comme il allait crescendo : Par exemple, pour un tremblement de terre, c'en
est un qui se porte bien ! ...
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
83
Toute l'affaire ne dura pas plus de 48 secondes, comme l'observatoire Lick nous
le fit savoir plus tard. C'est peu prs ce qu'elle me parut durer ; d'autres crurent
l'intervalle plus long. Dans mon cas, sensation et motion furent si fortes qu'il ne put
tenir que peu de pense, et nulle rflexion, nulle volition, dans le peu de temps
qu'occupa le phnomne.
Mon motion tait tout entire allgresse et admiration : allgresse devant
l'intensit de vie qu'une ide abstraite, une pure combinaison verbale comme
tremblement de terre pouvait prendre, une fois traduite en ralit sensible et
devenue l'objet d'une vrification concrte ; admiration devant le fait qu'une frle
petite maison de bois pt tenir, en dpit d'une telle secousse. Pas l'ombre d'une peur ;
simplement un plaisir extrme, avec souhaits de bienvenue.
Je criais presque : Mais vas-y donc ! et vas-y plus fort
Ds que je pus penser, je discernai rtrospectivement certaines modalits toutes
particulires dans l'accueil que ma conscience avait fait au phnomne. C'tait chose
spontane et, pour ainsi dire, invitable et irrsistible.
D'abord, je personnifiais le tremblement de terre en une entit permanente et
individuelle. C'tait le tremblement de terre de la prdiction de mon ami B***,
tremblement qui s'tait tenu tranquille, qui s'tait retenu pendant tous les mois
intermdiaires, pour enfin, en cette mmorable matine d'avril, envahir ma chambre
et s'affirmer d'autant plus nergiquement et triomphalement. De plus, c'est moi qu'il
venait en droite ligne. Il se glissait l'intrieur, derrire mon dos ; et mie fois dans la
chambre, il m'avait pour lui tout seul, pouvant ainsi se manifester de faon
convaincante. Jamais animation et intention ne frirent plus prsentes une action
humaine. Jamais, non plus, activit humaine ne fit voir plus nettement derrire elle,
comme source et comme origine, un agent vivant.
Tous ceux que j'interrogeai l-dessus se trouvrent d'ailleurs d'accord sur cet
aspect de leur exprience : Il affirmait une intention, Il tait pervers , Il s'tait
mis en tte de dtruire , Il voulait montrer sa force, etc., etc. A moi, il voulait
simplement manifester la pleine signification de son nom. Mais qui tait cet il ?
Pour quelques-uns, vraisemblablement, un vague pouvoir dmoniaque. Pour moi, un
tre individualis, le tremblement de terre de B***.
Une des personnes qui me communiqurent leurs impressions s'tait crue la fin
du monde, an commencement du jugement dernier. C'tait une dame loge dans un
htel de San Francisco, laquelle l'ide d'un tremblement de terre ne vint que
lorsqu'elle se fut trouve dans la rue et qu'elle entendit donner cette explication. Elle
rue dit que son interprtation thologique l'avait prserve de la peur, et lui avait fait
prendre la secousse avec calme.
Pour la science , quand des tensions de l'corce terrestre atteignent le point de
rupture, et que des strates subissent une modification d'quilibre, le tremblement de
terre est tout simplement le nom collectif de tous les craquements, de toutes les
secousses, de toutes les perturbations qui se produisent. Ils sont le tremblement de
terre. Mais, pour moi, c'tait le tremblement de terre qui tait la cause des
perturbations, et la perception de ce tremblement comme d'un agent vivant tait
irrsistible. Eue avait une force dramatique de conviction qui emportait tout.
Je vois mieux maintenant combien taient invitables les anciennes interprtations mythologiques de catastrophes de ce genre, et combien sont artificielles, comment vont en sens inverse de notre perception spontane, les habitudes ultrieures
que la science imprime en nous par l'ducation. Il tait simplement impossible des
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
84
esprits induqus d'accueillir des impressions de tremblement de terre autrement que
comme des avertissements ou des sanctions surnaturels 1.
On remarquera d'abord que James parle du tremblement de terre comme
d'un tre individualis ; il constate que le tremblement de terre se personnifie pour lui en une entit permanente et individuelle . Mais il ne dit pas
qu'il y ait - dieu ou dmon - une personnalit complte, capable d'actions
diverses, et dont le tremblement de terre serait une manifestation particulire.
Au contraire, l'entit dont il s'agit est le phnomne lui-mme, considr
comme permanent ; sa manifestation nous livre son essence elle a pour unique
fonction d'tre tremblement de terre il y a une me, mais qui est l'animation de
l'acte par son intention 2. Si l'auteur nous dit que jamais activit humaine ne
fit voir plus nettement derrire elle un agent vivant , il entend par l que
l'intention et l' animation semblaient appartenir au tremblement de terre
comme appartiennent un agent vivant, situ derrire eux, les actes que cet
agent accomplit. Mais que l'agent vivant soit ici le tremblement de terre luimme, qu'il n'ait pas d'autre activit, pas d'autre proprit, que ce qu'il est
concide par consquent avec ce qu'il fait, tout le rcit en tmoigne. Une entit
de ce genre, dont l'tre ne fait qu'un avec le paratre, qui se confond avec un
acte dtermin et dont l'intention est immanente cet acte mme, n'en tant
que le dessin et la signification consciente, est prcisment ce que nous appelions un lment de personnalit. Il y a maintenant un autre point dont on ne
manquera pas d'tre frapp. Le tremblement de terre de San Francisco fut une
grande catastrophe. Mais James, plac brusquement en face du danger, il
apparat avec je ne sais quel air bonhomme, qui permet de le traiter avec familiarit. Tiens, tiens ! c'est ce vieux tremblement de terre. Analogue avait
t l'impression des autres assistants. Le tremblement tait pervers ; il
avait son ide, il s'tait mis en tte de dtruire . On parle ainsi d'un mauvais
garnement, avec lequel on n'a pas ncessairement rompu toute relation. La
crainte qui paralyse est celle qui nat de la pense que des forces formidables
et aveugles sont prtes nous broyer inconsciemment. C'est ainsi que le
monde matriel apparat la pure intelligence. La conception scientifique du
tremblement de terre, laquelle James fait allusion dans ses dernires lignes,
sera la plus dangereuse de toutes tant que la science, qui nous apporte la
vision nette du pril, ne nous aura pas fourni quelque moyen d'y chapper.
Contre cette conception scientifique, et plus gnralement contre la reprsentation intellectuelle qu'elle est venue prciser, une raction dfensive se
produit devant le pril grave et soudain. Les perturbations auxquelles nous
avons affaire, et dont chacune est toute mcanique, se composent en un
vnement qui ressemble quelqu'un, qui peut tre un mauvais sujet mais qui
n'en est pas moins de notre monde, pour ainsi dire. Il ne nous est pas tranger.
Une certaine camaraderie entre lui et nous est possible. Cela suffit dissiper
la frayeur, ou plu. tt l'empcher de natre. D'une manire gnrale, la
frayeur est utile, comme tous les autres sentiments. Un animal inaccessible
la crainte ne saurait pas fuir ni se garer ; il succomberait bien vite dans la lutte
pour la vie. On s'explique donc l'existence d'un sentiment tel que la crainte.
On comprend aussi que la crainte soit proportionne la gravit du danger.
Mais c'est un sentiment qui retient, qui dtourne, qui retourne : il est essen1
2
William James, Memories and Studies, p. 209-214. Cit par H.M. Kallen dans Why
religion, New York, 1927.
Animus and intent were never more present in any human action.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
85
tiellement inhibiteur. Quand le pril est extrme, quand la crainte atteindrait
son paroxysme et deviendrait paralysante, une raction dfensive de la nature
se produit contre l'motion qui tait galement naturelle. Notre facult de
sentir ne pourrait certes pas se modifier, elle reste ce qu'elle tait ; mais l'intelligence, sous la pousse de l'instinct, transforme pour elle la situation. Elle
suscite l'image qui rassure. Elle donne lvnement une unit et une individualit qui en font un tre malicieux ou mchant peut-tre, mais rapproch de
nous, avec quelque chose de sociable et d'humain.
Je demande au lecteur d'interroger ses souvenirs. Ou je me trompe fort, ou
ils confirmeront l'analyse de James. Je me permettrai en tout cas d'voquer un
ou deux des miens. Le premier remonte des temps trs anciens, puisque
j'tais tout jeune et que je pratiquais les sports, en particulier l'quitation.
Voici qu'un beau jour, pour avoir crois sur la route cette apparition fantastique qu'tait un bicycliste juch sur un haut vlocipde, le cheval que je
montais prit peur et s'emporta. Que cela pt arriver, qu'il y et en pareil cas
certaines choses faire ou du moins tenter, je le savais comme tous ceux qui
ont frquent un mange. Mais l'ventualit ne s'tait jamais prsente mon
esprit que sous forme abstraite. Que l'accident se produist effectivement, en
un point dtermin de l'espace et du temps, qu'il m'arrivt moi plutt qu' un
autre, cela me paraissait impliquer une prfrence donne a ma personne. Qui
donc m'avait choisi ? Ce n'tait pas le cheval. Ce n'tait pas un tre complet,
quel qu'il ft, bon ou mauvais gnie. C'tait l'vnement lui-mme, un individu qui n'avait pas de corps lui appartenant, car il n'tait que la synthse des
circonstances, mais il avait son me trs lmentaire, et qui se distinguait
peine de l'intention que les circonstances semblaient manifester. Il me suivait
dans ma course dsordonne, malicieusement, pour voir comment je m'en
tirerais. Et je n'avais d'autre souci que de lui montrer ce que je savais faire. Si
je n'prouvais aucune frayeur, c'est justement parce que j'tais absorb par
cette proccupation ; c'est aussi, peut-tre, parce que la malice de mon
singulier compagnon n'excluait pas une certaine bonhomie. J'ai souvent pens
ce petit incident, et je me suis dit que la nature n'aurait pas imagin un autre
mcanisme psychologique si elle avait voulu, en nous dotant de la peur
comme d'une motion utile, nous en prserver dans les cas o nous avons
mieux faire que de nous y laisser aller.
Je viens de citer un exemple o le caractre bon enfant de l'Accident
est ce qu'il y a de plus frappant. En voici un autre, qui met peut-tre mieux en
relief son unit, son individualit, la nettet avec laquelle il se dcoupe dans la
continuit du rel. Encore enfant en 1871, au lendemain de la guerre, j'avais,
comme tous ceux de ma gnration, considr une nouvelle guerre comme
imminente pendant les douze ou quinze annes qui suivirent. Puis cette guerre
nous apparut tout la fois comme probable et comme impossible : ide
complexe et contradictoire, qui persista jusqu' la date fatale. Elle ne suscitait
d'ailleurs dans notre esprit aucune image, en dehors de son expression verbale. Elle conserva son caractre abstrait jusqu'aux heures tragiques o le
conflit apparut comme invitable, jusqu'au dernier moment, alors qu'on
esprait contre tout espoir. Mais lorsque, le 4 aot 1914, dpliant un numro
du Matin, je lus en gros caractres L'Allemagne dclare la guerre la
France , j'eus la sensation soudaine d'une invisible prsence que tout le pass
aurait prpare et annonce, la manire d'une ombre prcdant le corps qui
la projette. Ce fut comme si un personnage de lgende, vad du livre o l'on
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
86
raconte son histoire, s'installait tranquillement dans la chambre. A vrai dire, je
n'avais pas affaire au personnage complet. Il n'y avait de lui que ce qui tait
ncessaire pour obtenir un certain effet. Il avait attendu son heure ; et sans
faon, familirement, il s'asseyait sa place. C'est pour intervenir ce
moment, en cet endroit, qu'il s'tait obscurment ml toute mon histoire.
C'est composer ce tableau, la pice avec son mobilier, le journal dpli sur
la table, moi debout devant elle, l'vnement imprgnant tout de sa prsence,
que visaient quarante-trois annes d'inquitude confuse. Malgr mon bouleversement, et bien qu'une guerre, mme victorieuse, m'appart comme une
catastrophe, j'prouvais ce que dit James, un sentiment d'admiration pour la
facilit avec laquelle s'tait effectu le passage de l'abstrait au concret : qui
aurait cru qu'une ventualit aussi formidable pt faire son entre dans le rel
avec aussi peu d'embarras ? Cette impression de simplicit dominait tout. En
y rflchissant, on s'aperoit que si la nature voulait opposer une raction
dfensive la peur, prvenir une contracture de la volont devant la reprsentation trop intelligente d'un cataclysme aux rpercussions sans fin, elle
susciterait prcisment entre nous et l'vnement simplifi, transmu en
personnalit lmentaire, cette camaraderie qui nous met notre aise, nous
dtend, et nous dispose faire tout bonnement notre devoir.
Il faut aller la recherche de ces impressions fuyantes, tout de suite
effaces par la rflexion, si l'on veut retrouver quelque chose de ce qu'ont pu
prouver nos plus lointains anctres. On n'hsiterait pas le faire, si l'on
n'tait imbu du prjug que les acquisitions intellectuelles et morales de
l'humanit, s'incorporant la substance des organismes individuels, se sont
transmises hrditairement. Nous natrions donc tout diffrents de ce que
furent nos anctres. Mais l'hrdit n'a pas cette vertu. Elle ne saurait transformer en dispositions naturelles les habitudes contractes de gnration en
gnration. Si elle avait quelque prise sur l'habitude, elle en aurait bien peu,
accidentellement et exceptionnellement ; elle n'en a sans doute aucune. Le
naturel est donc aujourd'hui ce qu'il fut toujours. Il est vrai que les choses se
passent comme s'il s'tait transforme, puisque tout l'acquis de la civilisation le
recouvre, la socit faonnant les individus par une ducation qui se poursuit
sans interruption depuis leur naissance. Mais qu'une surprise brusque paralyse
ces activits superficielles, que la lumire o elles travaillaient s'teigne pour
un instant : aussitt le naturel reparat, comme l'immuable toile dans la nuit.
Le psychologue qui veut remonter au primitif devra se transporter ces expriences exceptionnelles. Une lchera pas pour cela son fil conducteur, il
n'oubliera pas que la nature est utilitaire, et qu'il n'y a pas d'instinct qui n'ait sa
fonction ; les instincts qu'on pourrait appeler intellectuels sont des ractions
dfensives contre ce qu'il y aurait d'exagrment et surtout de prmaturment
intelligent dans l'intelligence. Mais les deux mthodes se prteront un mutuel
appui : l'une servira plutt la recherche, l'autre la vrification. C'est notre
orgueil, c'est un double orgueil qui nous dtourne ordinairement d'elles. Nous
voulons que l'homme naisse suprieur ce qu'il fut autrefois : comme si le
vrai mrite ne rsidait pas dans l'effort ! comme si une espce dont chaque
individu doit se hausser au-dessus de lui-mme, par une laborieuse assimilation de tout le pass, ne valait pas an moins autant que celle dont chaque
gnration serait porte globalement au-dessus des prcdentes par le jeu
automatique de l'hrdit ! Mais il y a encore un autre orgueil, celui de
l'intelligence, qui ne veut pas reconnatre son assujettissement originel des
ncessits biologiques. On n'tudierait pas une cellule, un tissu, un organe,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
87
sans s'occuper de sa fonction ; dans le domaine psychologique lui-mme, on
ne se croirait pas quitte envers un instinct si on ne le rattachait pas un besoin
de l'espce; mais une fois arriv l'intelligence, adieu la nature ! adieu la vie !
l'intelligence serait ce qu'elle est pour rien, pour le plaisir . Comme si elle
ne rpondait pas d'abord, elle aussi, des exigences vitales ! Son rle originel
est de rsoudre des problmes analogues a ceux que rsout l'instinct, par une
mthode trs diffrente, il est vrai, qui assure le progrs et qui ne se petit
pratiquer sans une indpendance thoriquement complte l'gard de la
nature. Mais cette indpendance est limite en fait : elle s'arrte au moment
prcis o l'intelligence irait contre son but, en lsant un intrt vital. L'intelligence est donc ncessairement surveille par l'instinct, ou plutt par la vie,
origine commune de l'instinct et de l'intelligence. Nous ne voulons pas dire
autre chose quand nous parlons d'instincts intellectuels : il s'agit de reprsentations formes par l'intelligence naturellement, pour s'assurer par certaines
convictions contre certains dangers de la connaissance. Telles sont donc les
tendances, telles sont aussi les expriences dont la psychologie doit tenir
compte si elle veut remonter aux origines.
L'tude des non-civiliss n'en sera pas moins prcieuse. Nous l'avons dit et
nous ne saurions trop le rpter : ils sont aussi loin que nous des origines,
mais ils ont moins invent. Ils ont donc d multiplier les applications, exagrer, caricaturer, enfin dformer plutt que transformer radicalement. Que
d'ailleurs il s'agisse de transformation ou de dformation, la forme originelle
subsiste, simplement recouverte par l'acquis , dans les deux cas, par consquent, le psychologue qui veut dcouvrir les origines aura un effort du mme
genre faire ; mais le chemin parcourir pourra tre moins long dans le
second que dans le premier. C'est ce qui arrivera, en particulier, quand on
trouvera des croyances semblables chez des peuplades qui n'ont pas pu
communiquer entre elles. Ces croyances ne sont pas ncessairement primitives, mais il y a des chances pour qu'elles soient venues tout droit d'une des
tendances fondamentales qu'un effort d'introspection nous ferait dcouvrir en
nous-mmes. Elles pourront donc nous mettre sur la voie de cette dcouverte
et guider l'observation interne qui servira ensuite les expliquer.
Revenons toujours ces considrations de mthode si nous ne voulons pas
nous garer dans notre recherche. Au tournant o nous sommes arrivs, nous
avons particulirement besoin d'elles. Car il ne s'agit de rien de moins que de
la raction de l'homme sa perception des choses, des vnements, de l'univers en gnral. Que l'intelligence soit faite pour utiliser la matire, dominer
les choses, matriser les vnements, cela n'est pas douteux. Que sa puissance
soit en raison directe de sa science, cela est non moins certain. Mais cette
science est d'abord trs limite ; minime est la portion du mcanisme universel qu'elle embrasse, de l'tendue et de la dure sur laquelle elle a prise. Que
fera-t-elle pour le reste ? Laisse elle-mme, elle constaterait simplement
son ignorance ; l'homme se sentirait perdu dans l'immensit. Mais l'instinct
veille. A la connaissance proprement scientifique, qui accompagne la technique ou qui s'y trouve implique, elle adjoint, pour tout ce qui chappe notre
action, la croyance des puissances qui tiendraient compte de l'homme.
L'univers se peuple ainsi d'intentions, d'ailleurs phmres et changeantes ;
seule relverait du pur mcanisme la zone l'intrieur de laquelle nous agissons mcaniquement. Cette zone s'largit mesure que notre civilisation
avance ; l'univers tout entier finit par prendre la forme d'un mcanisme aux
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
88
yeux d'une intelligence qui se reprsente idalement la science acheve. Nous
en sommes l, et un vigoureux effort d'introspection nous est aujourd'hui
ncessaire pour retrouver les croyances originelles que notre science recouvre
de tout ce qu'elle sait et de tout ce qu'elle espre savoir. Mais ds que nous les
tenons, nous voyons comment elles s'expliquent par le jeu combin de
l'intelligence et de l'instinct, comment elles ont d rpondre un intrt vital.
Considrant alors les non-civiliss, nous vrifions ce que nous avons observ,
en nous-mmes ; mais la croyance est ici enfle, exagre, multiplie : au lieu
de reculer, comme elle l'a fait chez le civilis, devant les progrs de la science,
elle envahit la zone rserve l'action mcanique et se superpose des
activits qui devraient l'exclure. Nous touchons ici un point essentiel. On a
dit que la religion avait commenc par la magie. Ou a vu aussi dans la magie
un prlude la science. Si l'on s'en tient la psychologie, comme nous venons
de le faire, Si l'on reconstitue, par un effort d'introspection, la raction naturelle de l'homme a sa perception des choses, on trouve que magie et religion
se tiennent, et qu'il n'y a rien de commun entre la magie et la science.
Nous venons de voir, en effet, que l'intelligence primitive fait deux parts
dans son exprience. Il y a, d'un ct, ce qui obit l'action de la main et de
l'outil, ce qu'on peut prvoir, ce dont on est sr : cette partie de l'univers est
conue physiquement, en attendant qu'elle le soit mathmatiquement ; elle
apparat comme un enchanement de causes et d'effets, ou en tout cas elle est
traite comme telle ; peu importe que la reprsentation soit indistincte, peine
consciente ; elle peut ne pas s'expliciter, mais, pour savoir ce qu'implicitemeut, l'intelligence pense, il suffit de regarder ce qu'elle fait. Maintenant il y
a, d'un autre ct, la partie de l'exprience sur laquelle l'homo faber ne se sent
plus aucune prise. Celle-l n'est plus traite physiquement, mais moralement.
Ne pouvant agir sur elle, nous esprons qu'elle agira pour nous. La nature
s'imprgnera donc ici d'humanit. Mais elle ne le fera que dans la mesure du
ncessaire. A dfaut de puissance, nous avons besoin de confiance. Pour que
nous nous sentions notre aise, il faut que l'vnement qui se dcoupe nos
yeux dans l'ensemble du rel paraisse anim d'une intention. Telle sera en
effet notre conviction naturelle et originelle. Mais nous ne nous en tiendrons
pas l. Il ne nous suffit pas de n'avoir rien craindre, nous voudrions en outre
avoir quelque chose esprer. Si l'vnement n'est pas compltement insensible, ne russirons-nous pas l'influencer ? Ne se laissera-t-il pas convaincre
ou contraindre ? Il le pourra difficilement, s'il reste ce qu'il est, intention qui
passe, me rudimentaire ; il n'aurait pas assez de personnalit pour exaucer
nos vux, et il en aurait trop pour tre nos ordres. Mais notre esprit le
poussera aisment dans l'une ou l'autre direction. La pression de l'instinct a
fait surgir en effet, au sein mme de l'intelligence, cette forme d'imagination
qu'est la fonction fabulatrice. Celle-ci n'a que se laisser aller pour fabriquer,
avec les personnalits lmentaires qui se dessinent primitivement, des dieux
de plus en plus levs comme ceux de la fable, ou des divinits de plus en
plus basses comme les simples esprits, ou mme des forces qui ne retiendront
de leur origine psychologique qu'une seule proprit, celle de n'tre pas purement mcaniques et de cder nos dsirs, de se plier nos volonts. La
premire et la deuxime directions sont celles de la religion, la troisime est
celle de la magie. Commenons par la dernire.
On a beaucoup parl de cette notion du mana qui fut signale jadis par
Codrington dans un livre fameux sur les Mlansiens, et dont on retrouverait
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
89
l'quivalent, ou plutt l'analogue, chez beaucoup d'autres primitifs : tels
seraient l'orenda des Iroquois, le wakanda des Sioux, etc. Tous ces mots
dsigneraient une force rpandue travers la nature et dont participeraient
des degrs diffrents, sinon toutes choses, du moins certaines d'entre elles. De
l l'hypothse d'une philosophie primitive, qui se dessinerait dans l'esprit
humain ds qu'il commence rflchir, il n'y a qu'un pas. Certains ont
suppos en effet qu'un vague panthisme hantait la pense des non-civiliss.
Mais il est peu vraisemblable que l'humanit dbute par des notions aussi
gnrales et aussi abstraites. Avant de philosopher, il faut vivre. Savants et
philosophes sont trop ports croire que la pense s'exerce chez tous comme
chez eux, pour le plaisir. La vrit est qu'elle vise l'action, et que si l'on trouve
rellement chez les non-civiliss quelque philosophie, celle-ci doit tre joue
plutt que pense ; elle est implique dans tout un ensemble d'oprations
utiles, ou juges telles ; elle ne s'en dgage, elle ne s'exprime par des mots ncessairement vagues d'ailleurs - que pour la commodit de l'action. MM.
Hubert et Mauss, dans leur trs intressante Thorie gnrale de la Magie, ont
montr avec force que la croyance la magie est insparable de la conception
dit mana. Il semble que, d'aprs eux, cette croyance drive de cette conception. La relation, ne serait-elle pas plutt inverse ? Il ne nous parat pas
probable que a reprsentation correspondant des termes tels que mana ,
orenda , etc., ait t forme d'abord, et que la magie soit sortie d'elle. Bien
au Contraire, c'est parce que l'homme croyait la magie, parce qu'il la pratiquait, qu'il se serait reprsent ainsi les choses : sa magie paraissait russir,
et il se bornait en expliquer ou plutt en exprimer le succs. Que d'ailleurs
il ait tout de suite pratiqu la magie, on le comprend aisment : tout de suite il
a reconnu que la limite de son influence normale sur le monde extrieur tait
vite atteinte, et il ne se rsignait pas ne pas aller plus loin. Il continuait donc
le mouvement, et comme, par lui-mme, le mouvement n'obtenait pas l'effet
dsir, il fallait que la nature s'en charget. Ce ne pouvait tre que si la
matire tait en quelque sorte aimante, si elle se tournait d'elle-mme vers
l'homme, pour recevoir de lui des missions, pour excuter ses ordres. Elle n'en
restait pas moins soumise, comme nous dirions aujourd'hui, des lois
physiques ; il le fallait bien, pour qu'on et prise mcaniquement sur elle.
Mais elle tait en outre imprgne d'humanit, je veux dire charge d'une
force capable d'entrer dans les desseins de l'homme. De cette disposition
l'homme pouvait profiter, pour prolonger son action au del de ce que permettaient les lois physiques. C'est de quoi l'on s'assurera sans peine, si l'on
considre les procds de la magie et les conceptions de la matire par
lesquelles on se reprsentait confusment qu'elle pt russir.
Les oprations ont t souvent dcrites, mais comme applications de
certains principes thoriques tels que : le semblable agit sur le semblable ,
la partie vaut pour le tout , etc. Que ces formules puissent Servir classer
les oprations magiques, cela n'est pas douteux. Mais il ne s'ensuit nullement
que les oprations magiques drivent d'elles. Si l'intelligence primitive avait
commence ici par concevoir des principes, elle se ft bien vite rendue
l'exprience, qui lui en et dmontr la fausset. Mais ici encore elle ne fait
que traduire en reprsentation des suggestions de l'instinct. Plus prcisment,
il y a une logique du corps, prolongement du dsir, qui s'exerce bien avant que
l'intelligence lui ait trouv une forme conceptuelle.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
90
Voici par exemple un primitif qui voudrait tuer son ennemi ; mais
l'ennemi est loin ; impossible de l'atteindre. N'importe ! notre homme est en
rage ; il fait le geste de se prcipiter sur l'absent. Une fois lanc, il va jusqu'au
bout ; il serre entre ses doigts la victime qu'il croit ou qu'il voudrait tenir, il
l'trangle. Il sait pourtant bien que le rsultat n'est pas complet. Il a fait tout ce
qui dpendait de lui : il veut, il exige que les choses se chargent du reste. Elles
ne le feront pas mcaniquement. Elles ne cderont pas une ncessit physique, comme lorsque notre homme frappait le sol, remuait bras et jambes,
obtenait enfin de la matire les ractions correspondant ses actions. Il faut
donc qu' la ncessit de restituer mcaniquement les mouvements reus la
matire joigne la facult d'accomplir des dsirs et d'obir des ordres. Ce ne
sera pas impossible, si la nature incline dj par elle-mme tenir compte de
lhomme. Il suffira que la condescendance dont tmoignent certains vnements se retrouve dans des choses. Celles-ci seront alors plus ou moins
charges d'obissance et de puissance ; elles disposeront d'une force qui se
prte aux dsirs de l'homme et dont l'homme pourra s'emparer. Des mots tels
que mana , wakonda , etc., expriment cette force en mme temps que le
prestige qui l'entoure. Ils n'ont pas tous le mme sens, si l'on veut un sens
prcis ; mais tous correspondent la mme ide vague. Ils dsignent ce qui
fait que les choses se prtent aux oprations de la magie. Quant ces oprations elles-mmes nous venons d'en dterminer la nature. Elles commencent
l'acte que l'homme ne peut pas achever. Elles font le geste qui n'irait pas
jusqu' produire l'effet dsir, mais qui l'obtiendra si l'homme sait forcer la
complaisance des choses.
La magie est donc inne l'homme, n'tant que l'extriorisation d'un dsir
dont le cur est rempli. Si elle a paru artificielle, si on l'a ramene des
associations d'ides superficielles, c'est parce qu'on l'a considre dans des
oprations qui sont prcisment faites pour dispenser le magicien d'y mettre
son me et pour obtenir sans fatigue le mme rsultat. L'acteur qui tudie son
rle se donne pour tout de bon l'motion qu'il doit exprimer ; il note les gestes
et les intonations qui sortent d'elle : plus tard, devant le publie, il ne reproduira que l'intonation et le geste, il pourra faire l'conomie de l'motion. Ainsi
pour la magie. Les lois qu'on lui a trouves ne nous disent rien de l'lan
naturel d'o elle est sortie. Elles ne sont que la formule des procds que la
paresse a suggrs cette magie originelle pour s'imiter elle-mme.
Elle procde d'abord, nous dit-on, de ce que le semblable produit le
semblable . On ne voit pas pourquoi l'humanit commencerait par poser une
loi aussi abstraite et arbitraire. Mais on comprend qu'aprs avoir fait instinctivement le geste de se prcipiter sur l'ennemi absent, aprs s'tre persuad
lui-mme que sa colre, lance dans l'espace et vhicule par une matire
complaisante, ira achever l'acte commenc, l'homme dsire obtenir le mme
effet sans avoir se mettre dans le mme tat. Il rptera donc l'opration
froid. L'acte dont sa colre traait le dessin quand il croyait serrer entre ses
doigts un ennemi qu'il tranglait, il le reproduira l'aide d'un dessin tout fait,
d'une poupe sur les contours de laquelle il n'aura plus qu' repasser. C'est
ainsi qu'il pratiquera l'envotement. La poupe dont il se servira n'a d'ailleurs
pas besoin de ressembler l'ennemi, puisque son rle est uniquement de faire
que l'acte se ressemble lui-mme. Telle nous parat tre l'origine psychologique d'un principe dont la formule serait plutt : Le semblable quivaut
au semblable , ou mieux encore, en termes plus prcis : Le statique peut
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
91
remplacer le dynamique dont il donne le schma. Sous cette dernire forme,
qui rappelle son origine, il ne se prterait pas une extension indfinie. Mais,
sous la premire, il autorise croire qu'on peut agir sur un objet lointain par
l'intermdiaire d'un objet prsent ayant avec lui la ressemblance la plus
superficielle. Il n'a mme pas besoin d'tre dgag et formul. Simplement
impliqu dans une opration presque instinctive, il permet cette magie
naturelle de prolifrer indfiniment.
Les pratiques magiques se ramnent d'autres lois encore : On peut
influencer un tre ou une chose en agissant sur ce qui les a touchs , la
partie vaut pour le tout , etc. Mais l'origine psychologique reste la mme. Il
s'agit toujours de rpter tte repose, en se persuadant qu'il est efficace,
l'acte qui a donn la perception quasi hallucinatoire de son efficacit quand il
tait accompli dans un moment d'exaltation. En temps de scheresse on
demande au magicien d'obtenir la pluie. S'il y mettait encore toute son me, il
se hausserait par un effort d'imagination jusqu'au nuage, il croirait sentir qu'il
le crve, il le rpandrait en gouttelettes. Mais il trouvera plus simple de se
supposer presque redescendu terre, et de verser alors un peu d'eau : cette
minime partie de l'vnement le reproduira tout entier, si l'effort qu'il et fallu
lancer de la terre au ciel trouve moyen de se faire suppler et si la matire
intermdiaire est plus ou moins charge - comme elle pourrait l'tre d'lectricit positive ou ngative - d'une disposition semi-physique et semi-morale
servir ou contrarier l'homme. On voit comment il y a une magie naturelle,
trs simple, qui se rduirait un petit nombre de pratiques. C'est la rflexion
sur ces pratiques, ou peut-tre simplement leur traduction en mots, qui leur a
permis de se multiplier dans tous les sens et de se charger de toutes les
superstitions, parce que la formule dpasse toujours le fait qu'elle exprime.
La magie nous parat donc se rsoudre en deux lments : le dsir d'agir
sur n'importe quoi, mme sur ce qu'on ne peut atteindre, et l'ide que les
choses sont charges, ou se laissent charger, de ce que nous appellerions un
fluide humain. Il faut se reporter au premier point pour comparer entre elles la
magie et la science, et au second pour rattacher la magie la religion.
Qu'il soit arriv la magie de servir la science accidentellement, c'est
possible : on ne manipule pas la matire sans en tirer quelque profit. Encore
faut-il, pour utiliser une observation ou mme simplement pour la noter, avoir
dj quelque propension la recherche scientifique. Mais, par l, on n'est plus
magicien, on tourne mme le dos la magie. Il est facile, en effet, de dfinir
la science, puisqu'elle a toujours travaill dans la mme direction. Elle mesure
et calcule, en vue de prvoir et d'agir. Elle suppose d'abord, elle constate
ensuite que l'univers est rgi par des lois mathmatiques. Bref, tout progrs de
la science consiste dans une connaissance plus tendue et dans une plus riche
utilisation du mcanisme universel. Ce progrs s'accomplit d'ailleurs par un
effort de notre intelligence, qui est faite pour diriger notre action sur les
choses, et dont la structure doit par consquent tre calque sur la configuration mathmatique de l'univers. Quoique nous n'ayons agir que sur les
objets qui nous entourent, et quoique telle ait t la destination primitive de
l'intelligence, nanmoins, comme la mcanique de l'univers est prsente
chacune de ses parties, il a bien fallu que l'homme naquit avec une intelligence virtuellement capable d'embrasser le monde matriel tout entier. Il en
est de l'intellection comme de la vision : l'il n'a t fait, lui aussi, que pour
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
92
nous rvler les objets sur lesquels nous sommes en tat d'agir; mais de mme
que la nature n'a pu obtenir le degr voulu de vision que par un dispositif dont
l'effet dpasse son objet (puisque nous voyons les toiles, alors que nous
sommes sans action sur elles), ainsi elle nous donnait ncessairement, avec la
facult de comprendre la matire que nous manipulons, la connaissance
virtuelle du reste et le pouvoir non moins virtuel de l'utiliser. Il est vrai qu'il y
a loin ici du virtuel l'actuel. Tout progrs effectif, dans le domaine de la
connaissance comme dans celui de l'action, a exige l'effort persvrant d'un ou
de plusieurs hommes suprieurs. Ce fut chaque fois une cration, que la
nature avait sans doute rendue possible en nous octroyant une intelligence
dont la forme dpasse la matire, mais qui allait pour ainsi dire au del de ce
que la nature avait voulu. L'organisation de l'homme semblait en effet le
prdestiner une vie plus modeste. Sa rsistance instinctive aux innovations
en est la preuve. L'inertie de l'humanit n'a jamais cd qu' la pousse du
gnie. Bref, la science exige un double effort, celui de quelques hommes pour
trouver du nouveau, celui de tous les autres hommes pour adopter et s'adapter.
Une socit peut tre dite civilise ds qu'on y trouve la fois ces initiatives
et cette docilit. La seconde condition est d'ailleurs plus difficile remplir que
la premire. Ce qui a manqu aux non-civiliss, ce n'est probablement pas
l'homme suprieur (on ne voit pas pourquoi la nature n'aurait pas eu toujours
et partout de ces distractions heureuses), c'est plutt l'occasion fournie un tel
homme de montrer sa supriorit, c'est la disposition des autres le suivre.
Quand une socit sera dj entre dans la voie de la civilisation, la perspective d'un simple accroissement de bien-tre suffira sans doute vaincre sa
routine. Mais pour qu'elle y entre, pour que le premier dclenchement se
produise, il faut beaucoup plus : peut-tre une menace d'extermination comme
celle que cre l'apparition d'une arme nouvelle dans une tribu ennemie. Les
socits qui sont restes plus ou moins primitives sont probablement
celles qui n'ont pas eu de voisins, plus gnralement celles qui ont eu la vie
trop facile. Elles taient dispenses de l'effort initial. Ensuite ce fut trop tard :
la socit ne pouvait plus avancer, mme si elle l'avait voulu, parce qu'elle
tait intoxique par les produits de sa paresse. Ces produits sont prcisment
les pratiques de la magie, tout au moins dans ce qu'elles ont de surabondant et
d'envahissant. Car la magie est l'inverse de la science. Tant que l'inertie du
milieu ne la fait pas prolifrer, elle a sa raison d'tre. Elle calme provisoirement l'inquitude d'une intelligence dont la forme dpasse la matire, qui se
rend vaguement compte de son ignorance et en comprend le danger, qui
devine, autour du trs petit cercle o l'action est sre de son effet, o l'avenir
immdiat est prvisible et o par consquent il y a dj science, une zone
immense d'imprvisibilit qui pourrait dcourager d'agir. Il faut pourtant agir
quand mme. La magie intervient alors, effet immdiat de la pousse vitale.
Elle reculera au fur et mesure que l'homme largira sa connaissance par
l'effort. En attendant, comme elle parat russir (puisque l'insuccs d'une
opration magique peut toujours tre attribu au succs de quelque magie
antagoniste) elle produit le mme effet moral que la science. Mais elle n'a que
cela de commun avec la science, dont elle est spare par toute la distance
qu'il y a entre dsirer et vouloir. Bien loin de prparer la venue de la science,
comme on l'a prtendu, elle a t le grand obstacle contre lequel le savoir
mthodique eut lutter. L'homme civilis est celui chez lequel la science
naissante, implique dans l'action quotidienne, a pu empiter, grce une
volont sans cesse tendue, sur la magie qui occupait le reste du terrain. Le
non-civilis est au contraire celui qui, ddaignant l'effort, a laiss la magie
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
93
pntrer jusque dans la zone de la science naissante, se superposer elle, la
masquer au point de nous faire croire une mentalit originelle d'o toute
vraie science serait absente. D'ailleurs, une fois matresse de la place, elle
excute mille et mille variations sur elle-mme, plus fconde que la science
puisque ses inventions sont fantaisie pure et ne cotent rien. Ne parlons donc
pas d'une re de la magie laquelle aurait succd celle de la science. Disons
que science et magie sont galement naturelles, qu'elles ont toujours coexist,
que notre science est normment plus vaste que celle de nos lointains
anctres, mais que ceux-ci devaient tre beaucoup moins magiciens que les
non-civiliss d'aujourd'hui. Nous sommes rests, au fond, ce qu'ils taient.
Refoule par la science, l'inclination la magie subsiste et attend son heure.
Que l'attention la science se laisse un moment distraire, aussitt la magie fait
irruption dans notre socit civilise, comme profite du plus lger sommeil,
pour se satisfaire dans un rve, le dsir rprim pendant la veille.
Reste alors la question des rapports de la magie avec la religion. Tout
dpend videmment de la signification de ce dernier terme. Le philosophe
tudie le plus souvent une chose que le sens commun a dj dsigne par un
mot. Cette chose peut n'avoir t qu'entrevue; elle peut avoir t mal vue ; elle
peut avoir t jete ple-mle avec d'autres dont il faudra l'isoler. Elle peut
mme n'avoir t dcoupe dans l'ensemble de la ralit que pour la commodit du discours et ne pas constituer effectivement une chose, se prtant une
tude indpendante. L est la grande infriorit de la philosophie par rapport
aux mathmatiques et mme aux sciences de la nature. Elle doit partir de la
dsarticulation du rel qui a t opre par le langage, et qui est peut-tre
toute relative aux besoins de la cit : trop souvent elle oublie cette origine, et
procde comme ferait le gographe qui, pour dlimiter les diverses rgions du
globe et marquer les relations physiques qu'elles ont entre elles, s'en rapporterait aux frontires tablies par les traits. Dans l'tude que nous avons
entreprise, nous avons par ce danger en nous transportant immdiatement
du mot religion , et de tout ce qu'il embrasse en vertu d'une dsarticulation
peut-tre artificielle des choses, une certaine fonction de l'esprit qu'on peut
observer directement sans s'occuper de la rpartition du rel en concepts
correspondant des mots. Analysant le travail de la fonction, nous avons
retrouv un un plusieurs des sens qu'on donne au mot religion. Poursuivant
notre tude, nous retrouverons les autres nuances de signification et nous en
ajouterons peut-tre une ou deux nouvelles. Il sera donc bien tabli que le mot
circonscrit cette fois une ralit. Une ralit qui dbordera quelque peu, il est
vrai, vers le bas et vers le haut, la signification usuelle du mot. Mais nous la
saisirons alors en elle-mme, dans sa structure et dans son principe, comme il
arrive quand on rattache une fonction physiologique, telle que la digestion,
un grand nombre de faits observs dans diverses rgions de l'organisme et
quand on en dcouvre mme ainsi de nouveaux. Si l'on se place ce point de
vue, la magie fait videmment partie de la religion. Il ne s'agit sans doute que
de la religion infrieure, celle dont nous nous sommes occupes jusqu'
prsent. Mais la magie, comme cette religion en gnral, reprsente une prcaution de la nature contre certains dangers que court l'tre intelligent. Maintenant, on peut suivre une autre marche, partir des divers sens usuels du
mot religion, les comparer entre eux et dgager une signification moyenne :
on aura ainsi rsolu une question de lexique plutt qu'un problme philosophique ; mais peu importe, pourvu qu'on se rende compte de ce qu'on fait, et
qu'on ne s'imagine pas (illusion constante des philosophes !) possder
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
94
l'essence de la chose quand on s'est mis d'accord sur le sens conventionnel du
mot. Disposons alors toutes les acceptions de notre mot le long d'une chelle,
comme les nuances du spectre ou les notes de la gamme : nous trouverons
dans la rgion moyenne, gale distance des deux extrmes, l'adoration de
dieux auxquels on s'adresse par la prire. Il va sans dire que la religion, ainsi
conue, s'oppose alors la magie. Celle-ci est essentiellement goste, celle-l
admet et souvent mme exige le dsintressement. L'une prtend forcer le
consentement de la nature, l'autre implore la faveur du dieu. Surtout, la magie
s'exerce dans un milieu semi-physique et semi-moral ; le magicien n'a pas
affaire, en tout cas, une personne ; c'est au contraire la personnalit du dieu
que la religion emprunte sa plus grande efficacit. Si l'on admet, avec nous,
que l'intelligence primitive croit apercevoir autour d'elle, dans les phnomnes
et dans les vnements, des lments de personnalit plutt que des personnalits compltes, la religion, telle que nous venons de l'entendre, finira par
renforcer ces lments au point de les convertir en personnes, tandis que la
magie les suppose dgrads et comme dissous dans un monde matriel o leur
efficacit peut tre capte. Magie et religion divergent alors partir d'une
origine commune, et il ne peut tre question de faire sortir la religion de la
magie : elles sont contemporaines. On comprend d'ailleurs que chacune des
deux continue hanter l'autre, qu'il subsiste quelque magie dans la religion, et
surtout quelque religion dans la magie. On sait que le magicien opre parfois
par l'intermdiaire des esprits, c'est--dire d'tres relativement individualiss,
mais qui n'ont pas la personnalit complte, ni la dignit minente des dieux.
D'autre part, l'incantation peut participer la fois du commandement et de la
prire.
L'histoire des religions a longtemps tenu pour primitive, et pour explicative de tout le reste, la croyance aux esprits. Comme chacun de nous a son
me, essence plus subtile que celle du corps, ainsi, dans la nature, toute chose
serait anime ; une entit vaguement spirituelle l'accompagnerait. Les esprits
une fois poss, l'humanit aurait pass de la croyance l'adoration. Il y aurait
donc une philosophie naturelle, l'animisme, d'o serait sortie la religion. A
cette hypothse on semble en prfrer aujourd'hui une autre. Dans une phase
pranimiste ou animatiste , l'humanit se serait reprsent une force
impersonnelle telle que le mana polynsien, rpandue dans le tout, ingalement distribue entre les parties ; elle ne serait venue que plus tard aux
esprits. Si nos analyses sont exactes, ce n'est pas une force impersonnelle, ce
ne sont pas des esprits dj individualiss qu'on aurait conus d'abord ; on
aurait simplement prt des intentions aux choses et aux vnements, comme
si la nature avait partout des yeux qu'elle tourne vers l'homme. Qu'il y ait bien
l une disposition originelle, c'est ce que nous pouvons constater quand un
choc brusque rveille l'homme primitif qui sommeille au fond de chacun de
nous. Ce que nous prouvons alors, c'est le sentiment d'une prsence efficace ;
peu importe d'ailleurs la nature de cette prsence, l'essentiel est son efficacit :
du moment qu'on s'occupe de nous, l'intention peut n'tre pas toujours bonne,
nous comptons du moins dans l'univers. Voil ce que dit l'exprience. Mais a
priori, il tait dj invraisemblable que l'humanit et commenc par des vues
thoriques, quelles qu'elles fussent. Nous ne cesserons de le rpter : avant de
philosopher, il faut vivre ; c'est d'une ncessit vitale qu'ont d sortir les
dispositions et les convictions originelles. Rattacher la religion un systme
d'ides, une logique ou une prlogique , c'est faire de nos plus lointains
anctres des intellectuels, et des intellectuels comme il devrait y en avoir
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
95
davantage parmi nous, car nous voyons les plus belles thories flchir devant
la passion et l'intrt et ne compter qu'aux heures o l'on spcule, tandis
qu'aux anciennes religions tait suspendue la vie entire. La vrit est que la
religion, tant coextensive notre espce, doit tenir notre structure. Nous
venons de la rattacher une exprience fondamentale ; mais cette exprience
elle-mme, on la pressentirait avant de l'avoir faite, en tout cas on se
l'explique fort bien aprs l'avoir eue ; il suffit pour cela de replacer l'homme
dans l'ensemble des vivants, et la psychologie dans la biologie. Considrons,
en effet, un animal autre que l'homme. Il use de tout ce qui peut le servir.
Croit-il prcisment que le monde soit fait pour lui ? Non, sans doute, car il ne
se reprsente pas le monde, et n'a d'ailleurs aucune envie de spculer. Mais
comme il ne voit, en tout cas ne regarde, que ce qui peut satisfaire ses besoins,
comme les choses n'existent pour lui que dans la mesure o il usera d'elles, il
se comporte videmment comme si tout tait combin dans la nature en vue
de son bien et dans l'intrt de son espce. Telle est sa conviction vcue ; elle
le soutient, elle se confond d'ailleurs avec son effort pour vivre. Faites
maintenant surgir la rflexion: cette conviction s'vanouira ; l'homme va se
percevoir et se penser comme un point dans l'immensit de l'univers. Il se
sentirait perdu, si l'effort pour vivre ne projetait aussitt dans son intelligence,
la place mme que cette perception et cette pense allaient prendre, l'image
antagoniste d'une conversion des choses et des vnements vers l'homme :
bienveillante ou malveillante, une intention de l'entourage le suit partout,
comme la lune parat courir avec lui quand il court. Si elle est bonne, il se
reposera sur elle. Si elle lui veut du mal, il tchera d'en dtourner l'effet. De
toute manire, il aura t pris en considration. Point de thorie, nulle place
pour l'arbitraire. La conviction s'impose parce qu'elle n'a rien de philosophique, tant d'ordre vital.
Si d'ailleurs elle se scinde et volue dans deux directions divergentes, d'un
ct vers la croyance des esprits dj individualiss et de l'autre vers l'ide
d'une essence impersonnelle, ce n'est pas pour des raisons thoriques : cellesci appellent la controverse, admettent le doute, suscitent des doctrines qui
peuvent influer sur la conduite mais qui ne se mlent pas tous les incidents
de l'existence et ne sauraient devenir rgulatrices de la vie entire. La vrit
est que, la conviction une fois installe dans la volont, celle-ci la pousse dans
les directions qu'elle trouve ouvertes ou qui s'ouvrent sur les points de
moindre rsistance au cours de son effort. L'intention qu'elle sent prsente,
elle 1'utlisera par tous les moyens, soit en la prenant dans ce qu'elle a de
physiquement efficace, en s'exagrant mme ce qu'elle a de matriel et en
tchant alors de la matriser par la force, soit en l'abordant par le ct moral,
en la poussant au contraire dans le sens de la personnalit pour la gagner par
la prire. C'est donc de l'exigence d'une magie efficace qu'est sortie une
conception comme celle du mana, appauvrissement ou matrialisation de la
croyance originelle ; et c'est le besoin d'obtenir des faveurs qui a tir de cette
mme croyance, dans la direction inverse, les esprits et les dieux. Ni
l'impersonnel n'a volu vers le personnel, ni de pures personnalits n'ont t
poses d'abord ; mais de quelque chose d'intermdiaire, fait pour soutenir la
volont plutt que pour clairer l'intelligence, sont sorties par dissociation,
vers le bas et vers le haut, les forces sur lesquelles pse la magie et les dieux
auxquels montent les prires.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
96
Nous nous sommes expliqu sur le premier point. Nous aurions fort faire
si nous devions nous tendre sur le second. L'ascension graduelle de la
religion vers des dieux dont la personnalit est de plus en plus marque, qui
entretiennent entre eux des rapports de mieux en mieux dfinis ou qui tendent
s'absorber dans une divinit unique, correspond au premier des deux grands
progrs de l'humanit dans le sens de la civilisation. Elle s'est poursuivie
jusqu'au jour o l'esprit religieux se tourna du dehors au dedans, du statique
au dynamique, par une conversion analogue celle qu'excuta la pure
intelligence quand elle passa de la considration des grandeurs finies au calcul
diffrentiel. Ce dernier changement fut sans doute dcisif; des transformations
de l'individu devinrent possibles, comme celles qui ont donn les espces
successives dans le monde organis ; le progrs put dsormais consister dans
une cration de qualits nouvelles, et non plus dans un simple agrandissement; au lieu de profiter seulement de la vie, sur place, au point o l'on s'est
arrt, on continuera maintenant le mouvement vital. De cette religion tout
intrieure nous traiterons dans le prochain chapitre. Nous verrons qu'elle
soutient l'homme par le mouvement mme qu'elle lui imprime en le replaant
dans l'lan crateur, et non plus par des reprsentations imaginatives auxquelles il adossera son activit dans l'immobilit. Mais nous verrons aussi que
le dynamisme religieux a besoin de la religion statique pour s'exprimer et se
rpandre. On comprend donc que celle-ci tienne la premire place dans
l'histoire des religions. Encore une fois, nous n'avons pas la suivre dans
l'immense varit de ses manifestations. Il suffira d'indiquer les principales, et
d'en marquer l'enchanement.
Partons donc de l'ide qu'il y a des intentions inhrentes aux choses : nous
arriverons tout de suite nous reprsenter des esprits. Ce sont les vagues entits qui peuplent, par exemple, les sources, les fleuves, les fontaines. Chaque
esprit est attach l'endroit o il se manifeste. Il se distingue dj par l de la
divinit proprement dite, qui saura se partager, sans se diviser, entre des lieux
diffrents, et rgir tout ce qui appartient un mme genre. Celle-ci portera un
nom ; elle aura sa figure elle, sa personnalit bien marque, taudis que les
mille esprits des bois ou des sources sont des exemplaires du mme modle et
pourraient tout au plus dire avec Horace : Nos numerus sumus. Plus tard,
quand la religion se sera leve jusqu' ces grands personnages que sont les
dieux, elle pourra concevoir les esprits leur image : ceux-ci seront des dieux
infrieurs ; ils paratront alors l'avoir toujours t. Mais ils ne l'auront t que
par un effet rtroactif. Il a sans doute fallu bien du temps, chez les Grecs, pour
que l'esprit de la source devnt une nymphe gracieuse et celui du bois une
Hamadryade. Primitivement, l'esprit de la source n'a d tre que la source
mme, en tant que bienfaitrice de l'homme. Plus prcisment, il tait cette
action bienfaisante, dans ce qu'elle a de permanent. On aurait tort de prendre
ici pour une ide abstraite, je veux dire extraite des choses par un effort
intellectuel, la reprsentation de l'acte et de sa continuation. C'est une donne
immdiate des sens. Notre philosophie et notre langage posent la substance
d'abord, l'entourent d'attributs, et en font alors sortir des actes comme des
manations. Mais nous ne saurions trop le rpter : il arrive l'action de
s'offrir d'abord et de se suffire elle-mme, surtout dans les cas o elle
intresse particulirement l'homme. Tel est l'acte de nous verser boire : on
peut le localiser dans une chose, puis dans une personne ; mais il a son existence propre, indpendante ; et s'il se continue indfiniment, sa persistance
mme l'rigera en esprit animateur de la source o l'on boit, tandis que la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
97
source, isole de la fonction qu'elle accomplit, passera d'autant plus compltement l'tat de simple chose. Il est vrai que les mes des morts viennent
tout naturellement rejoindre les esprits : dtaches de leur corps, elles n'ont
pas tout fait renonc leur personnalit. En se mlant aux esprits, elles
dteignent ncessairement sur eux et les prparent, par les nuances dont elles
les colorent, devenir des personnes. Ainsi, par des voies diffrentes mais
convergentes, les esprits s'achemineront la personnalit complte. Mais,
sous la forme lmentaire qu'ils avaient d'abord, ils rpondent un besoin si
naturel qu'il ne faut pas s'tonner si la croyance aux esprits se retrouve au fond
de toutes les anciennes religions. Nous parlions du rle qu'elle joua chez les
Grecs : aprs avoir t leur religion primitive, autant qu'on en peut juger par la
civilisation mycnienne, elle resta religion populaire. Ce fut le fond de la
religion romaine, mme aprs que la plus large place et t faite aux grandes
divinits importes de Grce et d'ailleurs : le lar familiaris, qui tait l'esprit de
la maison, conservera toujours son importance. Chez les Romains comme
chez les Grecs, la desse qui s'appela Hestia ou Vesta a d n'tre d'abord que
la flamme du foyer envisage dans sa fonction, je veux dire dans son intention
bienfaisante. Quittons l'antiquit classique, transportons-nous dans l'Inde, en
Chine, au Japon: partout nous retrouverons la croyance aux esprits; on assure
qu'aujourd'hui encore elle constitue (avec le culte des anctres, qui en est trs
voisin) l'essentiel de la religion chinoise. Parce qu'elle est universelle, on
s'tait aisment persuad qu'elle tait originelle. Constatons du moins qu'elle
n'est pas loin des origines, et que l'esprit humain passe naturellement par elle
avant d'arriver l'adoration des dieux.
Il pourrait d'ailleurs s'arrter une tape intermdiaire. Nous voulons
parler du culte des animaux, si rpandu dans l'humanit d'autrefois que
certains l'ont considr comme plus naturel encore que l'adoration des dieux
forme humaine. Nous le voyons se conserver, vivace et tenace, l mme o
l'homme se reprsente dj des dieux son image. C'est ainsi qu'il subsista
jusqu'au bout dans l'ancienne gypte. Parfois le dieu qui a merg de la forme
animale refuse de l'abandonner tout fait ; son corps d'homme il superposera une tte d'animal. Tout cela nous surprend aujourd'hui. C'est surtout
parce que l'homme a pris nos yeux une dignit minente. Nous le caractrisons par l'intelligence, et nous savons qu'il n'y a pas de supriorit que
l'intelligence ne puisse nous donner, pas d'infriorit qu'elle ne sache compenser. Il n'en tait pas ainsi lorsque l'intelligence n'avait pas encore fait ses
preuves. Ses inventions taient trop rares pour qu'appart sa puissance
indfinie d'inventer ; les armes et les outils qu'elle procurait l'homme
supportaient mal la comparaison avec ceux que l'animal tenait de la nature. La
rflexion mme, qui est le secret de sa force, pouvait faire l'effet d'une
faiblesse, car elle est source d'indcision, tandis que la raction de l'animal,
quand elle est proprement instinctive, est immdiate et sre. Il n'est pas
jusqu' l'incapacit de parler qui n'ait servi l'animal en l'aurolant de mystre.
Son silence peut d'ailleurs passer aussi pour du ddain, comme s'il avait
mieux faire que d'entrer en conversation avec nous. Tout cela explique que
l'humanit n'ait pas rpugn au culte des animaux. Mais pourquoi y est-elle
venue ? On remarquera que c'est en raison d'une proprit caractristique que
l'animal est ador. Dans l'ancienne gypte, le taureau figurait la puissance de
combat ; la lionne tait destruction; le vautour, si attentif ses petits,
maternit. Or, nous ne comprendrions certainement pas que l'animal ft
devenu l'objet d'un culte si l'homme avait commence par croire des esprits.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
98
Mais si ce n'est pas des tres, si c'est des actions bienfaisantes ou
malfaisantes, envisages comme permanentes, qu'on s'est adress d'abord, il
est naturel qu'aprs avoir capt des actions on ait voulu s'approprier des
qualits : ces qualits semblaient se prsenter l'tat pur chez l'animal, dont
l'activit est simple, tout d'une pice, oriente en apparence dans une seule
direction. L'adoration de l'animal n'a donc pas t la religion primitive ; mais,
au sortir de celle-ci, on avait le choix entre le culte des esprits et celui des
animaux.
En mme temps que la nature de l'animal semble se concentrer en une
qualit unique, on dirait que son individualit se dissout dans un genre. Reconnatre un homme consiste le distinguer des autres hommes ; mais reconnatre un animal est ordinairement se rendre compte de l'espce laquelle il
appartient : tel est notre intrt dans l'un et dans l'autre cas ; il en rsulte que
notre perception saisit les traits individuels dans le premier, tandis qu'elle les
laisse presque toujours chapper dans le second. Un animal a donc beau tre
du concret et de l'individuel, il apparat essentiellement comme une qualit,
essentiellement aussi comme un genre. De ces deux apparences, la premire,
comme nous venons de le voir, explique en grande partie le culte des animaux. La seconde ferait comprendre dans une certaine mesure, croyons-nous,
cette chose singulire qu'est le totmisme. Nous n'avons pas l'tudier ici ;
nous ne pouvons cependant nous dispenser d'en dire un mot, car si le
totmisme n'est pas de la zooltrie, il implique nanmoins que l'homme traite
une espce animale, ou mme vgtale, parfois un simple objet inanim, avec
une dfrence qui n'est pas sans ressembler de la religion. Prenons le cas le
plus frquent : il s'agit d'un animal, le rat ou le kangourou, par exemple, qui
sert de totem , c'est--dire de patron, tout un clan. Ce qu'il y a de plus
frappant, c'est que les membres du clan dclarent ne faire qu'un avec lui; ils
sont des rats, ils sont des kangourous. Reste savoir, il est vrai, dans quel sens
ils le disent. Conclure tout de suite une logique spciale, propre au primitif et affranchie du principe de contradiction, serait aller un peu vite en
besogne. Notre verbe tre a des significations que nous avons de la peine
dfinir, tout civiliss que nous sommes : comment reconstituer le sens que le
primitif donne dans tel ou tel cas un mot analogue, mme quand il nous
fournit des explications ? Ces explications n'auraient quelque prcision que
s'il tait philosophe, et il faudrait alors connatre toutes les subtilits de sa
langue pour les comprendre. Songeons au jugement qu'il porterait de son ct
sur nous, sur nos facults d'observation et de raisonnement, sur notre bon
sens, s'il savait que le plus grand de nos moralistes a dit : L'homme est un
roseau pensant ! Converse-t-il d'ailleurs avec son totem ? Le traite-t-il
comme un homme ? Or nous en revenons toujours l : pour savoir ce qui se
passe dans l'esprit d'un primitif, et mme d'un civilis, il faut considrer ce
qu'il fait, au moins autant que ce qu'il dit. Maintenant, si le primitif ne
s'identifie pas avec son totem, le prend-il simplement pour emblme ? Ce
serait aller trop loin en sens oppos : mme si le totmisme n'est pas la base
de l'organisation politique des non-civiliss, comme le veut Durkheim, il
occupe trop de place dans leur existence pour qu'on y voie un simple moyen
de dsigner le clan. La vrit doit tre quelque chose d'intermdiaire entre ces
deux solutions extrmes. Donnons, titre d'hypothse, l'interprtation
laquelle on pourrait tre conduit par nos principes. Qu'un clan soit dit tre tel
ou tel animal, il n'y a rien tirer de l; mais que deux clans compris dans une
mme tribu doivent ncessairement tre deux animaux diffrents, c'est
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
99
beaucoup plus instructif. Supposons, en effet, qu'on veuille marquer que ces
deux clans constituent deux espces, au sens biologique du mot : comment s'y
prendra-t-on, l o le langage ne s'est pas encore imprgn de science et de
philosophie ? Les traits individuels d'un animal ne frappant pas l'attention,
l'animal est peru, disions-nous, comme un genre. Pour exprimer que deux
clans constituent deux espces diffrentes, on donnera alors l'un des deux le
nom d'un animal, l'autre celui d'un autre. Chacun de ces noms, pris isolment, n'tait qu'une appellation : ensemble, ils quivalent une affirmation.
Ils disent en effet que les deux clans sont de sang diffrent. Pourquoi le
disent-ils ? Si le totmisme se retrouve, comme on l'assure, sur divers points
du globe, dans des socits qui n'ont pas pu communiquer entre elles, il doit
rpondre un besoin commun de ces socits, une exigence vitale. Par le
fait, nous savons que les clans entre lesquels se partage la tribu sont souvent
exogames : en d'autres termes, les unions se contractent entre membres de
clans diffrents, mais non pas l'intrieur de l'un d'eux. Longtemps mme on
a cru qu'il y avait l une loi gnrale, et que totmisme impliquait toujours
exogamie. Supposons qu'il en ait t ainsi au dpart, et que l'exogamie soit
tombe en route dans beaucoup de cas. On voit trs bien l'intrt qu'a la nature
empcher que les membres d'une tribu se marient rgulirement entre eux et
que, dans cette socit close, des unions finissent par se contracter entre proches parents : la race ne tarderait pas dgnrer. Un instinct, que des habitudes toutes diffrentes recouvrent ds qu'il a cess d'tre utile, portera donc la
tribu se scinder en clans l'intrieur desquels le mariage sera interdit. Cet
instinct arrivera d'ailleurs ses fins en faisant que les membres du clan se
sentent dj parents, et que, de clan clan, on se croie au contraire aussi
trangers que possible les uns aux autres, car son modus operandi, que nous
pouvons aussi bien observer chez nous, est de diminuer l'attrait sexuel entre
hommes et femmes qui vivent ensemble ou qui se savent apparents entre
eux 1. Comment alors les membres de deux clans diffrents se persuaderontils eux-mmes, comment exprimeront-ils qu'ils ne sont pas du mme sang ?
Ils s'habitueront dire qu'ils n'appartiennent pas la mme espce. Lors donc
qu'ils dclarent constituer deux espces animales, ce n'est pas sur l'animalit,
c'est sur la dualit qu'ils mettent l'accent. Du moins a-t-il d en tre ainsi
l'origine 2. Reconnaissons d'ailleurs que nous sommes ici dans le domaine du
simple probable, pour ne pas dire du pur possible. Nous avons seulement
voulu essayer un problme trs controvers la mthode qui nous parat
d'ordinaire la plus sre. Partant d'une ncessit biologique, nous cherchons
dans ltre vivant le besoin qui y correspond. Si ce besoin ne cre pas un
instinct rel et agissant, il suscite, par l'intermdiaire de ce qu'on pourrait
appeler un instinct virtuel ou latent, une reprsentation imaginative qui dtermine la conduite comme et fait l'instinct. A la base du totmisme serait une
reprsentation de ce genre.
Mais fermons cette parenthse, ouverte pour un objet dont on dira peuttre qu'il mritait mieux. C'est aux esprits que nous en tions rests. Nous
croyons que, pour pntrer jusqu' l'essence mme de la religion et pour
1
2
Voir, ce sujet, Westermarck, History of human marriage, London, 1901, pages 290 et
suivantes.
L'ide que le clan descend de l'animal-totem - ide sur laquelle M. Van Gennep insiste
dans son intressant ouvrage sur L'tat actuel du problme totmique (Paris, 1920) - a
trs bien pu se greffer sur la reprsentation que nous indiquons.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
100
comprendre l'histoire de l'humanit, il faudrait se transporter tout de suite, de
la religion statique et extrieure dont il a t question jusqu' prsent, cette
religion dynamique, intrieure, dont nous traiterons dans le prochain chapitre.
La premire tait destine carter des dangers que l'intelligence pouvait faire
courir l'homme ; elle tait infra-intellectuelle. Ajoutons qu'elle tait naturelle, car l'espce humaine marque une certaine tape de l'volution vitale : l
s'est arrt, un moment donn, le mouvement en avant; l'homme a t pos
alors globalement, avec l'intelligence par consquent, avec les dangers que
cette intelligence pouvait prsenter, avec la fonction fabulatrice qui devait y
parer; magie et animisme lmentaire, tout cela tait apparu en bloc, tout cela
rpondait exactement aux besoins de l'individu et de la socit, l'un et l'autre
borns dans leurs ambitions, qu'avait voulus la nature. Plus tard, et par un
effort qui aurait pu ne pas se produire, l'homme s'est arrach son tournoiement sur place ; il s'est insr de nouveau, en le prolongeant, dans le courant
volutif. Ce fut la religion dynamique, jointe sans doute une intellectualit
suprieure, mais distincte d'elle. La premire forme de la religion avait t
infra-intellectuelle ; nous en savons la raison. La seconde, pour des raisons
que nous indiquerons, fut supra-intellectuelle. C'est en les opposant tout de
suite l'une l'autre qu'on les comprendrait le mieux. Seules, en effet, sont
essentielles et pures ces deux religions extrmes. Les formes intermdiaires,
qui se dvelopprent dans les civilisations antiques, ne pourraient qu'induire
en erreur la philosophie de la religion si elles faisaient croire qu'on a pass
d'une extrmit l'autre par voie de perfectionnement graduel : erreur sans
doute naturelle, qui s'explique par le fait que la religion statique s'est survcu
en partie elle-mme dans la religion dynamique. Mais ces formes intermdiaires ont tenu une si grande place dans l'histoire connue de l'humanit qu'il
faut bien que nous nous appesantissions sur elles. Nous n'y voyons, pour notre
part, rien d'absolument nouveau, rien de comparable la religion dynamique,
rien que des variations sur le double thme de l'animisme lmentaire et de la
magie ; la croyance aux esprits est d'ailleurs toujours reste le fond de la
religion populaire. Mais de la facult fabulatrice, qui l'avait labore, est
sortie par un dveloppement ultrieur une mythologie autour de laquelle ont
pouss une littrature, un art, des institutions, enfin tout l'essentiel de la
civilisation antique. Parlons donc de la mythologie, sans jamais perdre de vue
ce qui en avait t le point de dpart, ce qu'on aperoit encore par transparence au travers d'elle.
Des esprits aux dieux la transition peut tre insensible, la diffrence n'en
est pas moins frappante. Le dieu est une personne. Il a ses qualits, ses
dfauts, son caractre. Il porte un nom. Il entretient des relations dfinies avec
d'autres dieux. Il exerce des fonctions importantes, et surtout il est seul les
exercer. Au contraire, il y a des milliers d'esprits diffrents, rpartis sur la
surface d'un pays, qui accomplissent une mme besogne ; ils sont dsigns par
un nom commun et ce nom pourra, dans certains cas, ne pas mme comporter
un singulier : mnes et pnates, pour ne prendre que cet exemple, sont des
mots latins qu'on ne trouve qu'au pluriel. Si la reprsentation religieuse vraiment originelle est celle d'une prsence efficace , d'un acte plutt que d'un
tre ou d'une chose, la croyance aux esprits se situe trs prs des origines; les
dieux ne paraissent que plus tard, quand la substantialit pure et simple
qu'avaient les esprits s'est hausse, chez tel ou tel d'entre eux, jusqu' la
personnalit. Ces dieux se surajoutent d'ailleurs aux esprits, mais ne les
remplacent pas, Le culte des esprits reste, comme nous le disions, le fond de
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
101
la religion populaire. La partie claire de la nation n'en prfrera pas moins
les dieux, et l'on peut dire que la marche au polythisme est un progrs vers la
civilisation.
Inutile de chercher cette marche un rythme ou une loi. C'est le caprice
mme. De la foule des esprits on verra surgir une divinit locale, d'abord
modeste, qui grandira avec la cit et sera finalement adopte par la nation
entire. Mais d'autres volutions sont aussi bien possibles. Il est rare,
d'ailleurs, que l'volution aboutisse un tat dfinitif. Si lev que soit le dieu,
sa divinit n'implique aucunement l'immutabilit. Bien au contraire, ce sont
les dieux principaux des religions antiques qui ont le plus change, s'enrichissant d'attributs nouveaux par l'absorption de dieux diffrents dont ils
grossissaient leur substance. Ainsi, chez les gyptiens, le dieu solaire R,
d'abord objet d'adoration suprme, attire lui d'autres divinits, se les assimile
ou s'accole elles, s'amalgame avec l'important dieu de Thbes Amon pour
former Amon-R. Ainsi Mardouk, le dieu de Babylone, s'approprie les
attributs de Bel, le grand dieu de Nippour. Ainsi dans la puissante desse Istar
viennent se fondre plusieurs dieux assyriens. Mais nulle volution n'est plus
riche que celle de Zeus, le dieu souverain de la Grce. Aprs avoir commenc
sans doute par tre celui qu'on adore au sommet des montagnes, qui dispose
des nuages, de la pluie et du tonnerre, il a joint sa fonction mtorologique,
si l'on peut s'exprimer ainsi, des attributions sociales qui prirent une complexit croissante ; il finit par tre le dieu qui prside tous les groupements,
depuis la famille jusqu' l'tat. Il fallait juxtaposer son nom les pithtes les
plus varices pour marquer toutes les directions de son activit : Xenios quand
il veillait l'accomplissement des devoirs d'hospitalit,Horkios quand il assistait aux serments, Hikesios quand il protgeait les suppliants, Genethlios
quand on l'invoquait pour un mariage, etc. L'volution est gnralement lente
et naturelle ; mais elle peut aussi bien tre rapide et s'accomplir artificiellement sous les yeux mmes des adorateurs du dieu. Les divinits de l'Olympe
datent des pomes homriques, qui ne les ont peut-tre pas cres, mais qui
leur ont donn la forme et les attributions que nous leur connaissons, qui les
ont coordonnes entre elles et groupes autour de Zeus, procdant cette fois
par simplification plutt que par complication. Elles n'en ont pas moins t
acceptes par les Grecs, qui savaient pourtant les circonstances et presque la
date de leur naissance. Mais point n'tait besoin du gnie des potes : un
dcret du prince pouvait suffire faire ou dfaire des dieux. Sans entrer dans
le dtail de ces interventions, rappelons seule. ment la plus radicale de toutes,
celle du pharaon qui prit le nom d'Iknaton : il supprima les dieux de l'gypte
au profit d'un seul d'entre eux et russit faire accepter jusqu' sa mort cette
espce de monothisme. On sait d'ailleurs que les pharaons participaient euxmmes de la divinit. Ds les temps les plus anciens ils s'intitulaient fils de
R . Et la tradition gyptienne de traiter le souverain comme un dieu se
continua sous les Ptolmes. Elle ne se limitait pas l'gypte. Nous la
rencontrons aussi bien en Syrie, sous les Sleucides, en Chine, et au Japon, o
l'empereur reoit les honneurs divins pendant sa vie et devient dieu aprs sa
mort, enfin Rome, o le Snat divinise Jules Csar en attendant qu'Auguste,
Claude, Vespasien, Titus, Nerva, finalement tous les empereurs passent au
rang des dieux. Sans doute l'adoration du souverain ne se pratique pas partout
avec le mme srieux. Il y a loin, par exemple, de la divinit d'un empereur
romain celle d'un pharaon. Celle-ci est proche parente de la divinit du chef
dans les socits primitives ; elle se lie peut-tre l'ide d'un fluide spcial ou
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
102
d'un pouvoir magique dont le souverain serait dtenteur, tandis que celle-l fut
confre Csar par simple flagornerie et utilise par Auguste comme un
instrumentum regni. Pourtant le demi-scepticisme qui se mlait l'adoration
des empereurs resta, Rome, l'apanage des esprits cultivs; il ne s'tendait pas
au peuple; il n'atteignait srement pas la province. C'est dire que les dieux de
l'antiquit pouvaient natre, mourir, se transformer au gr des hommes et des
circonstances, et que la foi du paganisme tait d'une complaisance sans
bornes.
Prcisment parce que le caprice des hommes et le hasard des circonstances ont eu tant de part leur gense, les dieux ne se prtent pas des
classifications rigoureuses. Tout au plus peut-on dmler quelques grandes
directions de la fantaisie mythologique ; encore s'en faut-il qu'aucune d'elles
ait t suivie rgulirement. Comme on se donnait le plus souvent des dieux
pour les utiliser, il est naturel qu'on leur ait gnralement attribu des fonctions, et que dans beaucoup de cas l'ide de fonction ait t Prdominante.
C'est ce qui se passa Rome. On a pu dire que la spcialisation des dieux tait
caractristique de la religion romaine. Pour les semailles elle avait Saturne,
pour la floraison des arbres fruitiers Flore, pour la maturation du fruit
Pomone. Elle assignait Janus la garde de la porte, Vesta celle du foyer.
Plutt que d'attribuer au mme dieu des fonctions multiples, apparentes entre
elles, elle aimait mieux poser des dieux distincts, quitte leur donner le mme
nom avec des qualificatifs diffrents. Il y avait la Venus Victrix, la Venus
Felix, la Venus Genetrix. Jupiter lui-mme tait Fulgur, Feretrius, Stator,
Victor, Optimus maximus; et c'taient des divinits jusqu' un certain point
indpendantes ; elles jalonnaient la route entre le Jupiter qui envoie la pluie ou
le beau temps et celui qui protge l'tat dans la paix comme dans la guerre.
Mais la mme tendance se retrouve partout, des degrs diffrents. Depuis
que l'homme cultive la terre, il a des dieux qui s'intressent la moisson, qui
dispensent la chaleur, qui assurent la rgularit des saisons. Ces fonctions
agricoles ont d caractriser quelques-uns des plus anciens dieux, encore
qu'on les ait perdues de vue lorsque l'volution du dieu eut fait de lui une
personnalit complexe, charge d'une longue histoire. C'est ainsi qu'Osiris, la
figure la plus riche du panthon gyptien, parat avoir t d'abord le dieu de la
vgtation. Telle tait la fonction primitivement dvolue l'Adonis des Grecs.
Telle aussi celle de Nisaba, en Babylonie, qui prsida aux crales avant de
devenir la desse de la Science. Au premier rang des divinits de l'Inde
figurent Indra et Agni. On doit Indra la pluie et l'orage, qui favorisent la
terre, Agni le feu et la protection du foyer domestique ; et ici encore la
diversit des fonctions s'accompagne d'une diffrence de caractre, Indra se
distinguant par sa force et Agni par sa sagesse. La fonction la plus leve est
d'ailleurs celle de Varouna, qui prside l'ordre universel. Nous retrouvons
dans la religion Shinto, au Japon, la desse de la Terre, celle des moissons,
celles qui veillent sur les montagnes, les arbres, etc. Mais nulle divinit de ce
genre n'a une personnalit plus accuse et plus complte que la Dmter des
Grecs, elle aussi desse du sol et des moissons, et s'occupant en outre des
morts, auxquels elle fournit une demeure, prsidant d'autre part, sous le nom
de Thesmophoros, la vie de famille et la vie sociale. Telle est la tendance
la plus marque de la fantaisie qui cre les dieux.
Mais, en leur assignant des fonctions, elle leur attribue une souverainet
qui prend tout naturellement la forme territoriale. Les dieux sont censs se
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
103
partager l'univers. D'aprs les potes vdiques, leurs diverses zones d'influence sont le ciel, la terre, et l'atmosphre intermdiaire. Dans la cosmologie
babylonienne, le ciel est le domaine d'Anu, et la terre celui de Bel ; dans les
profondeurs de la mer habite Ea. Les Grecs partagent le monde entre Zeus,
dieu du ciel et de la terre, Posidon, dieu des mers, et Hads, auquel appartient le royaume infernal. Ce sont l des domaines dlimits par la nature
mme. Or, non moins nets de contour sont les astres ; ils sont individualiss
par leur forme, comme aussi par leurs mouvements, qui semblent dpendre
d'eux ; il en est un qui dispense ici-bas la vie, et les autres, pour n'avoir pas la
mme puissance, n'en doivent pas moins tre de mme nature ; ils ont donc,
eux aussi, ce qu'il faut pour tre des dieux. C'est en Assyrie que la croyance
la divinit des astres prit sa forme la plus systmatique. Mais l'adoration du
soleil, et celle aussi du ciel, se retrouvent peu prs partout : dans la religion
Shinto du Japon, o la desse du Soleil est rige en souveraine avec, audessous d'elle, un dieu de la lune et un dieu des toiles ; dans la religion
gyptienne primitive, o la lune et le ciel sont envisags comme des dieux
ct du soleil qui les domine; dans la religion vdique o Mitra (identique
l'iranien Mithra qui est une divinit solaire) prsente des attributs qui
conviendraient un dieu du soleil ou de la lumire; dans l'ancienne religion
chinoise, o le soleil est un dieu personnel; enfin chez les Grecs eux-mmes,
dont un des plus anciens dieux est Helios. Chez les peuples indo-germaniques
en gnral, le ciel a t l'objet d'un culte particulier. Sous les noms de Dyaus,
Zeus, Jupiter, Ziu, il est commun aux Indiens vdiques, aux Grecs, aux
Romains et aux Teutons, quoique ce soit en Grce et Rome seulement qu'il
soit le roi des dieux, comme la divinit cleste des Mongols l'est en Chine. Ici
surtout se constate la tendance des trs anciens dieux, primitivement chargs
de besognes toutes matrielles, s'enrichir d'attributs moraux quand ils
avancent en ge. Dans la Babylonie du Sud, le soleil qui voit tout est devenu
le gardien du droit et de la justice ; il reoit le titre de juge . Le Mitra
indien est le champion de la vrit et du droit ; il donne la victoire la bonne
cause. Et l'Osiris gyptien, qui s'est confondu avec le dieu solaire aprs avoir
t celui de la vgtation, a fini par tre le grand juge quitable et misricordieux qui rgne sur le pays des morts.
Tous ces dieux sont attachs des choses. Mais il en est -souvent ce sont
les mmes, envisags d'un autre point de vue -qui se dfinissent par leurs
relations avec des personnes ou des groupes. Peut-on considrer comme un
dieu le gnie ou le dmon propre a un individu ? Le genius romain tait
numen et non pas deus ; il n'avait pas de figure ni de nom ; il tait tout prs de
se rduire cette prsence efficace que nous avons vue tre ce qu'il y a de
primitif et d'essentiel dans la divinit. Le lar familiaris, qui veillait sur la
famille, n'avait gure plus de personnalit. Mais plus le groupement est
important, plus il a droit un dieu vritable. En gypte, par exemple, chacune
des cits primitives, avait son divin protecteur. Ces dieux se distinguaient
prcisment les uns des autres par leur relation telle ou telle communaut :
en disant Celui d'Edfu , Celui de Nekkeb , on les dsignait suffisamment. Mais le plus souvent il s'agissait de divinits qui prexistaient au
groupe, et que celui-ci avait adoptes. Il en fut ainsi, en gypte mme, pour
Amon-R, le dieu de Thbes. Il en fut ainsi en Babylonie, o la ville d'Ur
avait pour desse la Lune, celle d'Uruk la plante Vnus. De mme en Grce,
o Dmter se sentait spcialement chez elle leusis, Athn sur l'Acropole,
Artmis en Arcadie. Souvent aussi protecteurs et protgs avaient partie lie ;
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
104
les dieux de la cit bnficiaient de son agrandissement. La guerre devenait
une lutte entre divinits rivales. Celles-ci pouvaient d'ailleurs se rconcilier,
les dieux du peuple subjugu entrant alors dans le panthon du vainqueur.
Mais la vrit est que la cit ou l'empire, d'une part, ses dieux tutlaires de
l'autre, formaient un consortium vague dont le caractre a d varier indfiniment.
Toutefois c'est pour notre commodit que nous dfinissons et classons
ainsi les dieux de la fable. Aucune loi n'a prsid leur naissance, non plus
qu' leur dveloppement ; l'humanit a laiss ici libre jeu son instinct de
fabulation. Cet instinct ne va pas trs loin, sans doute, quand on le laisse luimme, mais il progresse indfiniment si l'on se plat l'exercer. Grande est la
diffrence, cet gard, entre les mythologies des diffrents peuples. L'antiquit classique nous offre un exemple de cette opposition : la mythologie
romaine est pauvre, celle des Grecs est surabondante. Les dieux de l'ancienne
Rome concident avec la fonction dont ils sont investis et s'y trouvent, en
quelque sorte, immobiliss. C'est peine s'ils ont un corps, je veux dire une
figure imaginable. C'est peine s'ils sont des dieux. Au contraire, chaque dieu
de la Grce antique a sa physionomie, son caractre, son histoire. Il va et
vient, il agit en dehors de l'exercice de ses fonctions. On raconte ses
aventures, on dcrit son intervention dans nos affaires. Il se prte toutes les
fantaisies de l'artiste et du pote. Ce serait, plus prcisment, un personnage
de roman, s'il n'avait une puissance suprieure celle des hommes et le
privilge de rompre, dans certains cas au moins, la rgularit des lois de la
nature. Bref, la fonction fabulatrice de l'esprit s'est arrte dans le premier
cas ; elle a poursuivi son travail dans le second. Mais c'est toujours la mme
fonction. Elle reprendra au besoin le travail interrompu. Tel fut l'effet de
l'introduction de la littrature et plus gnralement des ides grecques
Rome. On sait comment les Romains identifirent certains de leurs dieux avec
ceux de l'Hellade, leur confrant ainsi une personnalit plus accuse et les
faisant passer du repos au mouvement.
De cette fonction fabulatrice nous avons dit qu'on la dfinirait mal en
faisant d'elle une varit de l'imagination. Ce dernier mot a un sens plutt
ngatif. On appelle imaginatives les reprsentations concrtes qui ne sont ni
des perceptions ni des souvenirs. Comme ces reprsentations ne dessinent pas
un objet prsent ni une chose passe, elles sont toutes envisages de la mme
manire par le sens commun et dsignes par un seul mot dans le langage
courant. Mais le psychologue ne devra pas les grouper pour cela dans la
mme catgorie ni les rattacher la mme fonction. Laissons donc de ct
l'imagination, qui n'est qu'un mot, et considrons une facult bien dfinie de
l'esprit, celle de crer des personnages dont nous nous racontons nousmmes l'histoire. Elle prend une singulire intensit de vie chez les romanciers et les dramaturges. Il en est parmi eux qui sont vritablement obsds
par leur hros ; ils sont mens par lui plutt qu'ils ne le mnent ; ils ont mme
de la peine se dbarrasser de lui quand ils ont achev leur pice ou leur
roman. Ce ne sont pas ncessairement ceux dont luvre a la plus haute
valeur; mais, mieux que d'autres, ils nous font toucher du doigt l'existence,
chez certains au moins d'entre nous, d'une facult spciale d'hallucination
volontaire. A vrai dire, on la trouve quelque degr chez tout le monde. Elle
est trs vivante chez les enfants. Tel d'entre eux entretiendra un commerce
quotidien avec un personnage imaginaire dont il vous indiquera le nom, dont
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
105
il vous rapportera les impressions sur chacun des incidents de la journe. Mais
la mme facult entre en jeu chez ceux qui, sans crer eux-mmes des tres
fictifs, s'intressent des fictions comme ils le feraient des ra. lits. Quoi
de plus tonnant que de voir des spectateurs pleurer au thtre ? On dira que
la pice est joue par des acteurs, qu'il y a sur la scne des hommes en chair et
en os. Soit, mais nous pouvons tre presque aussi fortement empoigns
par le roman que nous lisons, et sympathiser au mme point avec les personnages dont on nous raconte l'histoire. Comment les psychologues n'ont-ils pas
t frapps de ce qu'une telle facult a de mystrieux ? On rpondra que toutes
nos facults sont mystrieuses, en ce sens que nous ne connaissons le mcanisme intrieur d'aucune d'elles. Sans doute ; mais s'il ne peut tre question ici
d'une reconstruction mcanique, nous sommes en droit de demander une
explication psychologique. Et l'explication est en psychologie ce qu'elle est en
biologie ; on a rendu compte de l'existence d'une fonction quand on a montr
comment et pourquoi elle est ncessaire la vie. Or, il n'est certainement pas
ncessaire qu'il y ait des romanciers et des dramaturges ; la facult de
fabulation en gnral ne rpond pas une exigence vitale. Mais supposons
que sur un point particulier, employe un certain objet, cette fonction soit
indispensable l'existence des individus comme celle des socits : nous
concevrons sans peine que, destine ce travail, pour lequel elle est ncessaire, on l'utilise ensuite, puisqu'elle reste prsente, pour de simples jeux. Par
le fait, nous passons sans peine du roman d'aujourd'hui des contes plus ou
moins anciens, aux lgendes, au folklore, et du folklore la mythologie, qui
n'est pas la mme chose, mais qui s'est constitue de la mme manire ; la
mythologie, son tour, ne fait que dvelopper en histoire la personnalit des
dieux, et cette dernire cration n'est que l'extension d'une autre, plus simple,
celle des puissances semi-personnelles ou prsences efficaces qui sont,
croyons-nous, l'origine de la religion. Ici nous touchons ce que nous avons
montr tre une exigence fondamentale de la vie : cette exigence a fait surgir
la facult de fabulation ; la fonction fabulatrice se dduit ainsi des conditions
d'existence de l'espce humaine. Sans revenir sur ce que nous avons dj
longuement expos, rappelons que, dans le domaine vital, ce qui apparat
l'analyse comme une complication infinie est donn l'intuition comme un
acte simple. L'acte pouvait ne pas s'accomplir ; mais, s'il s'est accompli, c'est
qu'il a travers d'un seul coup tous les obstacles. Ces obstacles, dont chacun
en faisait surgir un autre, constituent une multiplicit indfinie, et c'est
prcisment l'limination successive de tous ces obstacles qui se prsente
notre analyse. Vouloir expliquer chacune de ces liminations par la prcdente serait faire fausse route ; toutes s'expliquent par une opration unique,
qui est l'acte lui-mme dans sa simplicit. Ainsi le mouvement indivis de la
flche triomphe en une seule fois des mille et mille obstacles que notre
perception, aide du raisonnement de Znon, croit saisir dans les immobilits
des points successifs de la ligne parcourue. Ainsi l'acte indivis de vision, par
cela seul qu'il russit, tourne tout d'un coup des milliers de milliers
d'obstacles ; ces obstacles tourns sont ce qui apparat notre perception et
notre science dans la multiplicit des cellules constitutives de l'il, dans la
complication de l'appareil visuel, enfin dans les mcanismes lmentaires de
l'opration. De mme, posez l'espce humaine, c'est--dire le saut brusque par
lequel la vie qui voluait est parvenue l'homme individuel et social : du
mme coup vous vous donnez l'intelligence fabricatrice et par suite un effort
qui se poursuivra, en vertu de son lan, au del de la simple fabrication pour
laquelle il tait fait, crant ainsi un danger. Si l'espce humaine existe, c'est
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
106
que le mme acte par lequel tait pos l'homme avec l'intelligence fabricatrice, avec l'effort continu de l'intelligence, avec le danger cr par la
continuation de l'effort, suscitait la fonction fabulatrice. Celle-ci n'a donc pas
t voulue par la nature ; et pourtant elle s'explique naturellement. Si, en effet,
nous la joignons toutes les autres fonctions psychologiques, nous trouvons
que l'ensemble exprime sous forme de multiplicit l'acte indivisible par lequel
la vie a saut de l'chelon o elle s'tait arrte jusqu' l'homme.
Mais voyons de plus prs pourquoi cette facult fabulatrice impose ses
inventions avec une force exceptionnelle quand elle s'exerce dans le domaine
religieux. Elle est l chez elle, sans aucun doute ; elle est faite pour fabriquer
des esprits et des dieux ; mais comme elle continue ailleurs son travail de
fabulation, il y a lieu de se demander pourquoi, oprant encore de mme, elle
n'obtient plus alors la mme crance. On trouverait cela deux raisons.
La premire est qu'en matire religieuse l'adhsion de chacun se renforce
de l'adhsion de tous. Dj, au thtre, la docilit du spectateur aux suggestions du dramaturge est singulirement accrue par l'attention et l'intrt de la
socit prsente. Mais il s'agit d'une socit juste aussi grande que la salle, et
qui dure juste autant que la pice : que sera-ce, si la croyance individuelle est
soutenue, confirme par tout un peuple, et si elle prend son point d'appui dans
le pass comme dans le prsent ? Que sera-ce, si le dieu est chant par les
potes, log dans des temples, figur par l'art ? Tant que la science exprimentale ne se sera pas solidement constitue, il n'y aura pas de plus sr
garant de la vrit que le consentement universel. La vrit sera le plus souvent ce consentement mme. Soit dit en passant, c'est l une des raisons d'tre
de l'intolrance. Celui qui n'accepte pas la croyance commune l'empche,
pendant qu'il nie, d'tre totalement vraie. La vrit ne recouvrera son intgrit
que s'il se rtracte ou disparat.
Nous ne voulons pas dire que la croyance religieuse n'ait pas pu tre,
mme dans le polythisme, une croyance individuelle. Chaque Romain avait
un genius attach sa personne ; mais il ne croyait si fermement son gnie
que parce que chacun des autres Romains avait le sien et parce que sa foi,
personnelle sur ce point, lui tait garantie par une foi universelle. Nous ne
voulons pas dire non plus que la religion ait jamais t d'essence sociale plutt
qu'individuelle : nous avons bien vu que la fonction fabulatrice, inne l'individu, a pour premier objet de consolider la socit ; mais nous savons qu'elle
est galement destine soutenir l'individu lui-mme, et que d'ailleurs l'intrt
de la socit est l. A vrai dire, individu et socit s'impliquent rciproquement : les individus constituent la socit par leur assemblage ; la socit
dtermine tout un ct des individus par sa prfiguration dans chacun d'eux.
Individu et socit se conditionnent donc, circulairement. Le cercle, voulu par
la nature, a t rompu par l'homme le jour o il a pu se replacer dans l'lan
crateur, poussant la nature humaine en avant au lieu de la laisser pivoter sur
place. C'est de ce jour que date une religion essentiellement individuelle,
devenue par l, il est vrai, plus profondment sociale, Mais nous reviendrons
sur ce point. Disons seulement que la garantie apporte par la socit la
croyance individuelle, en matire religieuse, suffirait dj mettre hors de
pair ces inventions de la facult fabulatrice.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
107
Mais il faut tenir compte d'autre chose encore. Nous avons vu comment
les anciens assistaient, impassibles, la gense de tel ou tel dieu. Dsormais,
ils croiraient en lui comme en tous les autres. Ce serait inadmissible, si l'on
supposait que l'existence de leurs dieux tait de mme nature pour eux que
celle des objets qu'ils voyaient et touchaient. Elle tait relle, mais d'une
ralit qui n'tait pas sans dpendre de la volont humaine.
Les dieux de la civilisation paenne se distinguent en effet des entits plus
anciennes, elfes, gnomes, esprits, dont ne se dtacha jamais la foi populaire.
Celles~ci taient issues presque immdiatement de la facult fabulatrice, qui
nous est naturelle ; et elles taient adoptes comme elles avaient t produites,
naturellement. Elles dessinaient le contour exact du besoin d'o elles taient
sorties. Mais la mythologie, qui est une extension du travail primitif, dpasse
de tous cts ce besoin ; l'intervalle qu'elle laisse entre lui et elle est rempli
par une matire dans le choix de laquelle le caprice humain a une large part, et
l'adhsion qu'on lui donne s'en ressent. C'est toujours la mme facult qui
intervient, et elle obtient, pour l'ensemble de ses inventions, la mme crance.
Mais chaque invention, prise part, est accepte avec l'arrire-pense qu'une
autre et t possible. Le panthon existe indpendamment de l'homme, mais
il dpend de l'homme d'y faire entrer un dieu, et de lui confrer ainsi l'existence. Nous nous tonnons aujourd'hui de cet tat d'me. Nous l'exprimentons pourtant en nous dans certains rves, o nous pouvons introduire un
moment donn l'incident que nous souhaitons : il se ralise par nous dans un
ensemble qui s'est pos lui-mme, sans nous. On pour. rait dire, de mme, que
chaque dieu dtermin est contingent, alors que la totalit des dieux, ou plutt
le dieu en gnral, est ncessaire. En creusant ce point, en poussant aussi la
logique plus loin que ne l'ont fait les anciens, on trouverait qu'il n'y a jamais
eu de pluralisme dfinitif que dans la croyance aux esprits, et que le polythisme proprement dit, avec sa mythologie, implique un mono. thisme
latent, o les divinits multiples n'existent que secondairement, comme
reprsentatives du divin.
Mais les anciens auraient tenu ces considrations pour accessoires. Elles
n'auraient d'importance que si la religion tait du domaine de la connaissance
ou de la contemplation. On pourrait alors traiter un rcit mythologique comme
un rcit historique, et se poser dans un cas comme dans l'autre la question
d'authenticit. Mais la vrit est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre
eux, parce qu'ils ne sont pas du mme ordre. L'histoire est connaissance, la
religion est principalement action : elle ne concerne la connaissance, comme
nous l'avons maintes fois rpt, que dans la mesure o une reprsentation
intellectuelle est ncessaire pour parer au danger d'une certaine intellectualit.
Considrer part cette reprsentation, la critiquer en tant que reprsentation,
serait oublier qu'elle forme un amalgame avec l'action concomitante. C'est une
erreur de ce genre que nous commettons quand nous nous demandons comment de grands esprits ont pu accepter le tissu de purilits et mme d'absurdits qu'tait leur religion. Les gestes du nageur paratraient aussi ineptes et
ridicules celui qui oublierait qu'il y a de l'eau, que cette eau soutient le
nageur, et que les mouvements de l'homme, la rsistance du liquide, le courant du fleuve, doivent tre pris ensemble comme un tout indivis.
La religion renforce et discipline. Pour cela des exercices continuellement
rpts sont ncessaires, comme ceux dont l'automatisme finit par fixer dans
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
108
le corps du soldat l'assurance morale dont il aura besoin au jour du danger.
C'est dire qu'il n'y a pas de religion sans rites et crmonies. A ces actes
religieux la reprsentation religieuse sert surtout d'occasion. Ils manent sans
doute de la croyance, mais ils ragissent aussitt sur elle et la consolident : s'il
y a des dieux, il faut leur vouer un culte ; mais du moment qu'il y a un culte,
c'est qu'il existe des dieux. Cette solidarit du dieu et de l'hommage qu'on lui
rend fait de la vrit religieuse une chose part, sans commune mesure avec
la vrit spculative, et qui dpend jusqu' un certain point de l'homme.
A resserrer cette solidarit tendent prcisment les rites et crmonies. Il y
aurait lieu de s'tendre longuement sur eux. Disons seulement un mot des
deux principaux : le sacrifice et la prire.
Dans la religion que nous appellerons dynamique, la prire est indiffrente
son expression verbale ; c'est une lvation de l'me, qui pourrait se passer
de la parole. A son plus bas degr, d'autre part, elle n'tait pas sans rapport
avec l'incantation magique ; elle visait alors, sinon forcer la volont des
dieux et surtout des esprits, du moins capter leur faveur. C'est mi-chemin
entre ces deux extrmits que se situe ordinairement la prire, telle qu'on
l'entend dans le polythisme. Sans doute l'antiquit a connu des formes de
prire admirables, o se traduisait une aspiration de l'me devenir meilleure.
Mais ce furent l des exceptions, et comme des anticipations d'une croyance
religieuse plus pure. Il est plus habituel au polythisme d'imposer la prire
une forme strotype, avec l'arrire-pense que ce n'est pas seulement la
signification de la phrase, mais aussi bien la conscution des mots avec
l'ensemble des gestes concomitants qui lui donnera son efficacit. On peut
mme dire que, plus le polythisme volue, plus il devient exigeant sur ce
point ; l'intervention d'un prtre est de plus en plus ncessaire pour assurer le
dressage du fidle. Comment ne pas voir que cette habitude de prolonger
l'ide du dieu, une fois voque, en paroles prescrites et en attitudes prdtermines confre son image une objectivit suprieure ? Nous avons
montr jadis que ce qui fait la ralit d'une perception, ce qui la distingue d'un
souvenir ou d'une imagination, c'est, avant tout, l'ensemble des mouvements
naissants qu'elle imprime au corps et qui la compltent par une action
automatiquement commence. Des mouvements de ce genre pourront se
dessiner pour une autre cause : leur actualit refluera aussi bien vers la reprsentation qui les aura occasionns, et la convertira pratiquement en chose.
Quant au sacrifice, c'est sans doute, d'abord, une offrande destine acheter la faveur du dieu ou dtourner sa colre. Il doit tre d'autant mieux
accueilli qu'il a plus cot, et que la victime a une plus grande valeur. C'est
probablement ainsi que s'explique en partie l'habitude d'immoler des victimes
humaines, habitude qu'on trouverait dans la plupart des religions antiques,
peut-tre dans toutes si l'on remontait assez haut. Il n'est pas d'erreur ni
d'horreur o ne puisse conduire la logique, quand elle s'applique des matires qui ne relvent pas de la pure intelligence. Mais il y a autre chose encore
dans le sacrifice : sinon, l'on ne s'expliquerait pas que l'offrande ait ncessairement t animale ou vgtale, presque toujours animale. D'abord, on
s'accorde gnralement voir les origines du sacrifice dans un repas que le
dieu et ses adorateurs taient censs prendre en commun. Ensuite et surtout, le
sang avait une vertu spciale. Principe de vie, il apportait de la force au dieu
pour le mettre mme de mieux aider l'homme et peut-tre aussi (mais c'tait
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
109
une arrire-pense peine consciente) pour lui assurer plus solidement
l'existence. C'tait, comme la prire, un lien entre l'homme et la divinit.
Ainsi le polythisme avec sa mythologie a eu pour double effet d'lever de
plus en plus haut les puissances invisibles qui entourent l'homme, et de mettre
l'homme en relations de plus en plus troites avec elles. Coextensif aux
anciennes civilisations, il s'est grossi de tout ce qu'elles produisaient, ayant
inspir la littrature et l'art, et reu d'eux plus encore qu'il ne leur avait donn.
C'est dire que le sentiment religieux, dans l'antiquit, a t fait d'lments trs
nombreux, variables de peuple peuple, mais qui taient tous venus s'agglomrer autour d'un noyau primitif. A ce noyau central nous nous sommes
attach, parce que nous avons voulu dgager des religions antiques ce qu'elles
avaient de spcifiquement religieux. Telle d'entre elles, celle de l'Inde ou de la
Perse, s'est double d'une philosophie. Mais philosophie et religion restent
toujours distinctes. Le plus souvent, en effet, la philosophie ne survient que
pour donner satisfaction des esprits plus Cultivs ; la religion subsiste, dans
le peuple, telle que nous l'avons dcrite. L mme o le mlange se fait, les
lments conservent leur individualit : la religion aura des vellits de spculer, la philosophie ne se dsintressera pas d'agir ; mais la premire n'en
restera pas moins essentiellement action, et la seconde, par-dessus tout,
pense. Quand la religion est rellement devenue philosophie chez les
anciens, elle a plutt dconseill d'agir et renonc ce qu'elle tait venue faire
dans le monde. tait-ce encore de la religion ? Nous pouvons donner aux
mots le sens que nous voulons, pourvu que nous commencions par le dfinir;
mais nous aurions tort de le faire quand par hasard nous nous trouvons devant
un mot qui dsigne une dcoupure naturelle des choses - ici nous devrons tout
au plus exclure de l'extension du terme tel ou tel objet qu'on y aurait accidentellement compris. C'est ce qui arrive pour la religion. Nous avons montr
comment on donne ordinairement ce nom des reprsentations orientes vers
l'action et suscites par la nature dans un intrt dtermin ; on a pu exceptionnellement, et pour des raisons qu'il est facile d'apercevoir, tendre l'application du mot des reprsentations qui ont un autre objet ; la religion n'en
devra pas moins tre dfinie conformment ce que nous avons appel
l'intention de la nature.
Nous avons maintes fois expliqu ce qu'il faut entendre ici par intention.
Et nous nous sommes longuement appesanti, dans le prsent chapitre, sur la
fonction que la nature avait assigne la religion. Magie, culte des esprits ou
des animaux, adoration des dieux, mythologie, superstitions de tout genre
paratront trs complexes si on les prend un un. Mais l'ensemble en est fort
simple.
L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assure, qui hsite et
ttonne, qui forme des projets avec l'espoir de russir et la crainte d'chouer.
C'est le seul qui se sente sujet la maladie, et le seul aussi qui sache qu'il doit
mourir. Le reste de la nature s'panouit dans une tranquillit parfaite. Plantes
et animaux ont beau tre livrs tous les hasards ; ils ne s'en reposent pas
moins sur l'instant qui passe comme ils le feraient sur l'ternit. De cette
inaltrable confiance nous aspirons nous quelque chose dans une promenade
la campagne, d'o nous revenons apaiss. Mais ce n'est pas assez dire. De
tous les tres vivant en socit, l'homme est le seul qui puisse dvier de la
ligne sociale, en cdant des proccupations gostes quand le bien commun
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
110
est en cause ; partout ailleurs, l'intrt individuel est invitablement coordonn ou subordonn l'intrt gnral. Cette double imperfection est la ranon
de l'intelligence. L'homme ne peut pas exercer sa facult de penser sans se
reprsenter un avenir incertain, qui veille sa crainte et son esprance. Il ne
peut pas rflchir ce que la nature lui demande, en tant qu'elle a fait de lui
un tre sociable, sans se dire qu'il trouverait souvent son avantage ngliger
les autres, ne se soucier que de lui-mme. Dans les deux cas il y aurait rupture de l'ordre normal, naturel. Et pourtant c'est la nature qui a voulu
l'intelligence, qui l'a mise au bout de l'une des deux grandes lignes de l'volution animale pour faire pendant l'instinct le plus parfait, point terminus de
l'autre. Il est impossible qu'elle n'ait pas pris ses prcautions pour que l'ordre,
peine drang par l'intelligence, tende se rtablir automatiquement. Par le
fait, la fonction fabulatrice, qui appartient l'intelligence et qui n'est pourtant
pas intelligence pure, a prcisment cet objet. Son rle est d'laborer la
religion dont nous avons trait jusqu' prsent, celle que nous appelons
statique et dont nous dirions que c'est la religion naturelle, si l'expression
n'avait pris un autre sens. Nous n'avons donc qu' nous rsumer pour dfinir
cette religion en termes prcis. C'est une raction dfensive de la nature
contre ce qu'il pourrait y avoir de dprimant pour l'individu, et de dissolvant
pour la socit, dans l'exercice de l'intelligence.
Terminons par deux remarques, pour prvenir deux malentendus. Quand
nous disons qu'une des fonctions de la religion, telle qu'elle a t voulue par la
nature, est de maintenir la vie sociale, nous n'entendons pas par l qu'il y ait
solidarit entre cette religion et la morale. L'histoire tmoigne du contraire.
Pcher a toujours t offenser la divinit ; mais il s'en faut que la divinit ait
toujours pris offense de l'immoralit ou mme du crime : il lui est arriv de les
prescrire. Certes, l'humanit semble avoir souhait en gnral que ses dieux
fussent bons ; souvent elle a mis les vertus sous leur invocation ; peut-tre
mme la concidence que nous signalions entre la morale et la religion originelles, l'une et l'autre rudimentaires, a-t-elle laiss au fond de l'me humaine
le vague idal d'une morale prcise et d'une religion organise qui s'appuieraient l'une sur l'autre. Il n'en est pas moins vrai que la morale s'est prcise
part, que les religions ont volu part, et que les hommes ont toujours reu
leurs dieux de la tradition sans leur demander d'exhiber un certificat de
moralit ni de garantir l'ordre moral. Mais c'est qu'il faut distinguer entre les
obligations sociales d'un caractre trs gnral, sans lesquelles aucune vie en
commun n'est possible, et le lien social particulier, concret, qui fait que les
membres d'une certaine communaut sont attachs sa conservation. Les
premires se sont dgages peu peu du fond confus de coutumes que nous
avons montr l'origine ; elles s'en sont dgages par voie de purification et
de simplification, d'abstraction et de gnralisation, pour donner une morale
sociale. Mais ce qui lie les uns aux autres les membres d'une socit dtermine, c'est la tradition, le besoin, la volont de dfendre ce groupe contre
d'autres groupes, et de le mettre au-dessus de tout. A conserver, resserrer ce
lien vise incontestablement la religion que nous avons trouve naturelle : elle
est commune aux membres d'un groupe, elle les associe intimement dans des
rites et des crmonies, elle distingue le groupe des autres groupes, elle
garantit le succs de l'entreprise commune et assure contre le danger commun.
Que la religion, telle qu'elle sort des mains de la nature, ait accompli la fois pour employer notre langage actuel - les deux fonctions morale et nationale,
cela ne nous parat pas douteux : ces deux fonctions taient ncessairement
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
111
confondues, en effet, dans des socits rudimentaires o il n'y avait que des
coutumes. Mais que les socits, en se dveloppant, aient entran la religion
dans la seconde direction, c'est ce que l'on comprendra sans peine si l'on se
reporte ce que nous venons d'exposer. On s'en ft convaincu tout de suite, en
considrant que les socits humaines, l'extrmit d'une des grandes lignes
de l'volution biologique, font pendant aux socits animales les plus parfaites, situes l'extrmit de l'autre grande ligne, et que la fonction fabulatrice, sans tre un instinct, joue dans les socits humaines un rle symtrique
de celui de l'instinct dans ces socits animales.
Notre seconde remarque, dont nous pourrions nous dispenser aprs ce que
nous avons tant de fois rpt, concerne le sens que nous donnons
l' intention de la nature , une expression dont nous avons use en parlant de
la religion naturelle . A vrai dire, il s'agissait moins de cette religion ellemme que de l'effet obtenu par elle. Il y a un lan de vie qui traverse la
matire et qui en tire ce qu'il peut, quitte se scinder en route. A l'extrmit
des deux principales lignes d'volution ainsi traces se trouvent l'intelligence
et l'instinct. Justement parce que l'intelligence est une russite, comme
d'ailleurs l'instinct, elle ne peut pas tre pose sans que l'accompagne une tendance carter ce qui l'empcherait de produire son plein effet. Cette
tendance forme avec elle, comme avec tout ce que l'intelligence prsuppose,
un bloc indivis, qui se divise au regard de notre facult - toute relative
notre intelligence elle. mme - de percevoir et d'analyser. Revenons encore
une fois sur ce qui a t dit de l'il et de la vision. Il y a l'acte de voir, qui est
simple, et il y a une infinit d'lments, et d'actions rciproques de ces
lments les uns sur les autres, avec lesquels l'anatomiste et le physiologiste
reconstituent l'acte simple. lments et actions expriment analytiquement et
pour ainsi dire ngativement, tant des rsistances opposes des rsistances,
l'acte indivisible, seul positif, que la nature a effectivement obtenu. Ainsi les
inquitudes de l'homme jet sur la terre, et les tentations que l'individu peut
avoir de se prfrer lui-mme la communaut, - inquitudes et tentations qui
sont le propre d'un tre intelligent, - se prteraient une numration sans fin.
Indfinies en nombre, aussi, sont les formes de la superstition, ou plutt de la
religion statique, qui rsistent ces rsistances. Mais cette complication
s'vanouit si l'on replace l'homme dans l'ensemble de la nature, si l'on considre que l'intelligence serait un obstacle la srnit qu'on trouve partout
ailleurs, et que l'obstacle doit tre surmont, l'quilibre rtabli. Envisag de ce
point de vue, qui est celui de la gense et non plus de l'analyse, tout ce que
l'intelligence applique la vie comportait d'agitation et de dfaillance, avec
tout ce que les religions y apportrent d'apaisement, devient une chose simple.
Perturbation et fabulation se compensent et s'annulent. A un dieu, qui regarderait d'en haut, le tout paratrait indivisible, comme la confiance des fleurs
qui s'ouvrent au printemps.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
112
Chapitre III
La religion dynamique
Retour la table des matires
Jetons un coup d'il en arrire sur la vie, dont nous avions jadis suivi le
dveloppement jusqu'au point o la religion devait sortir d'elle. Un grand
courant d'nergie cratrice se lance dans la matire pour en obtenir ce qu'il
peut. Sur la plupart des points il est arrt ; ces arrts se traduisent nos yeux
par autant d'apparitions d'espces vivantes, c'est--dire d'organismes o notre
regard, essentiellement analytique et synthtique, dmle une multitude d'lments se coordonnant pour accomplir une multitude de fonctions ; le travail
d'organisation n'tait pourtant que l'arrt lui-mme, acte simple, analogue
l'enfoncement du pied qui dtermine instantanment des milliers de grains de
sable s'entendre pour donner un dessin. Sur une des lignes o elle avait
russi aller le plus loin, on aurait pu croire que cette nergie vitale entranerait ce qu'elle avait de meilleur et continuerait droit devant elle ; mais elle
s'inflchit, et tout se recourba : des tres surgirent dont l'activit tournait
indfiniment dans le mme cercle, dont les organes taient des instruments
tout faits au lieu de laisser la place ouverte une invention sans cesse
renouvelable d'outils, dont la conscience glissait dans le somnambulisme de
l'instinct au lieu de se redresser et de s'intensifier en pense rflchie. Tel est
l'tat de l'individu dans ces socits d'insectes dont l'organisation est savante,
mais l'automatisme complet. L'effort crateur ne passa avec succs que sur la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
113
ligne d'volution qui aboutit l'homme. En traversant la matire, la conscience prit cette fois, comme dans un moule, la forme de l'intelligence
fabricatrice. Et l'invention, qui porte en elle la rflexion, s'panouit en libert.
Mais l'intelligence n'tait pas sans danger. Jusque-l, tous les vivants
avaient bu avidement la coupe de la vie. Ils savouraient le miel que la nature
avait mis sur le bord ; ils avalaient le reste par surcrot, sans l'avoir vu. L'intelligence, elle, regardait jusqu'en bas. Car l'tre intelligent ne vivait plus
seulement dans le prsent ; il n'y a pas de rflexion sans prvision, pas de
prvision sans inquitude, pas d'inquitude sans un relchement momentan
de l'attachement la vie. Surtout, il n'y a pas d'humanit sans socit, et la
socit demande l'individu un dsintressement que l'insecte, dans son
automatisme, pousse jusqu' l'oubli complet de soi. Il ne faut pas compter sur
la rflexion pour soutenir ce dsintressement. L'intelligence, moins d'tre
celle d'un subtil philosophe utilitaire, conseillerait plutt l'gosme. Par deux
cts, donc, elle appelait un contrepoids. Ou plutt elle en tait dj munie,
car la nature, encore une fois, ne fait pas les tres de pices et de morceaux :
ce qui est multiple dans sa manifestation peut tre simple dans sa gense. Une
espce qui surgit apporte avec elle, dans l'indivisibilit de l'acte qui la pose,
tout le dtail de ce qui la rend viable. L'arrt mme de l'lan crateur qui s'est
traduit par l'apparition de notre espce a donn avec l'intelligence humaine,
l'intrieur de l'intelligence humaine, la fonction fabulatrice qui labore les
religions. Tel est donc le rle, telle est la signification de la religion que nous
avons appele statique ou naturelle. La religion est ce qui doit combler, chez
des tres dous de rflexion, un dficit ventuel de l'attachement la vie.
Il est vrai qu'on aperoit tout de suite une autre solution possible du problme. La religion statique attache l'homme la vie, et par consquent l'individu la socit, en lui racontant des histoires comparables celles dont on
berce les enfants. Sans doute ce ne sont pas des histoires comme les autres.
Issues de la fonction fabulatrice par ncessit, et non pas pour le simple
plaisir, elles contrefont la ralit perue au point de se prolonger en actions :
les autres crations imaginatives ont cette tendance, mais elles n'exigent pas
que nous nous y laissions aller ; elles peuvent rester l'tat d'ides ; celles-l,
au contraire, sont ido-motrices. Ce n'en sont pas moins des fables, que des
esprits critiques accepteront souvent en fait, comme nous l'avons vu, mais
qu'en droit ils devraient rejeter. Le principe actif, mouvant, dont le seul
stationnement en un point extrme s'est exprime par l'humanit, exige sans
doute de toutes les espces cres qu'elles se cramponnent la vie. Mais,
comme nous le montrions jadis, si ce principe donne toutes les espces
globalement, la manire d'un arbre qui pousse dans toutes les directions des
branches termines en bourgeons, c'est le dpt, dans la matire, d'une nergie
librement cratrice, c'est l'homme ou quelque tre de mme signification nous ne disons pas de mme forme - qui est la raison d'tre du dveloppement
tout entier. L'ensemble et pu tre trs suprieur ce qu'il est, et c'est
probablement ce qui arrive dans des mondes o le courant est lanc travers
une matire moins rfractaire. Comme aussi le courant et pu ne jamais
trouver libre passage, pas mme dans cette mesure insuffisante, auquel cas ne
se seraient jamais dgages sur notre plante la qualit et la quantit d'nergie
cratrice que reprsente la forme humaine. Mais, de toute manire, la vie est
chose au moins aussi dsirable, plus dsirable mme pour l'homme que pour
les autres espces, puisque celles-ci la subissent comme un effet produit au
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
114
passage par l'nergie cratrice, tandis qu'elle est chez l'homme le succs
mme, si incomplet et si prcaire soit-il, de cet effort. Pourquoi, ds lors,
l'homme ne retrouverait-il pas la confiance qui lui manque, ou que la
rflexion a pu branler, en remontant, pour reprendre de l'lan, dans la
direction d'o l'lan tait venu ? Ce n'est pas par l'intelligence, ou en tout cas
avec l'intelligence seule, qu'il pourrait le faire : celle-ci irait plutt en sens
inverse ; elle a une destination spciale et, lorsqu'elle s'lve dans ses spculations, elle nous fait tout au plus concevoir des possibilits, elle ne touche pas
une ralit. Mais nous savons qu'autour de l'intelligence est reste une frange
d'intuition, vague et vanouissante. Ne pourrait-on pas la fixer, l'intensifier, et
surtout la complter en action, car elle n'est devenue pure vision que par un
affaiblissement de son principe et, si l'on peut s'exprimer ainsi, par une
abstraction pratique sur elle-mme ?
Une me capable et digne de cet effort ne se demanderait mme pas si le
principe avec lequel elle se tient maintenant en contact est la cause
transcendante de toutes choses ou si ce n'en est que la dlgation terrestre. Il
lui suffirait de sentir qu'elle se laisse pntrer, sans que sa personnalit s'y
absorbe, par un tre qui peut immensment plus qu'elle, comme le fer par le
feu qui le rougit. Son attachement la vie serait dsormais son insparabilit
de ce principe, joie dans la joie, amour de ce qui n'est qu'amour. A la socit
elle se donnerait par surcrot, mais une socit qui serait alors l'humanit
entire, aime dans l'amour de ce qui en est le principe. La confiance que la
religion statique apportait l'homme s'en trouverait transfigure : plus de
souci pour l'avenir, plus de retour inquiet sur soi-mme ; l'objet n'en vaudrait
matriellement plus la peine, et prendrait moralement une signification trop
haute. C'est maintenant d'un dtachement de chaque chose en particulier que
serait fait l'attachement la vie en gnral. Mais faudrait-il alors parler encore
de religion ? ou fallait-il alors, pour tout ce qui prcdait, employer dj ce
mot ? Les deux choses ne diffrent-elles pas au point de s'exclure, et de ne
pouvoir s'appeler du mme nom ?
Il y a bien des raisons, cependant, pour parler de religion dans les deux
cas. D'abord le mysticisme - car c'est lui que nous pensons - a beau transporter l'me sur un autre plan : il ne lui en assure pas moins, sous une forme
minente, la scurit et la srnit que la religion statique a pour fonction de
procurer. Mais surtout il faut considrer que le mysticisme pur est une essence
rare, qu'on le rencontre le plus souvent l'tat de dilution, qu'il n'en communique pas moins alors la masse laquelle il se mle sa couleur et son
parfum, et qu'on doit le laisser avec elle, pratiquement insparable d'elle, si
l'on veut le prendre agissant, puisque c'est ainsi qu'il a fini par s'imposer au
monde. En se plaant ce point de vue, on apercevrait une srie de transitions, et comme des diffrences de degr, l o rellement il y a une diffrence radicale de nature. Revenons en deux mots sur chacun de ces points.
En le dfinissant par sa relation l'lan vital, nous avons implicitement
admis que le vrai mysticisme tait rare. Nous aurons parler, un peu plus loin,
de sa signification et de sa valeur. Bornons-nous pour le moment remarquer
qu'il se situe, d'aprs ce qui prcde, en un point jusqu'o le courant spirituel
lanc travers la matire aurait probablement voulu, jusqu'o il n'a pu aller.
Car il se joue d'obstacles avec lesquels la nature a d composer, et d'autre part
on ne comprend l'volution de la vie, abstraction faite des voies latrales sur
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
115
lesquelles elle s'est engage par force, que si on la voit la recherche de
quelque chose d'inaccessible quoi le grand mystique atteint. Si tous les
hommes, si beaucoup d'hommes pouvaient monter aussi haut que cet homme
privilgi, ce n'est pas l'espce humaine que la nature se ft arrte, car
celui-l est en ralit plus qu'homme. Des autres formes du gnie on en dirait
d'ailleurs autant : toutes sont galement rares. Ce n'est donc pas par accident,
c'est en vertu de son essence mme que le vrai mysticisme est exceptionnel.
Mais quand il parle, il y a, au fond de la plupart des hommes, quelque
chose qui lui fait imperceptiblement cho. Il nous dcouvre, ou plutt il nous
dcouvrirait une perspective merveilleuse si nous le voulions : nous ne le
voulons pas et, le plus souvent, nous ne pourrions pas le vouloir ; l'effort nous
briserait. Le charme n'en a pas moins opr ; et comme il arrive quand un
artiste de gnie a produit une Oeuvre qui nous dpasse, dont nous ne russissons pas nous assimiler l'esprit, mais qui nous fait sentir la vulgarit de nos
prcdentes admirations, ainsi la religion statique a beau subsister, elle n'est
dj plus entirement ce qu'elle tait, elle n'ose surtout plus s'avouer quand le
vrai grand mysticisme a paru. C'est elle encore, ou du moins elle principalement, que l'humanit demandera l'appui dont elle a besoin ; elle laissera
encore travailler, en la rformant de son mieux, la fonction fabulatrice ; bref,
sa confiance dans la vie restera peu prs telle que l'avait institue la nature.
Mais elle feindra sincrement d'avoir recherch et obtenu en quelque mesure
ce contact avec le principe mme de la nature qui se traduit par un tout autre
attachement la vie, par une confiance transfigure. Incapable de s'lever
aussi haut, elle esquissera le geste, elle prendra l'attitude, et, dans ses discours,
elle rservera la plus belle place des formules qui n'arrivent pas se remplir
pour elle de tout leur sens, comme ces fauteuils rests vides qu'on avait
prpars pour de grands personnages dans une crmonie. Ainsi se constituera
une religion mixte qui impliquera une orientation nouvelle de l'ancienne, une
aspiration plus ou moins prononce du dieu antique, issu de la fonction
fabulatrice, se perdre dans celui qui se rvle effectivement, qui illumine et
rchauffe de sa prsence des mes privilgies. Ainsi s'intercalent, comme
nous le disions, des transitions et des diffrences apparentes de degr entre
deux choses qui diffrent radicalement de nature et qui ne sembleraient pas,
d'abord, devoir s'appeler de la mme manire. Le contraste est frappant dans
bien des cas, par exemple quand des nations en guerre affirment l'une et
l'autre avoir pour elles un dieu qui se trouve ainsi tre le dieu national du
paganisme, alors que le Dieu dont elles s'imaginent parler est un Dieu
commun tous les hommes, dont la seule vision par tous serait l'abolition
immdiate de la guerre. Et pourtant il ne faudrait pas tirer parti de ce contraste
pour dprcier des religions qui, nes du mysticisme, ont gnralis l'usage de
ses formules sans pouvoir pntrer l'humanit entire de la totalit de son
esprit. Il arrive des formules presque vides de faire surgir ici ou l,
vritables paroles magiques, l'esprit capable de les remplir. Un professeur
mdiocre, par l'enseignement machinal d'une science que crrent des
hommes de gnie, veillera chez tel de ses lves la vocation qu'il n'a pas eue
lui-mme, et le convertira inconsciemment en mule de ces grands hommes,
invisibles et prsents dans le message qu'il transmet.
Il y a pourtant une diffrence entre les deux cas, et, si l'on en tient compte,
on verra s'attnuer, en matire de religion, l'opposition entre le statique et
le dynamique sur laquelle nous venons d'insister pour mieux marquer les
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
116
caractres de l'un et de l'autre. La grande majorit des hommes pourra rester
peu prs trangre aux mathmatiques, par exemple, tout en saluant le gnie
d'un Descartes ou d'un Newton. Mais ceux qui se sont inclins de loin devant
la parole mystique, parce qu'ils en entendaient au fond d'eux-mmes le faible
cho, ne demeureront pas indiffrents ce qu'elle annonce. S'ils avaient dj
des croyances, et s'ils ne veulent ou ne peuvent pas s'en dtacher, ils se persuaderont qu'ils les transforment, et ils les modifieront par l effectivement :
les lments subsisteront, mais magntiss et tourns dans un autre sens par
cette aimantation. Un historien des religions n'aura pas de peine retrouver,
dans la matrialit d'une croyance vaguement mystique qui s'est rpandue
parmi les hommes, des lments mythiques et mme magiques. Il prouvera
ainsi qu'il y a une religion statique, naturelle l'homme, et que la nature
humaine est invariable. Mais s'il s'en tient l, il aura nglig quelque chose, et
peut-tre l'essentiel. Du moins aura-t-il, sans prcisment le vouloir, jet un
pont entre le statique et le dynamique, et justifi l'emploi du mme mot dans
des cas aussi diffrents. C'est bien une religion qu'on a encore affaire, mais
une religion nouvelle.
Nous nous en convaincrons encore mieux, nous verrons par un autre ct
comment ces deux religions s'opposent et comment elles se rejoignent, si nous
tenons compte des tentatives de la seconde pour s'installer dans la premire
avant de la supplanter. A vrai dire, c'est nous qui les convertissons en
tentatives, rtroactivement. Elles furent, quand elles se produisirent, des actes
complets, qui se suffisaient eux-mmes, et elles ne sont devenues des
commencements ou des prparations que du jour o elles ont t transformes
en insuccs par une russite finale, grce au mystrieux pouvoir que le prsent
exerce sur le pass. Elles ne nous en serviront pas moins jalonner un
intervalle, analyser en ses lments virtuels l'acte indivisible par lequel la
religion dynamique se pose, et montrer du mme coup, par la direction
videmment commune des lans qui n'ont pas abouti, comment le saut
brusque qui fut dfinitif n'eut rien d'accidentel.
Au premier rang parmi les esquisses du mysticisme futur nous placerons
certains aspects des mystres paens. Il ne faudrait pas que le mot nous ft
illusion : la plupart des mystres n'eurent rien de mystique. Ils se rattachaient
la religion tablie, qui trouvait tout naturel de les avoir ct d'elle. Ils clbraient les mmes dieux, ou des dieux issus de la mme fonction fabulatrice.
Ils renforaient simplement chez les initis l'esprit religieux en le doublant de
cette satisfaction que les hommes ont toujours prouve former de petites
socits au sein de la grande, et s'riger en privilgis par le fait d'une
initiation tenue secrte. Les membres de ces socits closes se sentaient plus
prs du dieu qu'ils invoquaient, ne ft-ce que parce que la reprsentation des
scnes mythologiques jouait un plus grand rle ici que dans les crmonies
publiques. En un certain sens, le dieu tait prsent ; les initis participaient
quelque peu de sa divinit. Ils pouvaient donc esprer d'une autre vie plus et
mieux que ce que faisait attendre la religion nationale. Mais il n'y avait l,
probablement, que des ides importes toutes faites de l'tranger : on sait
quel point l'gypte avait toujours t proccupe du sort de l'homme aprs la
mort, et l'on se rappelle le tmoignage d'Hrodote, d'aprs lequel la Dmter
des mystres leusiniens et le Dionysos de l'orphisme auraient t des
transformations d'Isis et d'Osiris. De sorte que la clbration des mystres, ou
tout au moins ce que nous en connaissons, ne nous offre rien qui ait tranch
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
117
absolument sur le culte publie. A premire vue, on ne trouverait donc pas plus
de mysticit cette religion qu' l'autre. Mais nous ne devons pas nous en
tenir l'aspect qui tait probablement le seul intresser la plupart des initis.
Nous devons nous demander si certains au moins de ces mystres ne portaient
pas la marque de telle ou telle grande personnalit, dont ils pouvaient faire
revivre l'esprit. Nous devons aussi noter que la plupart des auteurs ont insist
sur les scnes d'enthousiasme o le dieu prenait rellement possession de
l'me qui l'invoquait. Par le fait, les mystres les plus vivaces, qui finirent par
entraner dans leur mouvement les mystres leusiniens eux-mmes, furent
ceux de Dionysos et de son continuateur Orphe. Dieu tranger, venu de
Thrace, Dionysos contrastait par sa violence avec la srnit des Olympiens.
Il ne fut pas d'abord le dieu du vin, mais il le devint sans peine, parce que
l'ivresse o il mettait l'me n'tait pas sans ressemblance avec celle que le vin
produit. On sait comment William James fut trait pour avoir qualifi de
mystique, ou tudi comme tel, l'tat conscutif une inhalation de protoxyde
d'azote. On voyait l de l'irrligion. Et l'on aurait eu raison, si le philosophe
avait fait de la rvlation intrieure un quivalent psychologique du
protoxyde, lequel aurait alors t, comme disent les mtaphysiciens, cause
adquate de l'effet produit. Mais l'intoxication ne devait tre ses yeux que
l'occasion. L'tat d'me tait l, prfigur sans doute avec d'autres, et
n'attendait qu'un signal pour se dclencher. Il et pu tre voqu spirituellement, par un effort accompli sur le plan spirituel qui tait le sien. Mais il
pouvait aussi bien l'tre matriellement, par une inhibition de ce qui l'inhibait,
par la suppression d'un obstacle, et tel tait l'effet tout ngatif du toxique ; le
psychologue s'adressait de prfrence Celui-ci, qui lui permettait d'obtenir le
rsultat volont. Ce n'tait peut-tre pas honorer davantage le vin que de
comparer ses effets l'ivresse dionysiaque. Mais l n'est pas le point
important. Il s'agit de savoir si cette ivresse peut tre considre rtrospectivement, la lumire du mysticisme une fois paru, comme annonciatrice de
certains tats mystiques. Pour rpondre la question, il suffit de jeter un coup
dil sur l'volution de la philosophie grecque.
Cette volution fut purement rationnelle. Elle porta la pense humaine
son plus haut degr d'abstraction et de gnralit. Elle donna aux fonctions
dialectiques de l'esprit tant de force et de souplesse qu'aujourd'hui encore,
pour les exercer, c'est l'cole des Grecs que nous nous mettons. Deux points
sont pourtant noter. Le premier est qu' l'origine de ce grand mouvement il y
eut une impulsion ou une secousse qui ne fut pas d'ordre philosophique. Le
second est que la doctrine laquelle le mouvement aboutit, et o la pense
hellnique trouva son achvement, prtendit dpasser la pure raison. Il n'est
pas douteux, en effet, que l'enthousiasme dionysiaque se soit prolong dans
l'orphisme, et que l'orphisme se soit prolong en pythagorisme : or c'est
celui-ci, peut-tre mme celui-l, que remonte l'inspiration premire du
platonisme. On sait dans quelle atmosphre de mystre, au sens orphique du
mot, baignent les mythes platoniciens, et comment la thorie des Ides ellemme inclina par une sympathie secrte vers la thorie pythagoricienne des
nombres. Sans doute aucune influence de ce genre n'est sensible chez Aristote
et ses successeurs immdiats ; mais la philosophie de Plotin, laquelle ce
dveloppement aboutit, et qui doit autant Aristote qu' Platon, est incontestablement mystique. Si elle a subi l'action de la pense orientale, trs
vivante dans le monde alexandrin, ce fut l'insu de Plotin lui-mme, qui a cru
ne faire autre chose que condenser toute la philosophie grecque, pour
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
118
l'opposer prcisment aux doctrines trangres. Ainsi, en rsum, il y eut
l'origine une pntration de l'orphisme, et, la fin, un panouissement de la
dialectique en mystique. De l on pourrait conclure que c'est une force extrarationnelle qui suscita ce dveloppement rationnel et qui le conduisit son
terme, au del de la raison. C'est ainsi que les phnomnes lents et rguliers de
sdimentation, seuls apparents, sont conditionns par d'invisibles forces
ruptives qui, en soulevant a certains moments l'corce terrestre, impriment sa
direction l'activit sdimentaire. Mais une autre interprtation est possible ;
et elle serait, notre sens, plus vraisemblable. On peut supposer que le
dveloppement de la pense grecque fut luvre de la seule raison, et qu'
ct de lui, indpendamment de lui, se produisit de loin en loin chez quelques
mes prdisposes un effort pour aller chercher, par del l'intelligence, une
vision, un contact, la rvlation d'une ralit transcendante. Cet effort n'aurait
jamais atteint le but ; mais chaque fois, au moment de s'puiser, il aurait
confi la dialectique ce qui restait de lui-mme plutt que de disparatre tout
entier; et ainsi, avec la mme dpense de force, une nouvelle tentative pouvait
ne s'arrter que plus loin, l'intelligence se trouvant rejointe en un point plus
avanc d'un dveloppement philosophique qui avait, dans l'intervalle, acquis
plus d'lasticit et comportait plus de mysticit. Par le fait, nous voyons une
premire vague, purement dionysiaque, venir se perdre dans l'orphisme, qui
tait d'une intellectualit suprieure ; une seconde, qu'on pourrait appeler
orphique, aboutit au pythagorisme, c'est--dire une philosophie ; son tour
le pythagorisme communiqua quelque chose de son esprit au platonisme ; et
celui-ci, l'ayant recueilli, s'ouvrit naturellement plus tard au mysticisme
alexandrin. Mais de quelque manire qu'on se reprsente le rapport entre les
deux courants, l'un intellectuel, l'autre extra-intellectuel, c'est seulement en se
plaant au terme qu'on peut qualifier celui-ci de supra-intellectuel ou de
mystique, et tenir pour mystique une impulsion qui partit des mystres.
Resterait savoir, alors, si le terme du mouvement fut un mysticisme complet. On peut donner aux mots le sens qu'on veut, pourvu qu'on le dfinisse
d'abord. A nos yeux, l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact,
et par consquent une concidence partielle, avec l'effort crateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-mme. Le grand
mystique serait une individualit qui franchirait les limites assignes a
l'espce par sa matrialit, qui continuerait et prolongerait ainsi l'action
divine. Telle est notre dfinition. Nous sommes libres de la poser, pourvu que
nous nous demandions si elle trouve jamais son application, si elle s'applique
alors tel ou tel cas dtermin. En ce qui concerne Plotin, la rponse n'est pas
douteuse. Il lui fut donn de voir la terre promise, mais non pas d'en fouler le
sol. Il alla jusqu' l'extase, un tat o l'me se sent ou croit se sentir en
prsence de Dieu, tant illumine de sa lumire ; il ne franchit pas cette
dernire tape pour arriver au point o, la contemplation venant s'abmer dans
l'action, la volont humaine se confond avec la volont divine. Il se croyait au
fate : aller plus loin et t pour lui descendre. C'est ce qu'il a exprim dans
une langue admirable, mais qui n'est pas celle du mysticisme plein : l'action,
dit-il, est un affaiblissement de la contemplation 1. Par l il reste fidle
l'intellectualisme grec, il le rsume mme dans une formule saisissante ; du
moins l'a-t-il fortement imprgn de mysticit. En un mot, le mysticisme, au
1
Epei kai anthrpoi, hotan asthenssin eis to therein, skian therias kai logou tn
praxin poiountai (Enn. III, VIII, 4).
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
119
sens absolu o nous convenons de le prendre, n'a pas t atteint par la pense
hellnique. Il aurait sans doute voulu tre ; il a, simple virtualit, plusieurs
fois frapp la porte. Celle-ci s'est entrebille de plus en plus largement,
mais ne l'a jamais laiss passer tout entier.
La distinction est radicale ici entre la mystique et la dialectique ; elles se
rejoignent seulement de loin en loin. Ailleurs, au contraire, elles ont t
constamment mles, s'entr'aidant en apparence, peut-tre s'empchant
rciproquement d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui est arriv, croyons-nous,
la pense hindoue. Nous n'entreprendrons pas de l'approfondir ou de la
rsumer. Son dveloppement s'tend sur des priodes considrables. Philosophie et religion, elle s'est diversifie selon les temps et les lieux. Elle s'est
exprime dans une langue dont beaucoup de nuances chappent ceux-l
mmes qui la connaissent le mieux. Les mots de cette langue sont d'ailleurs
loin d'avoir conserv un sens invariable, supposer que ce sens ait toujours
t prcis ou qu'il l'ait t jamais. Mais, pour l'objet qui nous occupe, un coup
d'il jet sur l'ensemble des doctrines suffira. Et comme, pour obtenir cette
vision globale, nous devrons ncessairement nous contenter de superposer
ensemble des vues dj prises, nous aurons quelque chance, en considrant de
prfrence les lignes qui concident, de ne pas nous tromper. c
Disons d'abord que l'Inde a toujours pratiqu une religion comparable
celle de l'ancienne Grce. Les dieux et les esprits y jouaient le mme rle que
partout ailleurs. Les rites et crmonies taient analogues. Le sacrifice avait
une importance extrme. Ces cultes persistrent travers le Brahmanisme, le
Janisme et le Bouddhisme. Comment taient-ils compatibles avec un enseignement tel que celui du Bouddha ? Il faut remarquer que le Bouddhisme, qui
apportait aux hommes la dlivrance, considrait les dieux eux-mmes comme
ayant besoin d'tre dlivrs. Il traitait donc hommes et dieux en tres de mme
espce, soumis a la mme fatalit. Cela se concevrait bien dans une hypothse
telle que la ntre : l'homme vit naturellement en socit, et, par l'effet d'une
fonction naturelle, que nous avons appele fabulatrice, il projette autour de lui
des tres fantasmatiques qui vivent d'une vie analogue la sienne, plus haute
que la sienne, solidaire de la sienne ; telle est la religion que nous tenons pour
naturelle. Les penseurs de l'Inde se sont-ils jamais reprsent ainsi les
choses ? C'est peu probable. Mais tout esprit qui s'engage sur la voie
mystique, hors de la cit, sent plus ou moins confusment qu'il laisse derrire
lui les hommes et les dieux. Par l mme il les voit ensemble.
Maintenant, jusqu'o la pense hindoue est-elle alle dans cette voie ? Il
ne s'agit, bien entendu, que de l'Inde antique, seule avec elle-mme, avant
l'influence qu'a pu exercer sur elle la civilisation occidentale ou le besoin de
ragir contre elle. Statique ou dynamique, en effet, nous prenons la religion
ses origines. Nous avons trouv que la premire tait prfigure dans la nature
; nous voyons maintenant dans la seconde un bond hors de la nature, et nous
considrons d'abord le bond dans des cas o l'lan fut insuffisant ou contrari.
A cet lan il semble que l'me hindoue se soit essaye par deux mthodes
diffrentes.
L'une d'elles est la fois physiologique et psychologique. On en dcouvrirait la plus lointaine origine dans une pratique commune aux Hindous et
aux Iraniens, antrieure par consquent leur sparation : le recours la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
120
boisson enivrante que les uns et les autres appelaient soma . C'tait une
ivresse divine, comparable celle que les fervents de Dionysos demandaient
au vin. Plus tard vint un ensemble d'exercices destins suspendre la sensation, ralentir l'activit mentale, enfin induire des tats comparables celui
d'hypnose ; ils se systmatisrent dans le yoga . tait-ce l du mysticisme,
au sens o nous prenons le mot ? Des tats hypnotiques n'ont rien de mystique
par eux-mmes, mais ils pourront le devenir, ou du moins annoncer et prparer le mysticisme vrai, par la suggestion qui s'y insrera. Ils le deviendront
facilement, leur forme sera prdispose se remplir de cette matire, s'ils
dessinent dj des visions, des extases, suspendant la fonction critique de
l'intelligence. Telle a d tre, par un cte au moins, la signification des
exercices qui finirent par s'organiser en yoga . Le mysticisme n'y tait qu'
l'tat d'bauche ; mais un mysticisme plus accus, concentration purement
spirituelle, pouvait s'aider du yoga dans ce que celui-ci avait de matriel et,
par l mme, le spiritualiser. De fait, le yoga semble avoir t, selon les temps
et les lieux, une forme plus populaire de la contemplation mystique ou un
ensemble qui l'englobait.
Reste savoir ce que fut cette contemplation elle-mme, et quel rapport
elle pouvait avoir avec le mysticisme tel que nous l'entendons. Ds les temps
les plus anciens l'Hindou spcula sur l'tre en gnral, sur la nature, sur la vie.
Mais son effort, qui s'est prolong pendant un si grand nombre de sicles, n'a
pas abouti, comme celui des philosophes grecs, la connaissance indfiniment dveloppable que fut dj la science hellnique. La raison en est que la
connaissance fut toujours ses yeux un moyen plutt qu'une fin. Il s'agissait
pour lui de s'vader de la vie, qui lui tait particulirement cruelle. Et par le
suicide il n'aurait pas obtenu l'vasion, car l'me devait passer dans un autre
corps aprs la mort, et c'et t, perptuit, un recommencement de la vie et
de la souffrance. Mais ds les premiers temps du Brahmanisme il se persuada
qu'on arrivait la dlivrance par le renoncement. Ce renoncement tait une
absorption dans le Tout, comme aussi en soi-mme. Le Bouddhisme, qui vint
inflchir le Brahmanisme, ne le modifia pas essentiellement. Il en fit surtout
quelque chose de plus savant. Jusque-l, on avait constat que la vie tait
souffrance : le Bouddha remonta jusqu' la cause de la souffrance ; il la dcouvrit dans le dsir en gnral, dans la soif de vivre. Ainsi put tre trac avec
une prcision plus haute le chemin de la dlivrance. Brahmanisme, Bouddhisme et mme Janisme ont donc prch avec une force croissante l'extinction du vouloir-vivre, et cette prdication se prsente au premier abord comme
un appel l'intelligence, les trois doctrines ne diffrant que par leur degr plus
ou moins lev d'intellectualit. Mais, y regarder de prs, on s'aperoit que
la conviction qu'elles visaient implanter tait loin d'tre un tat purement
intellectuel. Dj, dans l'ancien Brahmanisme, ce n'est pas par le raisonnement, ce n'est pas par l'tude, que s'obtient la conviction dernire : elle
consiste en une vision, communique par celui qui a vu. Le Bouddhisme, plus
savant d'un ct, est plus mystique encore de l'autre. L'tat o il achemine
l'me est au del du bonheur et de la souffrance, au del de la conscience.
C'est par une srie d'tapes, et par toute une discipline mystique, qu'il aboutit
au nirvana, suppression du dsir pendant la vie et du karma aprs la mort. Il
ne faut pas oublier qu' l'origine de la mission du Bouddha est l'illumination
qu'il eut dans sa premire jeunesse. Tout ce que le Bouddhisme a d'exprimable en mots peut sans doute tre trait comme une philosophie ; mais
l'essentiel est la rvlation dfinitive, transcendante la raison comme la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
121
parole. C'est la conviction, graduellement gagne et subitement obtenue, que
le but est atteint : finie la souffrance, qui est tout ce qu'il y a de dtermin, et
par consquent de proprement existant, dans l'existence. Si nous considrons
que nous n'avons pas affaire ici une vue thorique, mais une exprience
qui ressemble beaucoup une extase, que dans un effort pour concider avec
l'lan crateur une me pourrait prendre la voie ainsi dcrite et n'chouerait
que parce qu'elle se serait arrte mi-chemin, dtache de la vie humaine
mais n'atteignant pas la vie divine, suspendue entre deux activits dans le
vertige du nant, nous n'hsiterons pas voir dans le Bouddhisme un
mysticisme. Mais nous comprendrons pourquoi le Bouddhisme n'est pas un
mysticisme complet. Celui-ci serait action, cration, amour.
Non pas certes que le Bouddhisme ait ignor la charit. Il l'a recommande
au contraire en termes d'une lvation extrme. Au prcepte il a joint l'exemple. Mais il a manqu de chaleur. Comme l'a dit trs justement un historien
des religions, il a ignor le don total et mystrieux de soi-mme . Ajoutons
- et c'est peut-tre, au fond, la mme chose - qu'il n'a pas cru l'efficacit de
l'action humaine. Il n'a pas eu confiance en elle. Seule cette confiance peut
devenir puissance, et soulever les montagnes. Un mysticisme complet ft all
jusque-l. Il s'est rencontr peut-tre dans l'Inde, mais beaucoup plus tard.
C'est en effet une charit ardente, c'est un mysticisme comparable au mysticisme chrtien, que nous trouvons chez un Ramakrishna ou un Vivekananda,
pour ne parler que des plus rcents. Mais, prcisment, le christianisme avait
surgi dans l'intervalle. Son influence sur l'Inde - venue d'ailleurs l'islamisme
- a t bien superficielle, mais des mes prdisposes une simple suggestion,
un signal suffit. Admettons pourtant que l'action directe du christianisme, en
tant que dogme, ait t peu prs nulle dans l'Inde. Comme il a pntr toute
la civilisation occidentale, on le respire, ainsi qu'un parfum, dans ce que cette
civilisation apporte avec elle. L'industrialisme lui-mme, comme nous essaierons de le montrer, en drive indirectement. Or c'est l'industrialisme, c'est
notre civilisation occidentale, qui a dclench le mysticisme d'un Ramakrishna ou d'un Vivekananda. Jamais ce mysticisme ardent, agissant, ne se ft
produit au temps o l'Hindou se sentait cras par la nature et o toute
intervention humaine tait inutile. Que faire, lorsque des famines invitables
condamnent des millions de malheureux mourir de faim ? Le pessimisme
hindou avait pour principale origine cette impuissance. Et c'est le pessimisme
qui a empch l'Inde d'aller jusqu'au bout de son mysticisme, puisque le
mysticisme complet est action. Mais viennent les machines qui accroissent le
rendement de la terre et qui surtout en font circuler les produits, viennent
aussi des organisations politiques et sociales qui prouvent exprimentalement
que les masses ne sont pas condamnes une vie de servitude et de misre
comme une ncessit inluctable la dlivrance devient possible dans un sens
tout nouveau la pousse mystique, si elle s'exerce quelque part avec assez de
force, ne s'arrtera plus net devant des impossibilits d'agir ; elle ne sera plus
refoule sur des doctrines de renoncement ou des pratiques d'extase ; au lieu
de s'absorber en elle-mme, l'me s'ouvrira toute grande un universel amour.
Or ces inventions et ces organisations sont d'essence occidentale ; ce sont
elles qui ont permis ici au mysticisme d'aller jusqu'au bout de lui-mme.
Concluons donc que ni dans la Grce ni dans lInde antique il n'y eut de
mysticisme complet, tantt parce que l'lan fut insuffisant, tantt parce qu'il
fut contrari par les circonstances matrielles ou par une intellectualit trop
troite. C'est son apparition un moment prcis qui nous fait assister
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
122
rtrospectivement sa prparation, comme le volcan qui surgit tout d'un coup
claire dans le pass une longue srie de tremblements de terre 1.
Le mysticisme complet est en effet celui des grands mystiques chrtiens.
Laissons de ct, pour le moment, leur christianisme, et considrons chez eux
la forme sans la matire. Il n'est pas douteux que la plupart aient pass par des
tats qui ressemblent aux divers points d'aboutissement du mysticisme
antique. Mais ils n'ont fait qu'y passer : se ramassant sur eux-mmes pour se
tendre dans un tout nouvel effort, ils ont rompu une digue ; un immense
courant de vie les a ressaisis ; de leur vitalit accrue s'est dgage une nergie,
une audace, une puissance de conception et de ralisation extraordinaires.
Qu'on pense ce qu'accomplirent, dans le domaine de l'action, un saint Paul,
une sainte Thrse, une sainte Catherine de Sienne, un saint Franois, une
Jeanne d'Arc, et tant d'autres 2. Presque toutes ces activits surabondantes se
sont employes la propagation du christianisme. Il y a des exceptions
cependant, et le cas de Jeanne dArc suffirait montrer que la forme est
sparable de la matire.
Quand on prend ainsi son terme l'volution intrieure des grands mystiques, on se demande comment ils ont pu tre assimils des malades. Certes,
nous vivons dans un tat d'quilibre instable, et la sant moyenne de l'esprit,
comme d'ailleurs celle du corps, est chose malaise dfinir. Il y a pourtant
une sant intellectuelle solidement assise, exceptionnelle, qui se reconnat
sans peine. Elle se manifeste par le got de l'action, la facult de s'adapter et
de se radapter aux circonstances, la fermet jointe la souplesse, le discernement prophtique du possible et de l'impossible, un esprit de simplicit qui
triomphe des complications, enfin un bon sens suprieur. N'est-ce pas
prcisment ce qu'on trouve chez les mystiques dont nous parlons ? Et ne
pourraient-ils pas servir la dfinition mme de la robustesse intellectuelle ?
Si l'on en a jug autrement, c'est cause des tats anormaux qui prludent
souvent chez eux la transformation dfinitive. Ils parlent de leurs visions, de
leurs extases, de leurs ravissements. Ce sont l des phnomnes qui se produisent aussi bien chez des malades, et qui sont constitutifs de leur maladie.
Un important ouvrage a paru rcemment sur l'extase envisage comme une
manifestation psychastnique 3. Mais il y a des tats morbides qui sont des
imitations d'tats sains : ceux-ci n'en sont pas moins sains, et les autres
morbides. Un fou se croira empereur ; ses gestes, ses paroles et ses actes
il donnera une allure systmatiquement napolonienne, et ce sera justement sa
folie : en rejaillira-t-il quelque chose sur Napolon ? On pourra aussi bien
parodier le mysticisme, et il y aura une folie mystique : suivra-t-il de l que le
1
Nous n'ignorons pas qu'il y eut d'autres mysticismes, dans l'antiquit, que le noplatonisme et le Bouddhisme. Mais, pour l'objet qui nous occupe, il nous suffit de
considrer ceux qui se sont avancs le plus loin.
Sur ce qu'il y a d'essentiellement agissant chez les grands mystiques chrtiens M. Henri
Delacroix a appel l'attention dans un livre qui mriterait de devenir classique (tudes
d'histoire et de psychologie du mysticisme, Paris, 1908), On trouvera des ides analogues
dans les importants ouvrages d'Evelyn Underhill (Mysticism, London, 1911 ; et The
mystic way, London, 1913). Ce dernier auteur rattache certaines de ses vues celles que
nous exposions dans L'volution cratrice et que nous reprenons, pour les prolonger,
dans le prsent chapitre. Voir en particulier, sur ce point, The mystic way.
Janet, Pierre De l'angoisse l'extase.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
123
mysticisme soit folie ? Toutefois il est incontestable qu'extases, visions,
ravissements sont des tats anormaux, et qu'il est difficile de distinguer entre
l'anormal et le morbide. Telle a d'ailleurs t l'opinion des grands mystiques
eux-mmes. Ils ont t les premiers mettre leurs disciples en garde contre les
visions qui pouvaient tre purement hallucinatoires. Et leurs propres visions,
quand ils en avaient, ils n'ont gnralement attach qu'une importance secondaire : c'taient des incidents de la route ; il avait fallu les dpasser, laisser
aussi bien derrire soi ravissements et extases pour atteindre le terme, qui tait
l'identification de la volont humaine avec la volont divine. La vrit est que
ces tats anormaux, leur ressemblance et parfois sans doute aussi leur
participation des tats morbides, se comprendront sans peine si l'on pense au
bouleversement qu'est le passage du statique au dynamique, du clos l'ouvert,
de la vie habituelle la vie mystique. Quand les profondeurs obscures de
l'me sont remues, ce qui monte la surface et arrive la conscience y
prend, si l'intensit est suffisante, la forme d'une image ou d'une motion.
L'image est le plus souvent hallucination pure, comme l'motion n'est qu'agitation vaine. Mais l'une et l'autre peuvent exprimer que le bouleversement est
un rarrangement systmatique en vue d'un quilibre suprieur : l'image est
alors symbolique de ce qui se prpare, et l'motion est une concentration de
l'me dans l'attente d'une transformation. Ce dernier cas est celui du mysticisme, mais il peut participer de l'autre ; ce qui est simplement anormal peut
se doubler de ce qui est nettement morbide ; dranger les rapports habituels
entre le conscient et l'inconscient on court un risque. Il ne faut donc pas
s'tonner si des troubles nerveux accompagnent parfois le mysticisme ; on en
rencontre aussi bien dans d'autres formes du gnie, notamment chez des
musiciens. Il n'y faut voir que des accidents. Ceux-l ne sont pas plus de la
mystique que ceux-ci ne sont de la musique.
branle dans ses profondeurs par le courant qui l'entranera, l'me cesse
de tourner sur elle-mme, chappant un instant la loi qui veut que l'espce et
l'individu se conditionnent l'un l'autre, circulairement. Elle s'arrte, comme si
elle coutait une voix qui l'appelle. Puis elle se laisse porter, droit en avant.
Elle ne peroit pas directement la force qui la meut, mais elle en sent
l'indfinissable prsence, ou la devine travers une vision symbolique. Vient
alors une immensit de joie, extase o elle s'absorbe ou ravissement qu'elle
subit : Dieu est l, et elle est en lui. Plus de mystre. Les problmes s'vanouissent, les obscurits se dissipent ; c'est une illumination. Mais pour
combien de temps ? Une imperceptible inquitude, qui planait sur l'extase,
descend et s'attache elle comme son ombre. Elle suffirait dj, mme sans
les tats qui vont suivre, distinguer le mysticisme vrai, complet, de ce qui en
fut jadis l'imitation anticipe ou la prparation. Elle montre en effet que l'me
du grand mystique ne s'arrte pas l'extase comme au terme d'un voyage.
C'est bien le repos, si l'on veut, mais comme une station o la machine
resterait sous pression, le mouvement se continuant en branlement sur place
dans l'attente d'un nouveau bond en avant. Disons plus prcisment : l'union
avec Dieu a beau tre troite, elle ne serait dfinitive que si elle tait totale.
Plus de distance, sans doute, entre la pense et l'objet de la pense, puisque les
problmes sont tombs qui mesuraient et mme constituaient l'cart. Plus de
sparation radicale entre ce qui aime et ce qui est aim : Dieu est prsent et la
joie est sans bornes. Mais si l'me s'absorbe en Dieu par la pense et par le
sentiment, quelque chose d'elle reste en dehors . c'est la volont : son action,
si elle agissait, procderait simplement d'elle. Sa vie n'est donc pas encore
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
124
divine. Elle le sait ; vaguement elle s'en inquite, et cette agitation dans le
repos est caractristique de ce que nous appelons le mysticisme complet : elle
exprime que l'lan avait t pris pour aller plus loin, que l'extase intresse bien
la facult de voir et de s'mouvoir, mais qu'il y a aussi le vouloir, et qu'il
faudrait le replacer lui-mme en Dieu. Quand ce sentiment a grandi au point
d'occuper toute la place, l'extase est tombe, l'me se retrouve seule et parfois
se dsole. Habitue pour un temps l'blouissante lumire, elle ne distingue
plus rien dans l'ombre. Elle ne se rend pas compte du travail profond qui
s'accomplit obscurment en elle. Elle sent qu'elle a beaucoup perdu ; elle ne
sait pas encore que c'est pour tout gagner. Telle est la nuit obscure dont les
grands mystiques ont parl, et qui est peut-tre ce qu'il y a de plus significatif,
en tout cas de plus instructif, dans le mysticisme chrtien. La phase dfinitive,
caractristique du grand mysticisme, se prpare. Analyser cette prparation
finale est impossible, les mystiques eux-mmes en ayant peine entrevu le
mcanisme. Bornons-nous dire qu'une machine d'un acier formidablement
rsistant, construite en vue d'un effort extraordinaire, se trouverait sans doute
dans un tat analogue si elle prenait conscience d'elle-mme au moment du
montage. Ses pices tant soumises, une une, aux plus dures preuves,
certaines tant rejetes et remplaces par d'autres, elle aurait le sentiment d'un
manque et l, et d'une douleur partout. Mais cette peine toute superficielle
n'aurait qu' s'approfondir pour venir se perdre dans l'attente et l'espoir d'un
instrument merveilleux. L'me mystique veut tre cet instrument. Elle limine
de sa substance tout ce qui n'est pas assez pur, assez rsistant et souple, pour
que Dieu l'utilise. Dj elle sentait Dieu prsent, dj elle croyait l'apercevoir
dans des visions symboliques, dj mme elle s'unissait lui dans l'extase ;
mais rien de tout cela n'tait durable parce que tout cela n'tait que contemplation : l'action ramenait l'me elle-mme et la dtachait ainsi de Dieu.
Maintenant c'est Dieu qui agit par elle, en elle : l'union est totale, et par
consquent dfinitive. Alors, des mots tels que mcanisme et instrument
voquent des images qu'il vaudra mieux laisser de ct. On pouvait s'en servir
pour nous donner une ide du travail de prparation. On ne nous apprendra
rien par l du rsultat final. Disons que c'est dsormais, pour l'me, une
surabondance de vie. C'est un immense lan. C'est une pousse irrsistible qui
la jette dans les plus vastes entreprises. Une exaltation calme de toutes ses
facults fait qu'elle voit grand et, si faible soit-elle, ralise puissamment.
Surtout elle voit simple, et cette simplicit, qui frappe aussi bien dans ses
paroles et dans sa conduite, la guide travers des complications qu'elle
semble ne pas mme apercevoir. Une science inne, ou plutt une innocence
acquise, lui suggre ainsi du premier coup la dmarche utile, l'acte dcisif, le
mot sans rplique. L'effort reste pourtant indispensable, et aussi l'endurance et
la persvrance. Mais ils viennent tout seuls, ils se dploient d'eux-mmes
dans une me la fois agissante et agie , dont la libert concide avec l'activit divine. Ils reprsentent une norme dpense d'nergie, mais cette nergie
est fournie en mme temps que requise, car la surabondance de vitalit qu'elle
rclame coule d'une source qui est celle mme de la vie. Maintenant les
visions sont loin : la divinit ne saurait se manifester du dehors une me
dsormais remplie d'elle. Plus rien qui paraisse distinguer essentiellement un
tel homme des hommes parmi lesquels il circule. Lui seul se rend compte d'un
changement qui l'lve au rang des adjutores Dei, patients par rapport Dieu,
agents par rapport aux hommes. De cette lvation il ne tire d'ailleurs nul
orgueil. Grande est au contraire son humilit. Comment ne serait-il pas
humble, alors qu'il a pu constater dans des entretiens silencieux, seul seul,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
125
avec une motion o son me se sentait fondre tout entire, ce qu'on pourrait
appeler l'humilit divine ?
Dj dans le mysticisme qui s'arrtait l'extase, c'est--dire la contemplation, une certaine action tait prforme. On prouvait, peine redescendu
du ciel sur la terre, le besoin d'aller enseigner les hommes. Il fallait annoncer
tous que le monde peru par les yeux du corps est sans doute rel, mais qu'il y
a autre chose, et que ce West pas simplement possible ou probable, comme le
serait la conclusion d'un raisonnement, mais certain comme une exprience :
quelqu'un a vu, quelqu'un a touch, quelqu'un sait. Toutefois il n'y avait l
qu'une vellit d'apostolat. L'entreprise tait en effet dcourageante : la
conviction qu'on tient d'une exprience, comment la propager par des
discours ? et comment surtout exprimer l'inexprimable ? Mais ces questions
ne se posent mme pas au grand mystique. Il a senti la vrit couler en lui de
sa source comme une force agissante. Il ne s'empcherait pas plus de la
rpandre que le soleil de dverser sa lumire. Seulement, ce n'est plus par de
simples discours qu'il la propagera.
Car l'amour qui le consume n'est plus simplement l'amour d'un homme
pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. A travers Dieu, par
Dieu, il aime toute l'humanit d'un divin amour. Ce n'est pas la fraternit que
les philosophes ont recommande au nom de la raison, en arguant de ce que
tous les hommes participent originellement d'une mme essence raisonnable :
devant un idal aussi noble on s'inclinera avec respect ; on s'efforcera de le
raliser s'il n'est pas trop gnant pour l'individu et pour la communaut ; on ne
s'y attachera pas avec passion. Ou bien alors ce sera qu'on aura respir dans
quelque coin de notre civilisation le parfum enivrant que le mysticisme y a
laiss. Les philosophes eux-mmes auraient-ils pos avec une telle assurance
le principe, si peu conforme l'exprience courante, de l'gale participation de
tous les hommes une essence suprieure, s'il ne s'tait pas trouv des
mystiques pour embrasser l'humanit entire dans un seul indivisible amour ?
Il ne s'agit donc pas ici de la fraternit dont on a construit l'ide pour en faire
un idal. Et il ne s'agit pas non plus de l'intensification d'une sympathie inne
de l'homme pour l'homme. D'un tel instinct on peut d'ailleurs se demander s'il
a jamais exist ailleurs que dans l'imagination des philosophes, o il a surgi
pour des raisons de symtrie. Famille, patrie, humanit apparaissant comme
des cercles de plus en plus larges, on a pens que l'homme devait aimer
naturellement l'humanit comme on aime sa patrie et sa famille, alors qu'en
ralit le groupement familial et le groupement social sont les seuls qui aient
t voulus par la nature, les seuls auxquels correspondent des instincts, et que
les instincts sociaux porteraient les socits lutter les unes contre les autres
bien plutt qu' s'unir pour se constituer effectivement en humanit. Tout au
plus le sentiment familial et social pourra-t-il surabonder accidentellement et
s'employer au del de ses frontires naturelles, par luxe ou par jeu ; cela n'ira
jamais trs loin. Bien diffrent est l'amour mystique de l'humanit. Il ne
prolonge pas un instinct, il ne drive pas d'une ide. Ce n'est ni du sensible ni
du rationnel. C'est l'un et l'autre implicitement, et c'est beaucoup plus
effectivement. Car un tel amour est la racine mme de la sensibilit et de la
raison, comme du reste des choses. Concidant avec l'amour de Dieu pour son
uvre, amour qui a tout fait, il livrerait qui saurait l'interroger le secret de la
cration. Il est d'essence mtaphysique encore plus que morale. Il voudrait,
avec l'aide de Dieu, parachever la cration de l'espce humaine et faire de
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
126
l'humanit ce qu'elle et t tout de suite si elle avait pu se constituer
dfinitivement sans l'aide de l'homme lui-mme. Ou, pour employer des mots
qui disent, comme nous le verrons, la mme chose dans une autre langue: sa
direction est celle mme de l'lan de vie ; il est cet lan mme, communiqu
intgralement des hommes privilgis qui voudraient l'imprimer alors
l'humanit entire et, par une contradiction ralise, convertir en effort
crateur cette chose cre qu'est une espce, faire un mouvement de ce qui est
par dfinition un arrt.
Russira-t-il ? Si le mysticisme doit transformer l'humanit, ce ne pourra
tre qu'en transmettant de proche en proche, lentement, une partie de luimme. Les mystiques le sentent bien. Le grand obstacle qu'ils rencontreront
est celui qui a empch la cration d'une humanit divine. L'homme doit
gagner son pain la sueur de son front : en d'autres termes, l'humanit est une
espce animale, soumise comme telle la loi qui rgit le monde animal et qui
condamne le vivant se repatre du vivant. Sa nourriture lui tant alors
dispute et par la nature en gnral et par ses congnres, il emploie ncessairement son effort se la procurer, son intelligence est justement faite pour lui
fournir des armes et des outils en vue de cette lutte et de ce travail. Comment,
dans ces conditions, l'humanit tournerait-elle vers le ciel une attention essentiellement fixe sur la terre ? Si c'est possible, ce ne pourra tre que par
l'emploi simultan ou successif de deux mthodes trs diffrentes. La premire consisterait intensifier si bien le travail intellectuel, porter l'intelligence si loin au del de ce que la nature avait voulu pour elle, que le simple
outil cdt la place un immense systme de machines capable de librer
l'activit humaine, cette libration tant d'ailleurs consolide par une organisation politique et sociale qui assurt au machinisme sa vritable destination.
Moyen dangereux, car la mcanique, en se dveloppant, pourra se retourner
contre la mystique : mme, c'est en raction apparente contre celle-ci que la
mcanique se dveloppera le plus compltement. Mais il y a des risques qu'il
faut courir : une activit d'ordre suprieur, qui a besoin d'une activit plus
basse, devra la susciter ou en tout cas la laisser faire, quitte se dfendre s'il
en est besoin ; l'exprience montre que si, de deux tendances contraires mais
complmentaires, l'une a grandi au point de vouloir prendre toute la place,
l'autre s'en trouvera bien pour peu qu'elle ait su se conserver: son tour
reviendra, et elle bnficiera alors de tout ce qui a t fait sans elle, qui n'a
mme t men vigoureusement que contre elle. Quoi qu'il en soit, ce moyen
ne pouvait tre utilis que beaucoup plus tard, et il y avait, en attendant, une
tout autre mthode suivre. C'tait de ne pas rver pour l'lan mystique une
propagation gnrale immdiate, videmment impossible, mais de le
communiquer, encore que dj affaibli, un petit nombre de privilgis qui
formeraient ensemble une socit spirituelle ; les socits de ce genre pourraient essaimer ; chacune d'elles, par ceux de ses membres qui seraient
exceptionnellement dous, donnerait naissance une ou plusieurs autres ;
ainsi se conserverait, ainsi se continuerait l'lan jusqu'au jour o un changement profond des conditions matrielles imposes l'humanit par la nature
permettrait, du ct spirituel, une transformation radicale. Telle est la mthode
que les grands mystiques ont suivie. C'est par ncessit, et parce qu'ils ne
pouvaient pas faire davantage, qu'ils dpensrent surtout fonder des couvents ou des ordres religieux leur nergie surabondante. Ils n'avaient pas
regarder plus loin pour le moment. L'lan d'amour qui les portait lever
l'humanit jusqu' Dieu et parfaire la cration divine ne pouvait aboutir, a
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
127
leurs yeux, qu'avec l'aide de Dieu dont ils taient les instruments. Tout leur
effort devait donc se concentrer sur une tche trs grande, trs difficile, mais
limite. D'autres efforts viendraient, d'autres taient d'ailleurs dj venus ;
tous seraient convergents, puisque Dieu en faisait l'unit.
Nous avons, en effet, beaucoup simplifi les choses. Pour plus de clart, et
surtout pour srier les difficults, nous avons raisonn comme si le mystique
chrtien, porteur d'une rvlation intrieure, survenait dans une humanit qui
ne connatrait rien d'elle. Par le fait, les hommes auxquels il s'adresse ont dj
une religion, qui tait d'ailleurs la sienne. S'il avait des visions, elles lui
prsentaient en images ce que sa religion lui avait inculqu sous forme
d'ides. S'il avait des extases, elles l'unissaient un Dieu qui dpassait sans
doute tout ce qu'il avait imagin, mais qui rpondait encore la description
abstraite que la religion lui avait fournie. On pourrait mme se demander si
ces enseignements abstraits ne sont pas l'origine du mysticisme, et si celui-ci
a jamais fait autre chose que repasser sur la lettre du dogme pour le tracer
cette fois en caractres de feu. Le rle des mystiques serait alors seulement
d'apporter la religion, pour la rchauffer, quelque chose de l'ardeur qui les
anime. Et, certes, celui qui professe une telle opinion n'aura pas de peine la
faire accepter. Les enseignements de la religion s'adressent en effet, comme
tout enseignement, l'intelligence, et ce qui est d'ordre intellectuel peut
devenir accessible tous. Qu'on adhre ou non la religion, on arrivera
toujours a se l'assimiler intellectuellement, quitte se reprsenter comme
mystrieux ses mystres. Au contraire le mysticisme ne dit rien, absolument
rien, celui qui n'en a pas prouv quelque chose. Tout le monde pourra donc
comprendre que le mysticisme vienne de loin en loin s'insrer, original et
ineffable, dans une religion prexistante formule en termes d'intelligence,
tandis qu'il sera difficile de faire admettre l'ide d'une religion qui n'existerait
que par le mysticisme, dont elle serait un extrait intellectuellement formulable
et par consquent gnralisable. Nous n'avons pas rechercher quelle est celle
de ces interprtations qui est conforme l'orthodoxie religieuse. Disons
seulement que, du point de vue du psychologue, la seconde est beaucoup plus
vraisemblable que la premire. D'une doctrine qui n'est que doctrine sortira
difficilement l'enthousiasme ardent, l'illumination, la foi qui soulve les
montagnes. Mais posez cette incandescence, la matire en bullition se
coulera sans peine dans le moule d'une doctrine, ou deviendra mme cette
doctrine en se solidifiant. Nous nous reprsentons donc la religion comme la
cristallisation, opre par un refroidissement savant, de ce que le mysticisme
vint dposer, brlant, dans l'me de l'humanit. Par elle, tous peuvent obtenir
un peu de ce que possdrent pleinement quelques privilgis. Il est vrai
qu'elle a d accepter beaucoup de choses, pour se faire accepter elle-mme.
L'humanit ne comprend bien le nouveau que s'il prend la suite de l'ancien. Or
l'ancien tait d'une part ce que les philosophes grecs avaient construit, et
d'autre part ce que les religions antiques avaient imagin. Que le christianisme
ait beaucoup reu, ou plutt beaucoup tir, des uns et des autres, cela n'est pas
douteux. Il est charg de philosophie grecque, et il a conserv bien des rites,
des crmonies, des croyances mme de la religion que nous appelions
statique ou naturelle. C'tait son intrt, car son adoption partielle du noplatonisme aristotlicien lui permettait de rallier lui la pense philosophique,
et ses emprunts aux anciennes religions devaient aider une religion nouvelle,
de direction oppose, n'ayant gure de commun avec celles d'autrefois que le
nom, devenir populaire. Mais rien de tout cela n'tait essentiel : l'essence de
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
128
la nouvelle religion devait tre la diffusion du mysticisme. Il y a une
vulgarisation noble, qui respecte les contours de la vrit scientifique, et qui
permet des esprits simplement cultivs de se la reprsenter en gros jusqu'au
jour o un effort suprieur leur en dcouvrira le dtail et surtout leur en fera
pntrer profondment la signification. Du mme genre nous parat tre la
propagation de la mysticit par la religion. En ce sens, la religion est au
mysticisme ce que la vulgarisation est la science.
Ce que le mystique trouve devant lui est donc une humanit qui a t
prpare l'entendre par d'autres mystiques, invisibles et prsents dans la
religion qui s'enseigne. De cette religion son mysticisme mme est d'ailleurs
imprgn, puisqu'il a commenc par elle. Sa thologie sera gnralement
conforme celle des thologiens. Son intelligence et son imagination utiliseront, pour exprimer en mots ce qu'il prouve et en images matrielles ce qu'il
voit spirituellement, l'enseignement (les thologiens. Et cela lui sera facile,
puisque la thologie a prcisment capt un courant qui a sa source dans la
mysticit. Ainsi, son mysticisme bnficie de la religion, en attendant que la
religion s'enrichisse de son mysticisme. Par l s'explique le rle qu'il se sent
appel jouer d'abord, celui d'un intensificateur de la foi religieuse. Il va au
plus press. En ralit, il s'agit pour les grands mystiques de transformer radicalement l'humanit en commenant par donner l'exemple. Le but ne serait
atteint que s'il y avait finalement ce qui aurait d thoriquement exister
l'origine, une humanit divine.
Mysticisme et christianisme se conditionnent donc l'un l'autre, indfiniment. Il faut pourtant bien qu'il y ait eu un commencement. Par le fait,
l'origine du christianisme il y a le Christ. Du point de vue o nous nous
plaons, et d'o apparat la divinit de tous les hommes, il importe peu que le
Christ s'appelle ou ne s'appelle pas un homme. Il n'importe mme pas qu'il
s'appelle le Christ. Ceux qui sont alls jusqu' nier l'existence de Jsus
n'empcheront pas le Sermon sur la montagne de figurer dans l'vangile, avec
d'autres divines paroles. A l'auteur on donnera le nom qu'on voudra, on ne
fera pas qu'il n'y ait pas eu d'auteur. Nous n'avons donc pas nous poser ici de
tels problmes. Disons simplement que, si les grands mystiques sont bien tels
que nous les avons dcrits, ils se trouvent tre des imitateurs et des continuateurs originaux, mais incomplets, de ce que fut compltement le Christ des
vangiles.
Lui-mme peut tre considr comme le continuateur des prophtes
d'Isral. Il n'est pas douteux que le christianisme ait t une transformation
profonde du judasme. On l'a dit bien des fois : une religion qui tait encore
essentiellement nationale se substitua une religion capable de devenir universelle. un Dieu qui tranchait sans doute sur tous les autres par sa justice en
mme temps que par sa puissance, mais dont la puissance s'exerait en faveur
de son peuple et dont la justice concernait avant tout ses sujets, succda un
Dieu d'amour, et qui aimait l'humanit entire. C'est prcisment pourquoi
nous hsitons classer les prophtes juifs parmi les mystiques de l'antiquit :
Jahveh tait un juge trop svre, entre Isral et son Dieu il n'y avait pas assez
d'intimit, pour que le judasme ft le mysticisme que nous dfinissons. Et
pourtant aucun courant de pense ou de sentiment n'a contri.bu autant que le
prophtisme juif susciter le mysticisme que nous appelons complet, celui
des mystiques chrtiens. La raison en est que si d'autres courants portrent
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
129
certaines mes un mysticisme contemplatif et mritrent par l d'tre tenus
pour mystiques, c'est la contemplation pure qu'ils aboutirent. Pour franchir
l'intervalle entre la pense et l'action il fallait un lan, qui manqua. Nous
trouvons cet lan chez les prophtes : ils eurent la passion de la justice, ils la
rclamrent au nom du Dieu d'Isral ; et le christianisme, qui prit la suite du
judasme, dut en grande partie aux prophtes juifs d'avoir un mysticisme
agissant, capable de marcher la conqute du monde.
Si le mysticisme est bien ce que nous venons de dire, il doit fournir le
moyen d'aborder en quelque sorte exprimentalement le problme de l'existence et de la nature de Dieu. Nous ne voyons pas, d'ailleurs, comment la
philosophie l'aborderait autrement. D'une manire gnrale, nous estimons
qu'un objet qui existe est un objet qui est peru ou qui pourrait l'tre. Il est
donc donn dans une exprience, relle ou possible. Libre vous de construire l'ide d'un objet ou d'un tre, comme fait le gomtre pour une figure
gomtrique ; mais l'exprience seule tablira qu'il existe effectivement en
dehors de l'ide ainsi construite. Direz-vous que toute la question est l, et
qu'il s'agit prcisment de savoir si un certain tre ne se distinguerait pas de
tous les autres en ce qu'il serait inaccessible notre exprience et pourtant
aussi rel qu'eux ? Je l'admets un instant, encore qu'une affirmation de ce
genre, et les raisonnements qu'on y joint, me paraissent impliquer une illusion
fondamentale. Mais il restera tablir que l'tre ainsi dfini, ainsi dmontr,
est bien Dieu. Allguerez-vous qu'il l'est par dfinition, et qu'on est libre de
donner aux mots qu'on dfinit le sens qu'on veut ? Je l'admets encore, mais si
vous attribuez au mot un sens radicalement diffrent de celui qu'il a d'ordinaire, c'est un objet nouveau qu'il s'applique ; vos raisonnements ne
concerneront plus l'ancien objet ; il sera donc entendu que vous nous parlez
d'autre chose. Tel est prcisment le cas, en gnral, quand la philosophie
parle de Dieu. Il s'agit si peu du Dieu auquel pensent la plupart des hommes
que si, Par miracle, et contre l'avis des philosophes, Dieu ainsi dfini
descendait dans le champ de l'exprience, personne ne le reconnatrait. Statique ou dynamique, en effet, la religion le tient avant tout pour un tre qui
peut entrer en rapport avec nous : or c'est prcisment de quoi est incapable le
Dieu d'Aristote, adopt avec quelques modifications par la plupart de ses
successeurs. Sans entrer ici dans un examen approfondi de la conception
aristotlicienne de la divinit, disons simplement qu'elle nous parat soulever
une double question : 1 pourquoi Aristote a-t-il pos comme premier principe
un Moteur immobile, Pense qui se pense elle-mme, enferme en elle-mme,
et qui n'agit que par l'attrait de sa perfection ; 2 pourquoi, ayant pos ce
principe, l'a-t-il appel Dieu ? Mais l'une et l'autre la rponse est facile : la
thorie platonicienne des Ides a domin toute la pense antique, en attendant
qu'elle pntrt dans la philosophie moderne ; or, le rapport du premier
principe d'Aristote au monde est celui mme que Platon tablit entre l'Ide et
la chose. Pour qui ne voit dans les ides que des produits de l'intelligence
sociale et individuelle, il n'y a rien d'tonnant ce que des ides en nombre
dtermin, immuables, correspondent aux choses indfiniment varies et
changeantes de notre exprience : nous nous arrangeons en effet pour trouver
des ressemblances entre les choses malgr leur diversit, et pour prendre sur
elles des vues stables malgr leur instabilit ; nous obtenons ainsi des ides
sur lesquelles nous avons prise tandis que les choses nous glissent entre les
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
130
mains. Tout cela est de fabrication humaine. Mais celui qui vient philosopher
quand la socit a dj pouss fort loin son travail, et qui en trouve les
rsultats emmagasines dans le langage, peut tre frapp d'admiration pour ce
systme d'ides sur lesquelles les choses semblent se rgler. Ne seraient-elles
pas, dans leur immutabilit, des modles que les choses changeantes et mouvantes se bornent imiter ? Ne seraient-elles pas la ralit vraie, et changement et mouvement ne traduiraient-ils pas l'incessante et inutile tentative de
choses quasi inexistantes, courant en quelque sorte aprs elles-mmes, pour
concider avec l'immutabilit de l'Ide ? On comprend donc qu'ayant mis audessus du monde sensible une hirarchie d'Ides domines par cette Ide des
Ides qu'est l'Ide du Bien, Platon ait jug que les Ides en gnral, et plus
forte raison le Bien, agissaient par l'attrait de leur perfection. Tel est
prcisment, d'aprs Aristote, le mode d'action de la Pense de la Pense,
laquelle n'est pas sans rapport avec l'Ide des Ides. Il est vrai que Platon
n'identifiait pas celle-ci avec Dieu : le Dmiurge du Time, qui organise le
monde, est distinct de l'Ide du Bien. Mais le Time est un dialogue mythique ; le Dmiurge n'a donc qu'une demi-existence ; et Aristote, qui renonce
aux mythes, fait concider avec la divinit une Pense qui est peine, semblet-il, un tre pensant, que nous appellerions plutt Ide que Pense. Par l, le
Dieu d'Aristote n'a rien de commun avec ceux qu'adoraient les Grecs ; il ne
ressemble gure davantage au Dieu de la Bible, de l'vangile. Statique ou
dynamique, la religion prsente la philosophie un Dieu qui soulve de tout
autres problmes. Pourtant c'est celui-l que la mtaphysique s'est attache
gnralement, quitte le parer de tel ou tel attribut incompatible avec son
essence. Que ne l'a-t-elle pris son origine ! Elle l'et vu se former par la
compression de toutes les ides en une seule. Que n'a-t-elle considr ces
ides leur tour ! Elle et vu qu'elles servent avant tout prparer l'action de
l'individu et de la socit sur les choses, que la socit les fournit pour cela
l'individu, et qu'riger leur quintessence en divinit consiste tout simplement
diviniser le social. Que n'a-t-elle analys, enfin, les conditions sociales de
cette action individuelle, et la nature du travail que l'individu accomplit avec
l'aide de la socit ! Elle et constat que si, pour simplifier le travail et aussi
pour faciliter la coopration, on commence par rduire les choses un petit
nombre de catgories ou d'ides traduisibles en mots, chacune de ces ides
reprsente une proprit ou un tat stable cueilli le long d'un devenir : le rel
est mouvant, ou plutt mouvement, et nous ne percevons que des continuits
de changement; mais pour agir sur le rel, et en particulier pour mener bien
le travail de fabrication qui est l'objet propre de l'intelligence humaine, nous
devons fixer par la pense des stations, de mme que nous attendons quelques
instants de ralentissement ou d'arrt relatif pour tirer sur un but mobile. Mais
ces repos, qui ne sont que des accidents du mouvement et qui se rduisent
d'ailleurs de pures apparences, ces qualits qui ne sont que des instantans
pris sur le changement, deviennent nos yeux le rel et l'essentiel, justement
parce qu'ils sont ce qui intresse notre action sur les choses. Le repos devient
ainsi pour nous antrieur et suprieur au mouvement, lequel ne serait qu'une
agitation en vue de l'atteindre. L'immutabilit serait ainsi au-dessus de la
mutabilit, laquelle ne serait qu'une dficience, un manque, une recherche de
la forme dfinitive. Bien plus, c'est par cet cart entre le point o la chose est
et celui o elle devrait, o elle voudrait tre, que se dfinira et mme se
mesurera le mouvement et le changement. La dure devient par l une dgradation de l'tre, le temps une privation d'ternit. C'est toute cette mtaphysique qui est implique dans la conception aristotlicienne de la divinit.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
131
Elle consiste diviniser et le travail social qui est prparatoire du langage, et
le travail individuel de fabrication qui exige des patrons ou des modles :
leidos (Ide ou Forme) est ce qui correspond ce double travail ; l'Ide des
Ides ou Pense de la Pense se trouve donc tre la divinit mme. Quand on
a ainsi reconstitu l'origine et la signification du Dieu d'Aristote, on se
demande comment les modernes traitent de l'existence et de la nature de Dieu
en s'embarrassant de problmes insolubles qui ne se posent que si l'on
envisage Dieu du point de vue aristotlique et si l'on consent appeler de ce
nom un tre que les hommes n'ont jamais song invoquer.
Ces problmes, est-ce l'exprience mystique qui les rsout ? On voit bien
les objections qu'elle soulve. Nous avons cart celles qui consistent faire
de tout mystique un dsquilibr, de tout mysticisme un tat pathologique.
Les grands mystiques, qui sont les seuls dont nous nous occupions, ont
gnralement t des hommes ou des femmes d'action, d'un bon sens suprieur : peu importe qu'ils aient eu pour imitateurs des dsquilibrs, ou que tel
d'entre eux se soit ressenti, certains moments, d'une tension extrme et
prolonge de l'intelligence et de la volont ; beaucoup d'hommes de gnie ont
t dans le mme cas. Mais il y a une autre srie d'objections, dont il est
impossible de ne pas tenir compte. On allgue en effet que l'exprience de ces
grands mystiques est individuelle et exceptionnelle, qu'elle ne peut pas tre
contrle par le commun des hommes, qu'elle n'est pas comparable par
consquent l'exprience scientifique et ne saurait rsoudre des problmes. Il y aurait beaucoup dire sur ce point. D'abord, il s'en faut qu'une exprience
scientifique, ou plus gnralement une observation enregistre par la science,
soit toujours susceptible de rptition ou de contrle. Au temps o l'Afrique
centrale tait terra incognita, la gographie s'en remettait au rcit d'un
explorateur unique si celui-ci offrait des garanties suffisantes d'honntet et de
comptence. Le trac des voyages de Livingstone a longtemps figur sur les
cartes de nos atlas. On rpondra que la vrification tait possible en droit,
sinon en fait, que d'autres voyageurs taient libres d'y aller voir, que d'ailleurs
la carte dresse sur les indications d'un voyageur unique tait provisoire et
attendait que des explorations ultrieures la rendissent dfinitive. Je
l'accorde ; mais le mystique, lui aussi, a fait un voyage que d'autres peuvent
refaire en droit, sinon eu fait ; et ceux qui en sont effectivement capables sont
au moins aussi nombreux que ceux qui auraient l'audace et l'nergie d'un
Stanley allant retrouver Livingstone. Ce n'est pas assez dire. A ct des mes
qui suivraient jusqu'au bout la voie mystique, il en est beaucoup qui
effectueraient tout au moins une partie du trajet : combien y ont fait quelques
pas, soit par un effort de leur volont, soit par une disposition de leur nature !
William James dclarait n'avoir jamais pass par des tats mystiques ; mais il
ajoutait que s'il en entendait parler par un homme qui les connt d'exprience,
quelque chose en lui faisait cho . La plupart d'entre nous sont probablement dans le mme cas. Il ne sert rien de leur opposer les protestations
indignes de ceux qui ne voient dans le mysticisme que charlatanisme ou
folie. Certains, sans aucun doute, sont totalement ferms l'exprience
mystique, incapables d'en rien prouver, d'en rien imaginer. Mais on rencontre
galement des gens pour lesquels la musique n'est qu'un bruit ; et tel d'entre
eux s'exprime avec la mme colre, sur le mme ton de rancune personnelle,
au sujet des musiciens. Personne ne tirera de l un argument contre la
musique. Laissons donc de ct ces ngations, et voyons si l'examen le plus
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
132
superficiel de l'exprience mystique ne crerait pas dj une prsomption en
faveur de sa validit.
Il faut d'abord remarquer l'accord des mystiques entre eux. Le fait est
frappant chez les mystiques chrtiens. Pour atteindre la dification dfinitive,
ils passent par une srie d'tats. Ces tats peuvent varier de mystique
mystique, mais ils se ressemblent beaucoup. En tout cas la route parcourue est
la mme, supposer que les stations la jalonnent diffremment. Et c'est, en
tout cas, le mme point d'aboutissement. Dans les descriptions de l'tat dfinitif on retrouve les mmes expressions, les mmes images, les mmes
comparaisons, alors que les auteurs ne se sont gnralement pas connus les
uns les autres. On rplique qu'ils se sont connus quelquefois, et que d'ailleurs
il y a une tradition mystique, dont tous les mystiques ont pu subir l'influence.
Nous l'accordons, mais il faut remarquer que les grands mystiques se soucient
peu de cette tradition ; chacun d'eux a son originalit, qui n'est pas voulue, qui
n'a pas t dsire, mais laquelle on sent bien qu'il tient essentiellement :
elle signifie qu'il est l'objet d'une faveur exceptionnelle, encore qu'immrite.
Dira-t-on que la communaut de religion suffit expliquer la ressemblance,
que tous les mystiques chrtiens se sont nourris de l'vangile, que tous ont
reu le mme enseignement thologique ? Ce serait oublier que, si les ressemblances entre les visions s'expliquent en effet par la communaut de religion,
ces visions tiennent peu de place dans la vie des grands mystiques ; elles sont
vite dpasses et n'ont leurs yeux qu'une valeur symbolique. Pour ce qui est
de l'enseignement thologique en gnral, ils semblent bien l'accepter avec
une docilit absolue et, en particulier, obir leur confesseur ; mais, comme
on l'a dit finement, ils n'obissent qu' eux-mmes, et un sr instinct les
mne l'homme qui les dirigera prcisment dans la voie o ils veulent
marcher. S'il lui arrivait de s'en carter, nos mystiques n'hsiteraient pas
secouer son autorit et, forts de leurs relations directes avec la divinit, se
prvaloir d'une libert suprieure 1 . Il serait en effet intressant d'tudier ici
de prs les rapports entre dirigeant et dirig. On trouverait que celui des deux
qui a accept avec humilit d'tre dirig est plus d'une fois devenu, avec non
moins d'humilit, le directeur. Mais l n'est pas pour nous le point important.
Nous voulons seulement dire que, si les ressemblances extrieures entre
mystiques chrtiens peuvent tenir une communaut de tradition et d'enseignement, leur accord profond est signe d'une identit d'intuition qui
s'expliquerait le plus simplement par l'existence relle de l'tre avec lequel ils
se croient en communication. Que sera-ce si l'on considre que les autres
mysticismes, anciens ou modernes, vont plus ou moins loin, s'arrtent ici ou
l, mais marquent tous la mme direction ?
Nous reconnaissons pourtant que l'exprience mystique, laisse ellemme, ne peut apporter au philosophe la certitude dfinitive. Elle ne serait
tout fait convaincante que si celui-ci tait arriv par une autre voie, telle que
l'exprience sensible et le raisonnement fond sur elle, a envisager comme
vraisemblable l'existence d'une exprience privilgie, par laquelle l'homme
entrerait en communication avec un principe transcendant. La rencontre, chez
les mystiques, de cette exprience telle qu'on l'attendait, permettrait alors
d'ajouter aux rsultats acquis, tandis que ces rsultats acquis feraient rejaillir
1
M. de Montmorand, Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes, Paris, 1920, p.
17.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
133
sur l'exprience mystique quelque chose de leur propre objectivit. Il n'y a pas
d'autre source de connaissance que l'exprience. Mais, comme la notation
intellectuelle du fait dpasse ncessairement le fait brut, il s'en faut que toutes
les expriences soient galement concluantes et autorisent la mme certitude.
Beaucoup nous conduisent des conclusions simplement probables. Toutefois
les probabilits peuvent s'additionner, et l'addition donner un rsultat qui
quivaille pratiquement la certitude. Nous parlions jadis de ces lignes de
faits dont chacune ne fournit que la direction de la vrit parce qu'elle ne va
pas assez loin : en prolongeant deux d'entre elles jusqu'au point o elles se
coupent, on arrivera pourtant la vrit mme. L'arpenteur mesure la distance
d'un point inaccessible en le visant tour tour de deux points auxquels il a
accs. Nous estimons que cette mthode de recoupement est la seule qui
puisse faire avancer dfinitivement la mtaphysique. Par elle s'tablira une
collaboration entre philosophes ; la mtaphysique, comme la science, progressera par accumulation graduelle de rsultats acquis, au lieu, d'tre un systme
complet, prendre ou laisser, toujours contest, toujours recommencer. Or
il se trouve prcisment que l'approfondissement d'un certain ordre de problmes, tout diffrents du problme religieux, nous a conduit des conclusions
qui rendaient probable l'existence d'une exprience singulire, privilgie,
telle que l'exprience mystique. Et d'autre part l'exprience mystique, tudie
pour elle-mme, nous fournit des indications capables de s'ajouter aux enseignements obtenus dans un tout autre domaine, par une tout autre mthode. Il y
a donc bien ici renforcement et complment rciproques. Commenons par le
premier point.
C'est en suivant d'aussi prs que possible les donnes de la biologie que
nous tions arrivs la conception d'un lan vital et d'une volution cratrice.
Nous le montrions au dbut du prcdent chapitre : cette conception n'avait
rien de commun avec les hypothses sur lesquelles se construisent les mtaphysiques ; c'tait une condensation de faits, un rsum de rsums. Maintenant, d'o venait l'lan, et quel en tait le principe ? S'il se suffisait luimme, qu'tait-il en lui-mme, et quel sens fallait-il donner l'ensemble de
ses manifestations ? A ces questions les faits considrs n'apportaient aucune
rponse ; mais on apercevait bien la direction d'o la rponse pourrait venir.
L'nergie lance travers la matire nous tait apparue en effet comme infraconsciente ou supra-consciente, en tout cas de mme espce que la conscience. Elle avait d contourner bien des obstacles, se rtrcir pour passer, se
partager surtout entre des lignes d'volution divergentes ; finalement, c'est
l'extrmit des deux lignes principales que nous avons trouv les deux modes
de connaissance en lesquels elle s'tait analyse pour se matrialiser, l'instinct
de l'insecte et l'intelligence de l'homme. L'instinct tait intuitif, l'intelligence
rflchissait et raisonnait. Il est vrai que l'intuition avait d se dgrader pour
devenir instinct , elle s'tait hypnotise sur l'intrt de l'espce, et ce qu'elle
avait conserv de conscience avait pris la forme somnambulique. Mais de
mme qu'autour de l'instinct animal subsistait une frange d'intelligence, ainsi
l'intelligence humaine tait aurole d'intuition. Celle-ci, chez l'homme, tait
reste pleinement dsintresse et consciente, mais ce n'tait qu'une lueur, et
qui ne se projetait pas bien loin. C'est d'elle pourtant que viendrait la lumire,
si jamais devait s'clairer l'intrieur de l'lan vital, sa signification, sa destination. Car elle tait tourne vers le dedans ; et si, par une premire intensification, elle nous faisait saisir la continuit de notre vie intrieure, si la
plupart d'entre nous n'allaient pas plus loin, une intensification suprieure la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
134
porterait peut-tre jusqu'aux racines de notre tre et, par l, jusqu'au principe
mme de la vie en gnral. L'me mystique n'avait-elle pas justement ce
privilge ?
Nous arrivions ainsi ce que nous venons d'annoncer comme le second
point. La question tait d'abord de savoir si les mystiques taient ou non de
simples dsquilibrs, si le rcit de leurs expriences tait ou non de pure
fantaisie. Mais la question tait vite rgle, au moins en ce qui concerne les
grands mystiques. Il s'agissait ensuite de savoir si le mysticisme n'tait qu'une
plus grande ardeur de la foi, forme imaginative que peut prendre dans des
mes passionnes la religion traditionnelle, ou si, tout en s'assimilant le plus
qu'il peut de cette religion, tout en lui demandant une confirmation, tout en lui
empruntant son langage, il n'avait pas un contenu original, puis directement
la source mme de la religion, indpendant de ce que la religion doit la tradition, la thologie, aux glises. Dans le premier cas, il resterait ncessairement l'cart de la philosophie, car celle-ci laisse de ct la rvlation qui a
une date, les institutions qui l'ont transmise, la foi qui l'accepte - elle doit s'en
tenir l'exprience et au raisonnement. Mais, dans le second, il suffirait de
prendre le mysticisme l'tat pur, dgag des visions, des allgories, des
formules thologiques par lesquelles il s'exprime, pour en faire un auxiliaire
puissant de la recherche philosophique. De ces deux conceptions des rapports
qu'il entretient avec la religion, c'est la seconde qui nous a paru s'imposer.
Nous devons alors voir dans quelle mesure l'exprience mystique prolonge
celle qui nous a conduit la doctrine de l'lan vital. Tout ce qu'elle fournirait
d'information la philosophie lui serait rendu par celle-ci sous forme de
confirmation.
Remarquons d'abord que les mystiques laissent de ct ce que nous appelions les faux problmes . On dira peut-tre qu'ils ne se posent aucun
problme, vrai ou faux, et l'on aura raison. Il n'en est pas moins certain qu'ils
nous apportent la rponse implicite des questions qui doivent proccuper le
philosophe, et que des difficults devant lesquelles la philosophie a eu tort de
s'arrter sont implicitement penses par eux comme inexistantes. Nous avons
montr jadis qu'une partie de la mtaphysique gravite, consciemment ou non,
autour de la question de savoir pourquoi quelque chose existe : pourquoi la
matire, ou pourquoi des esprits, ou pourquoi Dieu, plutt que rien ? Mais
cette question prsuppose que la ralit remplit un vide, que sous l'tre il y a
le nant, qu'en droit il n'y aurait rien, qu'il faut alors expliquer pourquoi, en
fait, il y a quelque chose. Et cette prsupposition est illusion pure, car l'ide de
nant absolu a tout juste autant de signification que celle d'un carr rond.
L'absence d'une chose tant toujours la prsence d'une autre - que nous prfrons ignorer parce qu'elle n'est pas celle qui nous intresse ou celle que nous
attendions - une suppression n'est jamais qu'une substitution, une opration
deux faces que l'on convient de ne regarder que par un ct : l'ide d'une
abolition de tout est donc destructive d'elle-mme, inconcevable ; c'est une
pseudo-ide, un mirage de reprsentation. Mais, pour des raisons que nous
exposions jadis, l'illusion est naturelle ; elle a sa source dans les profondeurs
de l'entendement. Elle suscite des questions qui sont la principale origine de
l'angoisse mtaphysique. Ces questions, un mystique estimera qu'elles ne se
posent mme pas : illusions d'optique interne dues la structure de l'intelligence humaine, elles s'effacent et disparaissent mesure qu'on s'lve audessus du point de vue humain. Pour des raisons analogues, le mystique ne
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
135
s'inquitera pas davantage des difficults accumules par la philosophie
autour des attributs mtaphysiques de la divinit ; il n'a que faire de dterminations qui sont des ngations et qui ne peuvent s'exprimer que
ngativement ; il croit voir ce que Dieu est, il -n'a aucune vision de ce que
Dieu n'est pas. C'est donc sur la nature de Dieu, immdiatement saisie dans ce
qu'elle a de positif, je veux dire de perceptible aux yeux de l'me, que le
philosophe devra l'interroger.
Cette nature, le philosophe aurait vite fait de la dfinir s'il voulait mettre le
mysticisme en formule. Dieu est amour, et il est objet d'amour : tout l'apport
du mysticisme est l. De ce double amour le mystique n'aura jamais fini de
parler. Sa description est interminable parce que la chose dcrire est
inexprimable. Mais ce qu'elle dit clairement, c'est que l'amour divin -n'est pas
quelque chose de Dieu : c'est Dieu lui-mme. A cette indication s'attachera le
philosophe qui tient Dieu pour une personne et qui ne veut pourtant pas
donner dans un grossier anthropomorphisme. Il pensera par exemple
l'enthousiasme qui peut embraser une me, consumer ce qui s'y trouve et
occuper dsormais toute la place. La personne concide alors avec cette
motion ; jamais pourtant elle ne fut tel point elle-mme - elle est simplifie,
unifie, intensifie. Jamais non plus elle n'a t aussi charge de pense, s'il
est vrai, comme nous le disions, qu'il y ait deux espces d'motion, l'une infraintellectuelle, qui n'est qu'une agitation conscutive une reprsentation,
l'autre supra-intellectuelle, qui prcde l'ide et qui est plus qu'ide, mais qui
s'panouirait en ides si elle voulait, me toute pure, se donner un corps. Quoi
de plus construit, quoi de plus savant qu'une symphonie de Beethoven ? Mais
tout le long de son travail d'arrangement, de rarrangement et de choix, qui se
poursuivait sur le plan intellectuel, le musicien remontait vers un point situ
hors du plan pour y chercher l'acceptation ou le refus, la direction, l'inspiration : en ce point sigeait une indivisible motion que l'intelligence aidait sans
doute s'expliciter en musique, mais qui tait elle-mme plus que musique et
plus qu'intelligence. A l'oppos de l'motion infra-intellectuelle, elle restait
sous la dpendance de la volont. Pour en rfrer elle, l'artiste avait chaque
fois donner un effort, comme lil pour faire reparatre une toile qui rentre
aussitt dans la nuit. Une motion de ce genre ressemble sans doute, quoique
de trs loin, au sublime amour qui est pour le mystique l'essence mme de
Dieu. En tout cas le philosophe devra penser elle quand il pressera de plus
en plus l'intuition mystique pour l'exprimer en termes d'intelligence.
Il peut n'tre pas musicien, mais il est gnralement crivain; et l'analyse
de son propre tat d'me, quand il compose, l'aidera comprendre comment
l'amour o les mystiques voient l'essence mme de la divinit peut tre, en
mme temps qu'une personne, une puissance de cration. Il se tient d'ordinaire, quand il crit, dans la rgion des concepts et des mots. La socit lui
fournit, labores par ses prdcesseurs et emmagasines dans le langage, des
ides qu'il combine d'une manire nouvelle aprs les avoir elles-mmes
remodeles jusqu' un certain point pour les faire entrer dans la combinaison.
Cette mthode donnera un rsultat plus ou moins satisfaisant, mais elle
aboutira toujours un rsultat, et dans un temps restreint. L'uvre produite
pourra d'ailleurs tre originale et forte ; souvent la pense humaine s'en
trouvera enrichie. Mais ce ne sera qu'un accroissement du revenu de l'anne ;
l'intelligence sociale continuera vivre sur le mme fonds, sur les mmes
valeurs. Maintenant, il y a une autre mthode de composition, plus ambi-
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
136
tieuse, moins sure, incapable de dire quand elle aboutira et mme si elle
aboutira. Elle consiste remonter, du plan intellectuel et social, jusqu'en un
point de l'me d'o part une exigence de cration. Cette exigence, l'esprit o
elle sige a pu ne la sentir pleinement qu'une fois dans sa vie, mais elle est
toujours l, motion unique, branlement ou lan reu du fond mme des
choses. Pour lui obir tout fait, il faudrait forger des mots, crer des ides,
mais ce ne serait plus communiquer, ni par consquent crire. L'crivain
tentera pourtant de raliser l'irralisable. Il ira chercher l'motion simple,
forme qui voudrait crer sa matire, et se portera avec elle la rencontre des
ides dj faites, des mots dj existants, enfin des dcoupures sociales du
rel. Tout le long du chemin, il la sentira s'expliciter en signes issus d'elle, je
veux dire en fragments de sa propre matrialisation. Ces lments, dont
chacun est unique en son genre, comment les amener concider avec des
mots qui expriment dj des choses ? Il faudra violenter les mots, forcer les
lments. Encore le succs ne sera-t-il jamais assur ; l'crivain se demande
chaque instant s'il lui sera bien donn d'aller jusqu'au bout ; de chaque russite
partielle il rend grce au hasard, comme un faiseur de calembours pourrait
remercier des mots placs sur sa route de s'tre prts son jeu. Mais s'il
aboutit, c'est d'une pense capable de prendre un aspect nouveau pour chaque
gnration nouvelle, c'est d'un capital indfiniment productif d'intrts et non
plus d'une somme dpenser tout de suite, qu'il aura enrichi l'humanit.
Telles sont les deux mthodes de composition littraire. Elles ont beau ne pas
s'exclure absolument, elles se distinguent radicalement. A la seconde,
l'image qu'elle peut donner d'une cration de la matire par la forme, devra
penser le philosophe, pour se reprsenter comme nergie cratrice l'amour o
le mystique voit l'essence mme de Dieu.
Cet amour a-t-il un objet ? Remarquons qu'une motion d'ordre suprieur
se suffit elle-mme. Telle musique sublime exprime l'amour. Ce n'est pourtant l'amour de personne. Une autre musique sera un autre amour. Il y aura l
deux atmosphres de sentiment distinctes, deux parfums diffrents, et dans les
deux cas l'amour sera qualifi par son essence, non par son objet. Toutefois il
est difficile de concevoir un amour agissant, qui ne s'adresserait rien. Par le
fait, les mystiques sont unanimes tmoigner que Dieu a besoin de nous,
comme nous avons besoin de Dieu. Pourquoi aurait-il besoin de nous, sinon
pour nous aimer ? Telle sera bien la conclusion du philosophe qui s'attache
l'exprience mystique. La Cration lui apparatra comme une entreprise de
Dieu pour crer des crateurs, pour s'adjoindre des tres dignes de son amour.
On hsiterait l'admettre, s'il ne s'agissait que des mdiocres habitants du
coin d'univers qui s'appelle la Terre. Mais, nous le disions jadis, il est
vraisemblable que la vie anime toutes les plantes suspendues toutes les
toiles. Elle y prend sans doute, en raison de la diversit des conditions qui lui
sont faites, les formes les plus varies et les plus loignes de ce que nous
imaginons ; mais elle a partout la mme essence, qui est d'accumuler graduellement de l'nergie potentielle pour la dpenser brusquement en actions libres.
On pourrait encore hsiter l'admettre, si l'on tenait pour accidentelle
l'apparition, parmi les animaux et les plantes qui peuplent la terre, d'un tre
vivant tel que l'homme, capable d'aimer et de se faire aimer. Mais nous avons
montr que cette apparition, si elle n'tait pas prdtermine, ne fut pas non
plus un accident. Bien qu'il y ait eu d'autres lignes d'volution ct de celle
qui conduit l'homme, et malgr ce qu'il y a d'incomplet dans l'homme lui-
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
137
mme, on peut dire, en se tenant trs prs de l'exprience, que c'est l'homme
qui est la raison d'tre de la vie sur notre plante. Enfin il y aurait lieu
d'hsiter encore, si l'on croyait que l'univers est essentiellement matire brute,
et que la vie s'est surajoute la matire. Nous avons montr au contraire que
la matire et la vie, telle que nous la dfinissons, sont donnes ensemble et
solidairement. Dans ces conditions, rien n'empche le philosophe de pousser
jusqu'au bout l'ide, que le mysticisme lui suggre, d'un univers qui ne serait
que l'aspect visible et tangible de l'amour et du besoin d'aimer, avec toutes les
consquences qu'entrane cette motion cratrice, je veux dire avec l'apparition d'tres vivants o cette motion trouve son complment, et d'une infinit
d'autres tres vivants sans lesquels Ceux-ci n'auraient pas pu apparatre, et
enfin d'une immensit de matrialit sans laquelle la vie n'et pas t possible.
Nous dpassons ainsi, sans doute, les conclusions de L' volution cratrice . Nous avions voulu rester aussi prs que possible des faits. Nous ne
disions rien qui ne pt tre confirm un jour par la biologie. En attendant cette
confirmation, nous avions des rsultats que la mthode philosophique, telle
que nous l'entendons, nous autorisait tenir pour vrais. Ici nous ne sommes
plus que dans le domaine du vraisemblable. Mais nous ne saurions trop
rpter que la certitude philosophique comporte des degrs, qu'elle fait appel
l'intuition en mme temps qu'au raisonnement, et que si l'intuition adosse la
science est susceptible d'tre prolonge, ce ne peut tre que par l'intuition
mystique. De fait, les conclusions que nous venons de prsenter compltent
naturellement, quoique non pas ncessairement, celles de nos prcdents
travaux. Une nergie cratrice qui serait amour, et qui voudrait tirer d'elle.
mme des tres dignes d'tre aims, pourrait semer ainsi des mondes dont la
matrialit, en tant qu 'oppose la spiritualit divine, exprimerait simplement
la distinction entre ce qui est cr et ce qui cre, entre les notes juxtaposes de
la symphonie et l'motion indivisible qui les a laisses tomber hors d'elle.
Dans chacun de ces mondes, lan vital et matire brute seraient les deux
aspects complmentaires de la cration, la vie tenant de la matire qu'elle
traverse sa subdivision en tres distincts, et les puissances qu'elle porte en elle
restant confondues ensemble dans la mesure o le permet la spatialit de la
matire qui les manifeste. Cette interpntration n'a pas t possible sur notre
plante ; tout porte croire que la matire qui s'est trouve ici complmentaire
de la vie tait peu faite pour en favoriser l'lan. L'impulsion originelle a donc
donn des progrs volutifs divergents, an lieu de se maintenir indivise
jusqu'au bout. Mme sur la ligne o l'essentiel de cette impulsion a passe, elle
a fini par puiser son effet, ou plutt le mouvement s'est converti, rectiligne,
en mouvement circulaire. L'humanit, qui est au bout de cette ligne, tourne
dans ce cercle. Telle tait notre conclusion. Pour la prolonger autrement que
par des suppositions arbitraires, nous n'aurions qu' suivre l'indication du
mystique. Le courant vital qui traverse la matire, et qui en est sans doute la
raison d'tre, nous le prenions simplement pour donn. De l'humanit, qui est
au bout de la direction principale, nous ne nous demandions pas si elle avait
une autre raison d'tre qu'elle-mme. Cette double question, l'intuition
mystique la pose en y rpondant. Des tres ont t appels l'existence qui
taient destins aimer et tre aims, l'nergie cratrice devant se dfinir par
l'amour. Distincts de Dieu, qui est cette nergie mme, ils ne pouvaient surgir
que dans un univers, et c'est pourquoi l'univers a surgi. Dans la portion
d'univers qu'est notre plante, probablement dans notre systme plantaire
tout entier, de tels tres, pour se produire, ont d constituer une espce, et
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
138
cette espce en ncessita une foule d'autres, qui en furent la prparation, le
soutien, ou le dchet : ailleurs il n'y a peut-tre que des individus radicalement
distincts, supposer qu'ils soient encore multiples, encore mortels ; peut-tre
aussi ont-ils t raliss alors d'un seul coup, et pleinement. Sur la terre, en
tout cas, l'espce qui est la raison d'tre de toutes les autres n'est que partiellement elle-mme. Elle ne penserait mme pas le devenir tout fait si
certains de ses reprsentants n'avaient russi, par un effort individuel qui s'est
surajout au travail gnral de la vie, briser la rsistance qu'opposait l'instrument, triompher de la matrialit, enfin retrouver Dieu. Ces hommes sont
les mystiques. Ils ont ouvert une voie o d'autres hommes pourront marcher.
Ils ont, par l mme, indiqu au philosophe d'o venait et o allait la vie.
On ne se lasse pas de rpter que l'homme est bien peu de chose sur la
terre, et la terre dans l'univers. Pourtant, mme par son corps, l'homme est loin
de n'occuper que la place minime qu'on lui octroie d'ordinaire, et dont se
contentait Pascal lui-mme quand il rduisait le roseau pensant n'tre,
matriellement, qu'un roseau. Car si notre corps est la matire laquelle notre
conscience s'applique, il est coextensif notre conscience, il comprend tout ce
que nous percevons, il va jusqu'aux toiles. Mais ce corps immense change
tout instant, et parfois radicalement, pour le plus lger dplacement d'une
partie de lui-mme qui en occupe le centre et qui tient dans un espace minime.
Ce corps intrieur et central, relativement invariable, est toujours prsent. Il
n'est pas seulement prsent, il est agissant : c'est par lui, et par lui seulement,
que nous pouvons mouvoir d'autres parties du grand corps. Et comme l'action
est ce qui compte, comme il est entendu que nous sommes l o nous
agissons, on a coutume d'enfermer la conscience dans le corps minime, de
ngliger le corps immense. On y parat d'ailleurs autoris par la science, laquelle tient la perception extrieure pour un piphnomne des processus
intra-crbraux qui y correspondent : tout ce qui est peru du plus grand corps
ne serait donc qu'un fantme projet au dehors par le plus petit. Nous avons
dmasqu l'illusion que cette mtaphysique renferme 1. Si la surface de notre
trs petit corps organis (organis prcisment en vue de l'action immdiate)
est le lieu de nos mouvements actuels, notre trs grand corps inorganique est
le lieu de nos actions ventuelles et thoriquement possibles : les centres
perceptifs du cerveau tant les claireurs et les prparateurs de ces actions
ventuelles et en dessinant intrieurement le plan, tout se passe comme si nos
perceptions extrieures taient construites par notre cerveau et projetes par
lui dans l'espace. Mais la vrit est tout autre, et nous sommes rellement,
quoique par des parties de nous-mmes qui varient sans cesse et o ne sigent
que des actions virtuelles, dans tout ce que nous percevons. Prenons les
choses de ce biais, et nous ne dirons mme plus de notre corps qu'il soit perdu
dans l'immensit de l'univers.
Il est vrai que lorsqu'on parle de la petitesse de l'homme et de la grandeur
de l'univers, c'est la complication de celui-ci qu'on pense au moins autant
qu' sa dimension. Une personne fait l'effet d'tre simple ; le monde matriel
est d'une complexit qui dfie toute imagination : la plus petite parcelle visible de matire est dj elle-mme un monde. Comment admettre que ceci n'ait
d'autre raison d'tre que cela ? Mais ne nous laissons pas intimider. Quand
nous nous trouvons devant des parties dont l'numration se poursuit sans fin,
1
Matire et Mmoire, Paris, 1896. Voir tout le premier chapitre.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
139
ce peut tre que le tout est simple, et que nous le regardons par le mauvais
bout. Portez la main d'un point un autre : c'est pour vous, qui le percevez du
dedans, un geste indivisible. Mais moi, qui l'aperois du dehors, et qui fixe
mon attention sur la ligne parcourue, je me dis qu'il a d'abord fallu franchir la
premire moiti de l'intervalle, puis la moiti de l'autre moiti, puis la moiti
de ce qui reste, et ainsi de suite : je pourrais continuer pendant des milliards
de sicles, jamais je n'aurai puis l'numration des actes en lesquels se
dcompose mes yeux le mouvement que vous sentez indivisible. Ainsi le
geste qui suscite l'espce humaine, ou plus gnralement des objets d'amour
pour le Crateur, pourrait fort bien exiger des conditions qui en exigent
d'autres, lesquelles, de proche en proche, en entranent une infinit. Impossible de penser cette multiplicit sans tre pris de vertige ; mais elle n'est
que l'envers d'un indivisible. Il est vrai que les actes infiniment nombreux en
lesquels nous dcomposons un geste de la main sont purement virtuels,
dtermins ncessairement dans leur virtualit par l'actualit du geste, tandis
que les parties constitutives de l'univers, et les parties de ces parties, sont des
ralits : quand elles sont vivantes, elles ont une spontanit qui peut aller
jusqu' l'activit libre. Aussi ne prtendons-nous pas que le rapport du complexe au simple soit le mme dans les deux cas. Nous avons seulement voulu
montrer par ce rapprochement que la complication, mme sans bornes, n'est
pas signe d'importance, et qu'une existence simple peut exiger des conditions
dont la chane est sans fin.
Telle sera notre conclusion. Attribuant une telle place l'homme et une
telle signification la vie, elle paratra bien optimiste. Tout de suite surgira le
tableau des souffrances qui couvrent le domaine de la vie, depuis le plus bas
degr de la conscience jusqu' l'homme. En vain nous ferions observer que
dans la srie animale cette souffrance est loin d'tre ce que l'on pense : sans
aller jusqu' la thorie cartsienne des btes-machines, on petit prsumer que
la douleur est singulirement rduite chez des tres qui n'ont pas une mmoire
active, qui ne prolongent pas leur pass dans leur prsent et qui ne sont pas
compltement des personnes ; leur conscience est de nature somnambulique ;
ni leurs plaisirs ni leurs douleurs n'ont les rsonances profondes et durables
des ntres : comptons-nous comme des douleurs relles celles que nous avons
prouves en rve ? Chez l'homme lui-mme, la souffrance physique n'est-elle
pas due bien souvent l'imprudence et l'imprvoyance, ou des gots trop
raffins, ou des besoins artificiels ? Quant la souffrance morale, elle est au
moins aussi souvent amene par notre faute, et de toute manire elle ne serait
pas aussi aigu si nous n'avions surexcit notre sensibilit au point de la
rendre morbide ; notre douleur est indfiniment prolonge et multiplie par la
rflexion que nous faisons sur elle. Bref, il serait ais d'ajouter quelques
paragraphes la Thodice de Leibniz. Mais nous n'en avons aucune envie.
Le philosophe peut se plaire des spculations de ce genre dans la solitude de
son cabinet : qu'en pensera-t-il, devant une mre qui vient de voir mourir son
enfant ? Non, la souffrance est une terrible ralit, et c'est un optimisme
insoutenable que celui qui dfinit a priori le mal, mme rduit ce qu'il est
effectivement, comme un moindre bien. Mais il y a un optimisme empirique,
qui consiste simplement constater deux faits : d'abord, que l'humanit juge
la vie bonne dans son ensemble, puisqu'elle y tient ; ensuite qu'il existe une
joie sans mlange, situe par del le plaisir et la peine, qui est l'tat d'me
dfinitif du mystique. Dans ce double sens, et de ce double point de vue,
l'optimisme s'impose, sans que le philosophe ait plaider la cause de Dieu.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
140
Dira-t-on que si la vie est bonne dans son ensemble, elle et nanmoins t
meilleure sans la souffrance, et que la souffrance n'a pas pu tre voulue par un
Dieu d'amour ? Mais rien De prouve que la souffrance ait t voulue. Nous
exposions que ce qui apparat d'un ct comme une immense multiplicit de
choses, au nombre desquelles est en effet la souffrance, peut se prsenter
d'autre part comme un acte indivisible ; de sorte qu'liminer une partie serait
supprimer le tout. On allguera que le tout et pu tre diffrent, et tel que la
douleur n'en et pas fait partie ; que par consquent la vie, mme si elle est
bonne, et pu tre meilleure. D'o l'on conclura que s'il y a rellement un
principe, et si ce principe est amour, il ne peut pas tout, il n'est donc pas Dieu.
Mais l est prcisment la question. Que signifie au juste la toute-puissance
? Nous montrions que l'ide de rien est quelque chose comme l'ide d'un
carr rond, qu'elle s'vanouit l'analyse pour ne laisser derrire elle qu'un
mot, enfin que c'est une pseudo-ide. N'en serait-il pas de mme de l'ide de
tout , si l'on prtend dsigner par ce mot non seulement l'ensemble du rel,
mais encore l'ensemble du possible ? Je me reprsente quelque chose, la
rigueur, quand on me parle de la totalit de l'existant, mais dans la totalit de
l'inexistant je ne vois qu'un assemblage de mots. C'est donc encore d'une
pseudo-ide, d'une entit verbale qu'on tire ici une objection. Mais on peut
aller plus loin : l'objection se rattache toute une srie d'arguments qui
impliquent un vice radical de mthode. On construit a priori une certaine
reprsentation, on convient de dire que c'est l'ide de Dieu; on en dduit alors
les caractres que le monde devrait prsenter , et si le monde ne les prsente
pas, on en conclut que Dieu est inexistant. Comment ne pas voir que, si la
philosophie est oeuvre d'exprience et de raisonnement, elle doit suivre la
mthode inverse, interroger l'exprience sur ce qu'elle peut nous apprendre
d'un tre transcendant la ralit sensible comme la conscience humaine, et
dterminer alors la nature de Dieu en raisonnant sur ce que l'exprience lui
aura dit ? La nature de Dieu apparatra ainsi dans les raisons mmes qu'on
aura de croire son existence : on renoncera dduire son existence ou sa
non-existence d'une conception arbitraire de sa nature. Qu'on se mette
d'accord sur ce point, et l'on pourra sans inconvnient parler de la toutepuissance divine. Nous trouvons des expressions de ce genre chez les mystiques, auxquels nous nous adressons prcisment pour l'exprience du divin. Il
est vident qu'ils entendent par l une nergie sans bornes assignables, une
puissance de crer et d'aimer qui passe toute imagination. Ils n'voquent
certainement pas un concept clos, encore moins une dfinition de Dieu qui
permettrait de conclure ce qu'est ou devrait tre le monde.
La mme mthode s'applique tous les problmes de l'au-del. On peut,
avec Platon, poser a priori une dfinition de l'me qui la fait indcomposable
parce qu'elle est simple, incorruptible parce qu'elle est indivisible, immortelle
en vertu de son essence. De l on passera, par voie de dduction, l'ide d'une
chute des mes dans le Temps, puis celle d'une rentre dans l' ternit. Que
rpondre celui qui contestera l'existence de l'me ainsi dfinie ? Et comment
les problmes relatifs une me relle, son origine relle, sa destine
relle, pourraient-ils tre rsolus selon la ralit, ou mme poss en termes de
ralit, alors qu'on a simplement spcul sur une conception peut-tre vide de
l'esprit ou, en mettant les choses au mieux, prcis conventionnellement le
sens du mot que la socit a inscrit sur une dcoupure du rel pratique pour
la commodit de la conversation ? Aussi l'affirmation reste-t-elle strile,
autant que la dfinition tait arbitraire. La conception platonicienne n'a pas
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
141
fait avancer d'un pas notre connaissance de l'me, malgr deux mille ans de
mditation sur elle. Elle tait dfinitive comme celle du triangle, et pour les
mmes raisons. Comment pourtant ne pas voir que s'il y a effectivement un
problme de l'me, c'est en termes d'exprience qu'il devra tre pos, en
termes d'exprience qu'il sera progressivement, et toujours partiellement,
rsolu ? Nous ne reviendrons pas sur un sujet que nous avons trait ailleurs.
Rappelons seulement que l'observation, par les sens et par la conscience, des
faits normaux et des tats morbides nous rvle l'insuffisance des explications
physiologiques de la mmoire, l'impossibilit d'attribuer la conservation des
souvenirs au cerveau, et d'autre part la possibilit de suivre la trace les
dilatations successives de la mmoire, depuis le point o elle se resserre pour
ne livrer que ce qui est strictement ncessaire l'action prsente, jusqu'au plan
extrme o elle tale tout entier l'indestructible pass : nous disions mtaphoriquement que nous allions ainsi du sommet la base du cne. Par sa
pointe seulement le cne s'insre dans la matire ; ds que nous quittons la
pointe, nous entrons dans un nouveau domaine. Quel est-il ? Disons que c'est
l'esprit, parlons encore, si vous voulez, d'une me, mais en rformant alors
l'opration du langage, en mettant sous le mot un ensemble d'expriences et
non pas une dfinition arbitraire. De cet approfondissement exprimental nous
conclurons la possibilit et mme la probabilit d'une survivance de l'me,
puisque nous aurons observ et comme touch du doigt, ds ici-bas, quelque
chose de son indpendance par rapport au corps. Ce ne sera qu'un des aspects
de cette indpendance ; nous serons bien incompltement renseigns sur les
conditions de la survie, et en particulier sur sa dure : est-ce pour un temps,
est-ce pour toujours ? Mais nous aurons du moins trouv un point sur lequel
l'exprience a prise, et une affirmation indiscutable deviendra possible, comme aussi un progrs ventuel de notre connaissance. Voil pour ce que nous
appellerions l'exprience d'en bas. Transportons-nous alors en haut ; nous
aurons une exprience d'un autre genre, l'intuition mystique. Ce serait une
participation de l'essence divine. Maintenant, ces deux expriences se
rejoignent-elles ? La survie qui semble assure toutes les mes par le fait
que, ds ici-bas, une bonne partie de leur activit est indpendante du corps,
se confond-elle avec celle o viennent, ds ici-bas, s'insrer des mes privilgies ? Seuls, une prolongation et un approfondissement des deux expriences
nous l'apprendront : le problme doit rester ouvert. Mais c'est quelque chose
que d'avoir obtenu, sur des points essentiels, un rsultat d'une probabilit
capable de se transformer en certitude, et pour le reste, pour la connaissance
de l'me et de sa destine, la possibilit d'un progrs sans fin. Il est vrai que
cette solution ne satisfera d'abord ni l'une ni l'autre des deux coles qui se
livrent un combat autour de la dfinition a priori de l'me, affirmant ou niant
catgoriquement. Ceux qui nient, parce qu'ils refusent d'riger en ralit une
construction peut-tre vide de l'esprit, persisteront dans leur ngation en
prsence mme de l'exprience qu'on leur apporte, croyant qu'il s'agit encore
de la mme chose. Ceux qui affirment n'auront que du ddain pour des ides
qui se dclarent elles-mmes provisoires et perfectibles ; ils n'y verront que
leur propre thse, diminue et appauvrie. Ils mettront du temps comprendre
que leur thse avait t extraite telle quelle du langage courant. La socit suit
sans doute certaines suggestions de l'exprience intrieure quand elle parle de
l'me ; mais elle a forg ce mot, comme tous les autres, pour sa seule
commodit. Elle a dsign par l quelque chose qui tranche sur le corps. Plus
la distinction sera radicale, mieux le mot rpondra sa destination : or elle ne
saurait tre plus radicale que si l'on fait des proprits de l'me, purement et
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
142
simplement, des ngations de celles de la matire. Telle est l'ide que le
philosophe a trop souvent reue toute faite de la socit par l'intermdiaire du
langage. Elle parat reprsenter la spiritualit la plus complte, justement
parce qu'elle va jusqu'au bout de quelque chose. Mais ce quelque chose n'est
que de la ngation. On ne tire rien du vide, et la connaissance d'une telle me
est naturellement incapable de progrs ; - sans compter que l'ide sonne creux
ds qu'une philosophie antagoniste frappe sur elle. Combien ne vaudrait-il pas
mieux se reporter aux vagues suggestions de la conscience d'o l'on tait parti,
les approfondir, les conduire jusqu' l'intuition claire ! Telle est la mthode
que nous prconisons. Encore une fois, elle ne plaira ni aux uns ni aux autres.
On risque, l'appliquer, d'tre pris entre l'arbre et l'corce. Mais peu importe.
L'corce sautera, si le vieil arbre se gonfle sous une nouvelle pousse de sve.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
143
Chapitre IV
Remarques finales
Mcanique et mystique
Retour la table des matires
Un des rsultats de notre analyse a t de distinguer profondment, dans le
domaine social, le clos de l'ouvert. La socit close est celle dont les membres
se tiennent entre eux, indiffrents au reste des hommes, toujours prts
attaquer ou se dfendre, astreints enfin une attitude de combat. Telle est la
socit humaine quand elle sort des mains de la nature. L'homme tait fait
pour elle, comme la fourmi pour la fourmilire. Il ne faudrait pas forcer
l'analogie ; nous devons pourtant remarquer que les communauts d'hymnoptres sont au bout de l'une des deux principales lignes de l'volution animale,
comme les socits humaines l'extrmit de l'autre, et qu'en ce sens elles se
font pendant. Sans doute les premires ont une forme strotype, tandis que
les autres varient ; celles-l obissent l'instinct, celles-ci l'intelligence.
Mais si la nature, prcisment parce qu'elle nous a faits intelligents, nous a
laisss libres de choisir jusqu' un certain point notre type d'organisation
sociale, encore nous a-t-elle impos de vivre en socit. Une force de direction constante, qui est l'me ce que la pesanteur est au corps, assure la
cohsion du groupe en inclinant dans un mme sens les volonts individuelles. Telle est l'obligation morale. Nous avons montr qu'elle peut s'largir
dans la socit qui s'ouvre, mais qu'elle avait t faite pour une socit close.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
144
Et nous avons montr aussi comment une socit close ne peut vivre, rsister
certaine action dissolvante de l'intelligence, conserver et communiquer
chacun de ses membres la confiance indispensable, que par une religion issue
de la fonction fabulatrice. Cette religion, que nous avons appele statique, et
cette obligation, qui consiste en une pression, sont constitutives de la socit
close.
De la socit close la socit ouverte, de la cit l'humanit, on ne
passera jamais par voie d'largissement. Elles ne sont pas de mme essence.
La socit ouverte est celle qui embrasserait en principe l'humanit entire.
Rve, de loin en loin, par des mes d'lite, elle ralise chaque fois quelque
chose d'elle-mme dans des crations dont chacune, par une transformation
plus ou moins profonde de l'homme, permet de surmonter des difficults
jusque-la insurmontables. Mais aprs chacune aussi se referme le cercle
momentanment ouvert. Une partie du nouveau s'est coule dans le moule de
l'ancien ; l'aspiration individuelle est devenue pression sociale ; l'obligation
couvre le tout. Ces progrs se font-ils dans une mme direction ? Il sera
entendu que la direction est la mme, du moment qu'on est convenu de dire
que ce sont des progrs. Chacun d'eux se dfinira en effet alors un pas en
avant. Mais ce ne sera qu'une mtaphore, et s'il y avait rellement une direction prexistante le long de laquelle on se ft content d'avancer, les
rnovations morales seraient prvisibles ; point ne serait besoin, pour chacune
d'elles, d'un effort crateur. La vrit est qu'on peut toujours prendre la
dernire, la dfinir par un concept, et dire que, les autres contenaient une plus
ou moins grande quantit de ce que son concept renferme, que toutes taient
par consquent un acheminement elle. Mais les choses ne prennent cette
forme que rtrospectivement; les changements taient qualitatifs et non pas
quantitatifs ; ils dfiaient toute prvision. Par un ct cependant ils prsentaient en eux-mmes, et non pas seulement dans leur traduction conceptuelle,
quelque chose de commun. Tous voulaient ouvrir ce qui tait clos ; le groupe,
qui depuis la prcdente ouverture se repliait sur lui-mme, tait ramen
chaque fois l'humanit. Allons plus loin : ces efforts successifs n'taient pas
prcisment la ralisation progressive d'un idal, puisque aucune ide, forge
par anticipation, ne pouvait reprsenter un ensemble d'acquisitions dont chacune, en se crant, crerait son ide elle ; et pourtant la diversit des efforts
se rsumerait bien en quelque chose d'unique : un lan, qui avait donn des
socits closes parce qu'il ne pouvait plus entraner la matire, mais que va
ensuite chercher et reprendre, dfaut de l'espce, telle ou telle individualit
privilgie. Cet lan se continue ainsi par l'intermdiaire de certains hommes,
dont chacun se trouve constituer une espce compose d'un seul individu. Si
l'individu en a pleine conscience, si la frange d'intuition qui entoure son
intelligence s'largit assez pour s'appliquer tout le long de son objet, c'est la
vie mystique. La religion dynamique qui surgit ainsi s'oppose la religion
statique, issue de la fonction fabulatrice, comme la socit ouverte la socit
close. Mais de mme que l'aspiration morale nouvelle ne prend corps qu'en
empruntant la socit close sa forme naturelle, qui est l'obligation, ainsi la
religion dynamique ne se propage que par des images et des symboles que
fournit la fonction fabulatrice. Inutile de revenir sur ces diffrents points.
Nous voulions simplement appuyer sur la distinction que nous avions faite
entre la socit ouverte et la socit close.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
145
Qu'on se concentre sur elle, et l'on verra de gros problmes s'vanouir,
d'autres se poser en termes nouveaux. Quand on fait la critique ou l'apologie
de la religion, tiento-n toujours compte de ce que la religion a de spcifiquement religieux ? On s'attache ou l'on s'attaque des rcits dont elle a
peut-tre besoin pour obtenir un tat d'me qui se propage ; mais la religion
est essentiellement cet tat lui-mme. On discute les dfinitions qu'elle pose et
les thories qu'elle expose ; elle s'est servie en effet d'une mtaphysique pour
se donner un corps ; mais elle aurait pu la rigueur en prendre un autre, et
mme n'en prendre aucun. L'erreur est de croire qu'on passe, par accroissement ou perfectionnement, du statique au dynamique, de la dmonstration ou
de la fabulation, mme vridique, l'intuition. On confond ainsi la chose avec
son expression ou son symbole. Telle est l'erreur ordinaire d'un intellectualisme radical. Nous la retrouvons quand nous passons de la religion la
morale. Il y a une morale statique, qui existe en fait, un moment donn, dans
une socit donne, elle s'est fixe dans les murs, les ides, les institutions ;
son caractre obligatoire se ramne, en dernire analyse, l'exigence, par la
nature, de la vie en commun. Il y a d'autre part une morale dynamique, qui est
lan, et qui se rattache la vie en gnral, cratrice de la nature qui a cr
l'exigence sociale. La premire obligation, en tant que pression, est infrarationnelle. La seconde, en tant qu'aspiration, est supra-rationnelle. Mais
l'intelligence survient. Elle cherche le motif de chacune des prescriptions,
c'est--dire son contenu intellectuel ; et comme elle est systmatique, elle croit
que le problme est de ramener tous les motifs moraux un seul. Elle n'a
d'ailleurs que l'embarras du choix. Intrt gnral, intrt personnel, amourpropre, sympathie, piti, cohrence rationnelle, etc., il n'est aucun principe
d'action dont on ne puisse dduire peu prs la morale gnralement admise.
Il est vrai que la facilit de l'opration, et le caractre simplement approximatif du rsultat qu'elle donne, devraient nous mettre en garde contre elle. Si
des rgles de conduite presque identiques se tirent tant bien que mal de
principes aussi diffrents, c'est probablement qu'aucun des principes n'tait
pris dans ce qu'il avait de spcifique. Le philosophe tait all le cueillir dans
le milieu social, o tout se compntre, o l'gosme et la vanit sont lests de
sociabilit : rien d'tonnant alors ce qu'il retrouve en chacun d'eux la morale
qu'il y a mise ou laisse. Mais la morale elle-mme reste inexplique, puisqu'il
aurait fallu creuser la vie sociale en tant que discipline exige par la nature, et
creuser la nature elle-mme en tant que cre par la vie en gnral. On serait
ainsi arriv la racine mme de la morale, que cherche vainement le pur
intellectualisme : celui-ci ne peut que donner des conseils, allguer des
raisons, que rien ne nous empchera de combattre par d'autres raisons. A vrai
dire, il sous-entend toujours que le motif invoqu par lui est prfrable aux
autres, qu'il y a entre les motifs des diffrences de valeur, qu'il existe un idal
gnral auquel rapporter le rel. Il se mnage donc un refuge dans la thorie
platonicienne, avec une Ide du Bien qui domine toutes les autres : les raisons
d'agir s'chelonneraient au-dessous de l'Ide du Bien, les meilleures tant
celles qui s'en rapprochent le plus ; l'attrait du Bien serait le principe de
l'obligation. Mais on est alors trs embarrass pour dire quel si-ne nous
reconnaissons qu'une conduite est plus ou moins proche du Bien idal : si on
le savait, le signe serait l'essentiel et l'Ide du Bien deviendrait inutile. On
aurait tout autant de peine expliquer comment cet idal cre une obligation
imprieuse, surtout l'obligation la plus stricte de toutes, celle qui s'attache la
coutume dans les socits primitives essentiellement closes. La vrit est
qu'un idal ne peut devenir obligatoire s'il n'est dj agissant ; et ce n'est pas
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
146
alors son ide qui oblige, c'est son action. Ou plutt, il n'est que le mot par
lequel nous dsignons l'effet suppos ultime de cette action, sentie comme
continue, le terme hypothtique du mouvement qui dj nous soulve. Au
fond de toutes les thories nous retrouvons donc les deux illusions que nous
avons maintes fois dnonces. La premire, trs gnrale, consiste se
reprsenter le mouvement comme la diminution graduelle d'un intervalle entre
la position du mobile, (lui est une immobilit, et son terme suppos atteint,
qui est immobilit aussi, alors que les positions ne sont que des vues de
l'esprit sur le mouvement indivisible : d'o l'impossibilit de rtablir la
mobilit vraie, c'est--dire ici les aspirations et les pressions qui constituent
indirectement ou directement l'obligation. La seconde concerne plus
spcialement l'volution de la vie. Parce qu'un processus volutif a t observ partir d'un certain point, on veut que ce point ait t atteint par le mme
processus volutif, alors que l'volution antrieure a pu tre diffrente, alors
qu'il a mme pu ne pas y avoir jusque-l volution. Parce que nous constatons
un enrichissement graduel de la morale, nous -voulons qu'il n'y ait pas de
morale primitive, irrductible, apparue avec l'homme. Il faut pourtant poser
cette morale originelle en mme temps que l'espce humaine, et se donner au
dbut une socit close.
Maintenant, la distinction entre le clos et l'ouvert, ncessaire pour rsoudre
ou supprimer les problmes thoriques, peut-elle nous servir pratiquement ?
Elle serait sans grande utilit, si la socit close s'tait toujours constitue en
se refermant aprs s'tre momentanment ouverte. On aurait beau remonter
alors indfiniment dans le pass, on n'arriverait jamais au primitif ; le naturel
ne serait qu'une consolidation de l'acquis. Mais, nous venons de le dire, la
vrit est tout autre. Il y a une nature fondamentale, et il y a des acquisitions
qui, se superposant la nature, l'imitent sans se confondre avec elle. De
proche en proche, on se transporterait une socit close originelle, dont le
plan gnral adhrait au dessin de notre espce comme la fourmilire la
fourmi, avec cette diffrence toutefois que dans le second cas c'est le dtail de
l'organisation sociale qui est donn par avance, tandis que dans l'autre il y a
seulement les grandes lignes, quelques directions, juste assez de prfiguration
naturelle pour assurer tout de suite aux individus un milieu social appropri.
La connaissance de ce plan n'offrirait sans doute aujourd'hui qu'un intrt
historique si les dispositions en avaient t limines par d'autres. Mais la
nature est indestructible. On a eu tort de dire Chassez le naturel, il revient au
galop , car le naturel ne se laisse pas chasser. Il est toujours l. Nous savons
ce qu'il faut penser de la transmissibilit des caractres acquis. Il est peu
probable qu'une habitude se transmette jamais : si le fait se produit, il tient la
rencontre accidentelle d'un si grand nombre de conditions favorables qu'il ne
se rptera srement pas assez pour implanter l'habitude dans l'espce. C'est
dans les murs, dans les institutions, dans le langage mme que se dposent
les acquisitions morales ; elles se communiquent ensuite par une ducation de
tous les instants ; ainsi passent de gnration en gnration des habitudes
qu'on finit par croire hrditaires. Mais tout conspire encourager l'interprtation fausse : un amour-propre mal plac, un optimisme superficiel, une
mconnaissance de la vraie nature du progrs, enfin et surtout une confusion
trs rpandue entre la tendance inne, qui est transmissible en effet du parent
l'enfant, et l'habitude acquise qui s'est souvent greffe sur la tendance
naturelle. Il n'est pas douteux que cette croyance ait pes sur la science
positive elle-mme, qui l'a accepte du sens commun malgr le nombre
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
147
restreint et le caractre discutable des faits invoqus l'appui, et qui l'a
renvoye alors au sens commun en la renforant de son autorit indiscute.
Rien de plus instructif cet gard que luvre biologique et psychologique de
Herbert Spencer. Elle repose peu prs entirement sur l'ide de la transmission hrditaire des caractres acquis. Et elle a imprgn, au temps de sa
popularit, l'volutionnisme des savants. Or elle n'tait chez Spencer que la
gnralisation d'une thse, prsente dans ses premiers travaux, sur le progrs
social : l'tude des socits l'avait d'abord exclusivement proccup ; il ne
devait venir que plus tard aux phnomnes de la vie. De sorte qu'une sociologie qui s'imagine emprunter la biologie l'ide d'une transmission hrditaire de l'acquis ne fait que reprendre ce qu'elle avait prt. La thse
philosophique indmontre a pris un faux air d'assurance scientifique en
passant par la science, mais elle reste philosophie, et elle est plus loin que
jamais d'tre dmontre. Tenons-nous en donc aux faits que l'on constate et
aux probabilits qu'ils suggrent : nous estimons que si l'on liminait de
l'homme actuel ce qu'a dpos en lui une ducation de tous les instants, on le
trouverait identique, ou peu prs, ses anctres les plus lointains 1.
Quelle conclusion tirer de l ? Puisque les dispositions de l'espce subsistent, immuables, au fond de chacun de nous, il est impossible que le moraliste
et le sociologue n'aient pas en tenir compte. Certes, il n'a t donn qu' un
petit nombre de creuser d'abord sous l'acquis, puis sous la nature, et de se
replacer dans l'lan mme de la vie. Si un tel effort pouvait se gnraliser, ce
n'est pas l'espce humaine, ni par consquent une socit close, que l'lan
se ft arrt comme une impasse. Il n'en est pas moins vrai que ces privilgis voudraient entraner avec eux l'humanit ; ne pouvant communiquer
tous leur tat d'me dans ce qu'il a de profond, ils le transposent superficiellement ; ils cherchent une traduction du dynamique en statique, que la socit
soit mme d'accepter et de rendre dfinitive par l'ducation. Or, ils n'y
russiront que dans la mesure o ils auront pris en considration la nature.
Cette nature, l'humanit dans son ensemble ne saurait la forcer. Mais elle peut
la tourner. Et elle ne la tournera que si elle en connat la configuration. La
tche serait malaise, s'il fallait se lancer pour cela dans l'tude de la psychologie en gnral. Mais il ne s'agit que d'un point particulier : la nature humaine en tant que prdispose une certaine forme sociale. Nous disons qu'il y a
une socit humaine naturelle, vaguement prfigure en nous, que la nature a
pris soin de nous en fournir par avance le schma, toute latitude tant laisse
notre intelligence et notre volont pour suivre l'indication. Ce schma vague
et incomplet correspondrait, dans le domaine de l'activit raisonnable et libre,
ce qu'est le dessin cette fois prcis de la fourmilire ou de la ruche dans le
cas de l'instinct, l'autre point terminus de l'volution. Il y aurait donc
seulement un schma simple retrouver.
1
Nous disons peu prs , parce qu'il faut tenir compte des variations que l'tre vivant
excute, en quelque sorte, sur le thme fourni par ses progniteurs. Mais ces variations,
tant accidentelles et se produisant dans n'importe quel sens, ne peuvent pas s'additionner
dans la suite (les temps pour modifier l'espce. Sur la thse de la transmissibilit des
caractres acquis, et sur un volutionnisme qui se fonderait sur elle, voir L'volution
cratrice (chap. 1er).
Ajoutons, comme nous l'avons dj fait remarquer, que le saut brusque qui a donn
l'espce humaine a pu tre tent sur plus d'un point de l'espace et du temps avec un succs
incomplet, aboutissant ainsi des hommes qu'on peut appeler de ce nom si l'on veut,
mais qui ne sont pas ncessairement nos anctres.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
148
Mais comment le retrouver, puisque l'acquis recouvre le naturel ? Nous
serions embarrass pour rpondre, si nous devions fournir un moyen de
recherche applicable automatiquement. La vrit est qu'il faut procder par
ttonnement et recoupement, suivre la fois plusieurs mthodes diffrentes
dont chacune ne mnerait qu' des possibilits ou des probabilits : interfrant
entre eux, les rsultats se neutraliseront ou se renforceront mutuellement ; il y
aura vrification et correction rciproques. Ainsi, l'on tiendra compte des
primitifs , sans oublier qu'une couche d'acquisitions recouvre aussi chez
eux la nature, encore qu'elle soit peut-tre moins paisse que chez nous. On
observera les enfants, sans oublier que la nature a pourvu aux diffrences
d'ge, et que le naturel enfantin n'est pas ncessairement le naturel humain ;
surtout, l'enfant est imitateur, et ce qui nous parat chez lui spontan est
souvent l'effet d'une ducation que nous lui donnons sans y prendre garde.
Mais la source d'information par excellence sera l'introspection. Nous devrons
aller la recherche de ce fond de sociabilit, et aussi d'insociabilit, qui apparatrait notre conscience si la socit constitue n'avait mis en nous les
habitudes et dispositions qui nous adaptent elle. Nous n'en avons plus la
rvlation que de loin en loin, dans un clair. Il faudra la rappeler et la fixer.
Disons d'abord que l'homme avait t fait pour de trs petites socits. Que
telles aient t les socits primitives, on l'admet gnralement. Mais il faut
ajouter que l'ancien tat d'me subsiste, dissimul sous des habitudes sans
lesquelles il n'y aurait pas de civilisation. Refoul, impuissant, il demeure
pourtant dans les profondeurs de la conscience. S'il ne va pas jusqu' obtenir
des actes, il manifeste par des paroles. Dans une grande nation, des communes
peuvent tre administres la satisfaction gnrale ; mais quel est le
gouvernement que les gouverns se dcideront dclarer bon ? Ils croiront le
louer suffisamment quand ils diront que c'est le moins mauvais de tous, et en
ce sens seulement le meilleur. C'est qu'ici le mcontentement est congnital.
Remarquons que l'art de gouverner un grand peuple est le seul pour lequel il
n'y ait pas de technique prparatoire, pas d'ducation efficace, surtout s'il
s'agit des plus hauts emplois. L'extrme raret des hommes politiques de
quelque envergure tient ce qu'ils doivent rsoudre tout moment, dans le
dtail, un problme que l'extension prise par les socits a peut-tre rendu
insoluble. tudiez l'histoire des grandes nations modernes : vous y trouverez
nombre de grands savants, de grands artistes, de grands soldats, de grands
spcialistes en toute matire, - mais combien de grands hommes dtat ?
La nature, qui a voulu de petites socits, a pourtant ouvert la porte leur
agrandissement. Car elle a voulu aussi la guerre, ou du moins elle a fait
l'homme des conditions de vie qui rendaient la guerre invitable. Or, des
menaces de guerre peuvent dterminer plusieurs petites socits s'unir pour
parer au danger commun. Il est vrai que ces unions sont rarement durables.
Elles aboutissent en tout cas un assemblage de socits qui est du mme
ordre de grandeur que chacune d'elles. C'est plutt dans un autre sens que la
guerre est l'origine des empires. Ils sont ns de la conqute. Mme si la
guerre ne visait pas la conqute d'abord, c'est une conqute qu'elle aboutit,
tant le vainqueur juge commode de s'approprier les terres du vaincu, et mme
les populations, pour tirer profit de leur travail. Ainsi se formrent jadis les
grands empires asiatiques. Tous tombrent en dcomposition, sous des
influences diverses, en ralit parce qu'ils taient trop grands pour vivre.
Quand le vainqueur concde aux populations subjugues une apparence
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
149
d'indpendance, l'assemblage dure plus longtemps : tmoin l'empire romain.
Mais que l'instinct primitif subsiste, qu'il exerce une action disruptive, cela
n'est pas douteux. On n'a qu' le laisser faire, et la construction politique
s'croule. C'est ainsi que la fodalit surgit dans des pays diffrents, la suite
d'vnements diffrents, dans des conditions diffrentes ; il n'y eut de
commun que la suppression de la force qui empchait la socit de se
disloquer ; la dislocation se fit alors d'elle-mme. Si de grandes nations ont pu
se constituer solidement dans les temps modernes, c'est parce que la contrainte, force de cohsion s'exerant du dehors et d'en haut sur l'ensemble, a
cd peu peu la place un principe d'union qui monte du fond de chacune
des socits lmentaires assembles, c'est--dire de la rgion mme des
forces disruptives auxquelles il s'agit d'opposer une rsistance ininterrompue.
Ce principe, seul capable de neutraliser la tendance la dsagrgation, est le
patriotisme. Les anciens l'ont bien connu ; ils adoraient la patrie, et c'est un de
leurs potes qui a dit qu'il tait doux de mourir pour elle. Mais il y a loin de
cet attachement la cit, groupement encore plac sous l'invocation du dieu
qui l'assistera dans les combats, au patriotisme qui est une vertu de paix autant
que de guerre, qui peut se teinter de mysticit mais qui ne mle sa religion
aucun calcul, qui couvre un grand pays et soulve une nation, qui aspire lui
ce qu'il y a de meilleur dans les mes, enfin qui s'est compos lentement,
pieusement, avec des souvenirs et des esprances, avec de la posie et de
l'amour, avec un peu de toutes les beauts morales qui sont sous le ciel,
comme le miel avec les fleurs. Il fallait un sentiment aussi lev, imitateur de
l'tat mystique, pour avoir raison d'un sentiment aussi profond que l'gosme
de la tribu.
Maintenant, quel est le rgime d'une socit qui sort des mains de la
nature ? Il est possible que l'humanit ait commenc en fait par des groupements familiaux, disperss et isols. Mais ce n'taient l que des socits
embryonnaires, et le philosophe ne doit pas plus y chercher les tendances
essentielles de la vie sociale que le naturaliste ne se renseignerait sur les
habitudes d'une espce en ne s'adressant qu' l'embryon. Il faut prendre la
socit au moment o elle est complte, c'est--dire capable de se dfendre, et
par consquent, si petite soit-elle, organise pour la guerre. Quel sera donc, en
ce sens prcis, son rgime naturel ? Si ce n'tait profaner les mots grecs que
de les appliquer une barbarie, nous dirions qu'il est monarchique ou oligarchique, probablement les deux la fois. Ces rgimes se confondent l'tat
rudimentaire : il faut un chef, et il n'y a pas de communaut sans des privilgis qui empruntent au chef quelque chose de son prestige, ou qui le lui
donnent, ou plutt qui le tiennent, avec lui, de quelque puissance surnaturelle.
Le commandement est absolu d'un ct, l'obissance est absolue de l'autre.
Nous avons dit bien des fois que les socits humaines et les socits d'hymnoptres occupaient les extrmits des deux lignes principales de l'volution
biologique. Dieu nous garde de les assimiler entre elles ! l'homme est
intelligent et libre. Mais il faut toujours se rappeler que la vie sociale tait
comprise dans le plan de structure de l'espce humaine comme dans celui de
l'abeille, qu'elle tait ncessaire, que la nature n'a pas pu s'en remettre
exclusivement nos volonts libres, que ds lors elle a d faire en sorte qu'un
seul ou quelques-uns commandent, que les autres obissent. Dans le monde
des insectes, la diversit des fonctions sociales est lie une diffrence
d'organisation ; il y a polymorphisme . Dirons-nous alors que dans les
socits humaines il y a dimorphisme , non plus physique et psychique la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
150
fois comme chez l'insecte, mais psychique seulement ? Nous le croyons, a
condition toutefois qu'il soit entendu que ce dimorphisme ne spare pas les
hommes en deux catgories irrductibles, les uns naissant chefs et les autres
sujets. L'erreur de Nietzsche fut de croire une sparation de ce genre : d'un
ct les esclaves , de l'autre les matres . La vrit est que le dimorphisme fait le plus souvent de chacun de nous, en mme temps, un chef qui a
l'instinct de commander et un sujet qui est prt obir, encore que la seconde
tendance l'emporte au point d'tre seule apparente chez la plupart des
hommes. Il est comparable celui des insectes en ce qu'il implique deux
organisations, deux systmes indivisibles de qualits (dont certaines seraient
des dfauts aux yeux du moraliste) : nous optons pour l'un ou pour l'autre
systme, non pas en dtail, comme il arriverait s'il s'agissait de contracter des
habitudes, mais d'un seul coup, de faon kalidoscopique, ainsi qu'il doit
rsulter d'un dimorphisme naturel, tout fait comparable celui de l'embryon
qui a le choix entre les deux sexes. C'est de quoi nous avons la vision nette en
temps de rvolution. Des citoyens modestes, humbles et obissants
jusqu'alors, se rveillent un matin avec la prtention d'tre des conducteurs
d'hommes. Le kalidoscope, qui avait t maintenu fixe, a tourn d'un cran, et
il y a eu mtamorphose. Le rsultat est quelquefois bon : de grands hommes
d'action se sont rvls, qui eux-mmes ne se connaissaient pas. Mais il est
gnralement fcheux. Chez des tres honntes et doux surgit tout coup une
personnalit d'en bas, froce, qui est celle d'un chef manqu. Et ici apparat un
trait caractristique de l'animal politique qu'est l'homme.
Nous n'irons pas en effet jusqu' dire qu'un des attributs du chef endormi
au fond de nous soit la frocit. Mais il est certain que la nature, massacreuse
des individus en mme temps que gnratrice des espces, a d vouloir le chef
impitoyable si elle a prvu des chefs. L'histoire tout entire en tmoigne. Des
hcatombes inoues, prcdes des pires supplices, ont t ordonnes avec un
parfait sang-froid par des hommes qui nous en ont eux-mmes lgu le rcit,
grav sur la pierre. On dira que ces choses se passaient dans des temps trs
anciens. Mais si la forme a chang, si le christianisme a mis fin certains
crimes ou tout au moins obtenu qu'on ne s'en vantt pas, le meurtre est trop
souvent rest la ratio ultima, quand ce n'est pas prima, de la politique. Monstruosit, sans doute, mais dont la nature est responsable autant que l'homme.
La nature ne dispose en effet ni de l'emprisonnement ni de l'exil ; elle ne
connat que la condamnation mort. Qu'on nous permette d'voquer un
souvenir. Il nous est arriv de voir de nobles trangers, venus de loin mais
vtus comme nous, parlant franais comme nous, se promener, affables et
aimables, au milieu de nous. Peu de temps aprs nous apprenions par un
journal que, rentrs dans leur pays et affilis des partis diffrents, l'un des
deux avait fait pendre l'autre. Avec tout l'appareil de la justice. Simplement
pour se dbarrasser d'un adversaire gnant. Au rcit tait jointe la photographie du gibet. Le correct homme du monde, moiti nu, se balanait aux
yeux de la foule. Vision d'horreur ! On tait entre civiliss , mais l'instinct
politique originel avait fait sauter la civilisation pour laisser passer la nature.
Des hommes qui se croiraient tenus de proportionner le chtiment l'offense,
s'ils avaient affaire un coupable, vont tout de suite jusqu' la mise mort de
l'innocent quand la politique a parl. Telles, les abeilles ouvrires poignardent
les mles quand elles jugent que la ruche n'a plus besoin d'eux.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
151
Mais laissons de ct le temprament du chef , et considrons les
sentiments respectifs des dirigeants et des dirigs. Ces sentiments seront plus
nets l o la ligne de dmarcation sera plus visible, dans une socit dj
grande mais qui se sera agrandie sans modification radicale de la socit
naturelle . La classe dirigeante, dans laquelle nous comprendrons le roi s'il y
a un roi, peut s'tre recrute en cours de route par des mthodes diffrentes ;
mais toujours elle se croit d'une race suprieure. Cela n'a rien d'tonnant. Ce
qui le serait pour nous davantage, si nous n'tions avertis du dimorphisme de
l'homme social, c'est que le peuple lui-mme soit convaincu de cette supriorit inne. Sans doute l'oligarchie s'applique en cultiver le sentiment. Si elle
doit son origine la guerre, elle croira et fera croire des vertus militaires qui
seraient chez elle congnitales, qui se transmettraient hrditairement. Elle
conserve d'ailleurs une relle supriorit de force, grce la discipline qu'elle
s'impose, et aux mesures qu'elle prend pour empcher la classe infrieure de
s'organiser son tour. L'exprience devrait pourtant montrer en pareil cas aux
dirigs que les dirigeants sont faits comme eux. Mais l'instinct rsiste. Il ne
commence cder que lorsque la classe suprieure elle-mme l'y invite.
Tantt elle le fait involontairement, par une incapacit vidente, par des abus
si criants qu'elle dcourage la foi mise en elle. Tantt l'invitation est volontaire, tels ou tels de ses membres se tournant contre elle, souvent par ambition
personnelle, quelquefois par un sentiment de justice: penchs vers la classe
infrieure, ils dissipent alors l'illusion qu'entretenait la distance. C'est ainsi
que des nobles collaborrent la rvolution de 1789, qui abolit le privilge de
la naissance. D'une manire gnrale, l'initiative des assauts mens contre
l'ingalit - justifie ou injustifie - est plutt venue d'en haut, du milieu des
mieux partags, et non pas d'en bas, comme on aurait pu s'y attendre s'il n'y
avait eu en prsence que des intrts de classe. Ainsi ce furent des bourgeois,
et non pas des ouvriers, qui jourent le rle prpondrant dans les rvolutions
de 1830 et de 1848, diriges (la seconde surtout) contre le privilge de la
richesse. Plus tard ce furent des hommes de la classe instruite qui rclamrent
l'instruction pour tous. La vrit est que si une aristocratie croit naturellement,
religieusement, sa supriorit native, le respect qu'elle inspire est non moins
religieux, non moins naturel.
On comprend donc que l'humanit ne soit venue la dmocratie que sur le
tard (car ce furent de fausses dmocraties que les cits antiques, bties sur
l'esclavage, dbarrasses par cette iniquit fondamentale des plus gros et des
plus angoissants problmes). De toutes les conceptions politiques c'est en
effet la plus loigne de la nature, la seule qui transcende, en intention au
moins, les conditions de la socit close . Elle attribue l'homme des droits
inviolables. Ces droits, pour rester inviols, exigent de la part de tous une
fidlit inaltrable au devoir. Elle prend donc pour matire un homme idal,
respectueux des autres comme de lui-mme, s'insrant dans des obligations
qu'il tient pour absolues, concidant si bien avec cet absolu qu'on ne peut plus
dire si c'est le devoir qui confre le droit ou le droit qui impose le devoir. Le
citoyen ainsi dfini est la fois lgislateur et sujet , pour parler comme
Kant. L'ensemble des citoyens, c'est--dire le peuple, est donc souverain.
Telle est la dmocratie thorique. Elle proclame la libert, rclame l'galit, et
rconcilie ces deux surs ennemies en leur rappelant qu'elles sont meurs, en
mettant au-dessus de tout la fraternit. Qu'on prenne de ce biais la devise
rpublicaine, on trouvera que le troisime terme lve la contradiction si
souvent signale entre les deux autres, et que la fraternit est l'essentiel : ce
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
152
qui permettrait de dire que la dmocratie est d'essence vanglique, et qu'elle
a pour moteur l'amour. On en dcouvrirait les origines sentimentales dans
l'me de Rousseau, les principes philosophiques dans luvre de Kant, le fond
religieux chez Kant et chez Rousseau ensemble: on sait ce que Kant doit son
pitisme, Rousseau un protestantisme et un catholicisme qui ont interfr
ensemble. La Dclaration amricaine d'indpendance (1776), qui servit de
modle la Dclaration des droits de l'homme en 1791, a d'ailleurs des
rsonances puritaines : Nous tenons pour vident... que tous les hommes ont
t dous par leur Crateur de certains droits inalinables.... etc. Les
objections tires du vague de la formule dmocratique viennent de ce qu'on en
a mconnu le caractre originellement religieux. Comment demander une
dfinition prcise de la libert et de l'galit, alors que l'avenir doit rester
ouvert tous les progrs, notamment la cration de conditions nouvelles o
deviendront possibles des formes de libert et d'galit aujourd'hui irralisables, peut-tre inconcevables ? On ne peut que tracer des cadres, ils se
rempliront de mieux en mieux si la fraternit y pourvoit. Ama, et fac quod vis.
La formule d'une socit non dmocratique, qui voudrait que sa devise correspondt, terme terme, celle de la dmocratie, serait Autorit, hirarchie,
fixit . Voil donc la dmocratie dans son essence. Il va sans dire qu'il y faut
voir simplement un idal, ou plutt une direction o acheminer l'humanit.
D'abord, c'est surtout comme protestation qu'elle s'est introduite dans le
monde. Chacune des phrases de la Dclaration des droits de l'homme est un
dfi jet un abus. Il s'agissait d'en finir avec des souffrances intolrables.
Rsumant les dolances prsentes dans les cahiers des tats gnraux, mile
Faguet a crit quelque part que la Rvolution ne s'tait pas faite pour la libert
et l'galit, mais simplement parce qu'on crevait de faim . A supposer que
ce soit exact, il faudrait expliquer pourquoi c'est partir d'un certain moment
qu'on n'a plus voulu crever de faim . Il n'en est pas moins vrai que si la
Rvolution formula ce qui devait tre, ce fut pour carter ce qui tait. Or il
arrive que l'intention avec laquelle une ide a t lance y reste invisiblement
adhrente, comme la flche sa direction. Les formules dmocratiques,
nonces d'abord dans une pense de protestation, se sont ressenties de leur
origine. On les trouve commodes pour empcher, pour rejeter, pour renverser ; il est moins facile d'en tirer l'indication positive de ce qu'il faut faire.
Surtout, elles ne sont applicables que si on les transpose, absolues et quasi
vangliques, en termes de moralit purement relative, ou plutt d'intrt
gnral ; et la transposition risque toujours d'amener une incurvation dans le
sens des intrts particuliers. Mais il est inutile d'numrer les objections
leves contre la dmocratie et les rponses qu'on -y fait. Nous avons
simplement voulu montrer dans l'tat d'me dmocratique un grand effort en
sens inverse de la nature.
De la socit naturelle nous venons en effet d'indiquer quelques traits. Ils
se rejoignent, et lui composent une physionomie qu'on interprtera sans peine.
Repliement sur soi, cohsion, hirarchie, autorit absolue du chef, tout cela
signifie discipline, esprit de guerre. La nature a-t-elle voulu la guerre ? Rptons, une fois de plus, que la nature n'a rien voulu, si l'on entend par volont
une facult de prendre des dcisions particulires. Mais elle ne peut poser une
espce animale sans dessiner implicitement les attitudes et mouvements qui
rsultent de sa structure et qui en sont les prolongements. C'est en ce sens
qu'elle les a voulus. Elle a dot l'homme d'une intelligence fabricatrice. Au
lieu de lui fournir des instruments, comme elle l'a fait pour bon nombre
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
153
d'espces animales, elle a prfr qu'il les construist lui-mme. Or l'homme a
ncessairement la proprit de ses instruments, au moins pendant qu'il s'en
sert. Mais puisqu'ils sont dtachs de lui, ils peuvent lui tre pris ; les prendre
tout faits est plus facile que de les faire. Surtout, ils doivent agir sur une
matire, servir d'armes de chasse ou de pche, par exemple ; le groupe dont il
est membre aura jet son dvolu sur une fort, un lac, une rivire ; et cette
place, son tour, un autre groupe pourra juger plus commode de s'y installer
que de chercher ailleurs. Ds lors, il faudra se battre. Nous parlons d'une fort
o l'on chasse, d'un lac o l'on pche : il pourra aussi bien tre question de
terres cultiver, de femmes enlever, d'esclaves emmener. Comme aussi
c'est par des raisons varies qu'on justifiera ce qu'on aura fait. Mais peu
importent la chose que l'on prend et le motif qu'on se donne : l'origine de la
guerre est la proprit, individuelle ou collective, et comme l'humanit est
prdestine la proprit par sa structure, la guerre est naturelle. L'instinct
guerrier est si fort qu'il est le premier apparatre quand on gratte la
civilisation pour retrouver la nature. On sait combien les petits garons aiment
se battre. Ils recevront des coups. Mais ils auront eu la satisfaction d'en
donner. On a dit avec raison que les jeux de l'enfant taient les exercices
prparatoires auxquels la nature le convie en vue de la besogne qui incombe
l'homme fait. Mais on peut aller plus loin, et voir des exercices prparatoires
ou des jeux dans la plupart des guerres enregistres par l'histoire. Quand on
considre la futilit des motifs qui provoqurent bon nombre d'entre elles, on
pense aux duellistes de Marion Delorme qui s'entre-tuaient pour rien, pour
le plaisir , ou bien encore l'Irlandais cit par Lord Bryce, qui ne pouvait
voir deux hommes changer des coups de poing dans la rue sans poser la
question : Ceci est-il une affaire prive, ou peut-on se mettre de la partie ?
En revanche, si l'on place ct des querelles accidentelles les guerres dcisives, qui aboutirent l'anantissement d'un peuple, on comprend que cellesci furent la raison d'tre de celles-l : il fallait un instinct de guerre, et parce
qu'il existait en vue de guerres froces qu'on pourrait appeler naturelles, une
foule de guerres accidentelles ont eu lieu, simplement pour empcher l'arme
de se rouiller. - Qu'on songe maintenant l'exaltation des peuples au commencement d'une guerre ! Il y a l sans doute lune raction dfensive contre la
peur, une stimulation automatique des courages. Mais il y a aussi le sentiment
qu'on tait fait pour une vie de risque et d'aventure, comme si la paix n'tait
qu'une halte entre deux guerres. L'exaltation tombe bientt, car la souffrance
est grande. Mais si on laisse de ct la dernire guerre, dont l'horreur a
dpass tout ce qu'on croyait possible, il est curieux de voir comme les
souffrances de la guerre s'oublient vite pendant la paix. On prtend qu'il existe
chez la femme des mcanismes spciaux d'oubli pour les douleurs de
l'accouchement : un souvenir trop complet l'empcherait de vouloir recommencer. Quelque mcanisme de ce genre semble vraiment fonctionner pour
les horreurs de la guerre, surtout chez les peuples jeunes. - La nature a pris de
ce ct d'autres prcautions encore. Elle a interpos entre les trangers et nous
un voile habilement tiss d'ignorances, de prventions et de prjugs. Qu'on
ne connaisse pas un pays o l'on n'est jamais all, cela n'a rien d'tonnant.
Mais que, ne le connaissant pas, on le juge, et presque toujours dfavorablement, il y a l un fait qui rclame une explication. Quiconque a sjourn hors
de son pays, et voulu ensuite initier ses compatriotes ce que nous appelons
une mentalit trangre, a pu constater chez eux une rsistance instinctive.
La rsistance n'est pas plus forte s'il s'agit d'un pays plus lointain. Bien au
contraire, elle varierait plutt en raison inverse de la distance. Ceux qu'on a le
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
154
plus de chances de rencontrer sont ceux qu'on veut le moins connatre. La
nature ne s'y ft pas prise autrement pour faire de tout tranger un ennemi
virtuel, car si une parfaite connaissance rciproque n'est pas ncessairement
sympathie, elle exclut du moins la haine. Nous avons pu le constater pendant
la dernire guerre. Tel professeur d'allemand tait aussi bon patriote que
n'importe quel autre Franais, aussi prt donner sa vie, aussi mont
mme contre l'Allemagne, mais ce n'tait pas la mme chose. Un coin restait
rserv. Celui qui connat fond la langue et la littrature d'un peuple ne peut
pas tre tout fait son ennemi. on devrait y penser quand on demande
l'ducation de prparer une entente entre nations. La matrise d'une langue
trangre, en rendant possible une imprgnation de l'esprit par la littrature et
la civilisation correspondantes, peut faire tomber d'un seul coup la prvention
voulue par la nature contre l'tranger en gnral. Mais nous n'avons pas
numrer tous les effets extrieurs visibles de la prvention cache. Disons
seulement que les deux maximes opposes Homo homini deus et Homo
homini lupus se concilient aisment. Quand on formule la premire, on pense
quelque compatriote. L'autre concerne les trangers.
Nous venons de dire qu' ct des guerres accidentelles il en est d'essentielles, pour lesquelles l'instinct guerrier semble avoir t fait. De ce nombre
sont les guerres d'aujourd'hui. On cherche de moins en moins conqurir pour
conqurir. On ne se bat plus par amour-propre bless, pour le prestige, pour la
gloire. On se bat pour n'tre pas affam, dit-on, - en ralit pour se maintenir
un certain niveau de vie au-dessous duquel on croit qu'il ne vaudrait plus la
peine de vivre. Plus de dlgation un nombre restreint de soldats chargs de
reprsenter la nation. Plus rien qui ressemble un duel. Il faut que tous se
battent contre tous, comme firent les hordes des premiers temps. Seulement
on se bat avec les armes forges par notre civilisation, et les massacres sont
d'une horreur que les anciens n'auraient mme pas imagine. Au train dont va
la science, le jour approche o l'un des adversaires, possesseur d'un secret
qu'il tenait en rserve, aura le moyen de supprimer l'autre. Il ne restera peuttre plus trace du vaincu sur la terre.
Les choses suivront-elles leur cours ? Des hommes que nous n'hsitons
pas ranger parmi les bienfaiteurs de l'humanit se sont heureusement mis en
travers. Comme tous les grands optimistes, ils ont commenc par supposer
rsolu le problme rsoudre. Ils ont fond la Socit des Nations. Nous
estimons que les rsultats obtenus dpassent dj ce qu'on pouvait esprer.
Car la difficult de supprimer les guerres est plus grande encore que ne se
l'imaginent gnralement ceux qui ne croient pas leur suppression. Pessimistes, ils s'accordent avec les optimistes considrer le cas de deux peuples
qui vont se battre comme analogue celui de deux individus qui ont une
querelle ; ils estiment seulement que ceux-l ne pourront jamais, comme
ceux-ci, tre contraints matriellement de porter le litige devant des juges et
d'accepter la dcision. La diffrence est pourtant radicale. Mme si la Socit
des Nations disposait d'une force arme apparemment suffisante (encore le
rcalcitrant aurait-il toujours sur elle l'avantage de l'lan ; encore l'imprvu de
la dcouverte scientifique rendra-t-il de plus en plus imprvisible la nature de
la rsistance que la Socit devrait prparer) elle se heurterait l'instinct
profond de guerre que recouvre la civilisation ; tandis que les individus qui
s'en remettent aux juges du soin de trancher un diffrend y sont obscurment
encourags par l'instinct de discipline immanent la socit close : une
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
155
dispute les avait carts accidentellement de la position normale, qui tait une
exacte insertion dans la socit ; ils y reviennent, comme le pendule la
verticale. Bien plus grave est donc la difficult. Est-ce en vain, cependant,
qu'on cherche la surmonter ?
Nous ne le pensons pas. Le prsent travail avait pour objet de rechercher
les origines de la morale et de la religion. Nous avons abouti certaines
conclusions. Nous pourrions en rester l. Mais puisqu'au fond de nos
conclusions il y avait une distinction radicale entre la socit close et la
socit ouverte, puisque les tendances de la socit close nous ont paru
subsister, indracinables, dans la socit qui s'ouvre, puisque tous ces instincts
de discipline convergeaient primitivement vers l'instinct de guerre, nous
devons nous demander dans quelle mesure l'instinct originel pourra tre
rprim ou tourn, et rpondre par quelques considrations additionnelles
une question qui se pose nous tout naturellement.
L'instinct guerrier a beau exister par lui-mme, il ne s'en accroche pas
moins des motifs rationnels. L'histoire nous apprend que ces motifs ont t
trs varis. Ils se rduisent de plus en plus, mesure que les guerres deviennent plus terribles. La dernire guerre, avec celles qu'on entrevoit pour l'avenir si par malheur nous devons avoir encore des guerres, est lie au caractre
industriel de notre civilisation. Si l'on veut une figuration schmatique,
simplifie et stylise, des conflits d'aujourd'hui, on devra d'abord se reprsenter les nations comme des populations purement agricoles. Elles vivent des
produits de leurs terres. Supposons qu'elles aient tout juste de quoi se nourrir.
Elles s'accrotront dans la mesure o elles obtiendront de la terre un meilleur
rendement. Jusque-l tout va bien. Mais s'il y a un trop-plein de population, et
s'il ne veut pas se dverser au dehors, ou s'il ne le peut pas parce que l'tranger
ferme ses portes, o trouvera-t-il sa nourriture ? L'industrie arrangera les
choses. La population qui est en excdent se fera ouvrire. Si le pays ne
possde pas la force motrice pour actionner des machines, le fer pour en construire, des matires premires pour la fabrication, elle tchera de les emprunter l'tranger. Elle paiera sa dette, et recevra de plus la nourriture qu'elle ne
trouve pas chez elle, en renvoyant l'tranger les produits manufacturs. Les
ouvriers se trouveront ainsi tre des migrs l'intrieur . L'tranger les
emploie comme il l'aurait fait chez lui ; il prfre les laisser - ou peut-tre ontils prfr rester - l o ils sont ; mais c'est de l'tranger qu'ils dpendent. Que
l'tranger n'accepte plus leurs produits, ou qu'il ne leur fournisse plus les
moyens de fabriquer, les voil condamns mourir de faim. moins qu'ils ne
se dcident, entranant avec eux leur pays, aller prendre ce qu'on leur refuse.
Ce sera la guerre. Il va sans dire que les choses ne se passent jamais aussi
simplement. Sans tre prcisment menac de mourir de faim, on estime que
la vie est sans intrt si l'on n'a pas le confort, l'amusement, le luxe ; on tient
l'industrie nationale pour insuffisante si elle se borne vivre, si elle ne donne
pas la richesse ; un pays se juge incomplet s'il n'a pas de bons ports, des
colonies, etc. De tout cela peut sortir la guerre. Mais le schma que nous
venons de tracer marque suffisamment les causes essentielles : accroissement
de population, perte de dbouchs, privation de combustible et de matires
premires.
liminer ces causes ou en attnuer l'effet, voil la tche par excellence
d'un organisme international qui vise l'abolition de la guerre. La plus grave
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
156
d'entre elles est le surpeuplement. Dans un pays de trop faible natalit comme
la France, l'tat doit sans doute pousser l'accroissement de la population : un
conomiste qui fut pourtant le plus grand ennemi de l' tatisme demandait
que les familles eussent droit une prime pour chaque nouvel enfant partir
du troisime. Mais ne pourrait-on pas alors, inversement, dans les pays o la
population surabonde, frapper de taxes plus ou moins lourdes l'enfant en
excdent ? L'tat aurait le droit d'intervenir, de rechercher la paternit, enfin
de prendre des mes-ares qui seraient en d'autres cas inquisitoriales, puisque
c'est sur lui que l'on compte tacitement pour assurer la subsistance du pays et
par consquent celle de l'enfant qu'on a appel la vie. Nous reconnaissons la
difficult d'assigner administrativement une limite la population, lors mme
qu'on laisserait au chiffre une certaine lasticit. Si nous esquissons une
solution, c'est simplement pour marquer que le problme ne nous parat pas
insoluble : de plus comptents que nous en trouveront une meilleure. Mais ce
qui est certain, c'est que l'Europe est surpeuple, que le monde le sera bientt,
et que si l'on ne rationalise pas la production de l'homme lui-mme
comme on commence le faire pour son travail, on aura la guerre. Nulle part
il n'est plus dangereux de s'en remettre l'instinct. La mythologie antique
l'avait bien compris quand elle associait la desse de l'amour an dieu des
combats. Laissez faire Vnus, elle vous amnera Mars. Vous n'viterez pas la
rglementation (vilain mot, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, en ce qu'il met
imprativement des rallonges rgle et rglement). Que sera-ce, quand
viendront des problmes presque aussi graves, celui de la rpartition des
matires premires, celui de la plus ou moins libre circulation des produits,
plus gnralement celui de faire droit des exigences antagonistes prsentes
de part et d'autre comme vitales ? C'est une erreur dangereuse que de croire
qu'un organisme international obtiendra la paix dfinitive sans intervenir,
d'autorit, dans la lgislation des divers pays et peut-tre mme dans leur
administration. Qu'on maintienne le principe de la souverainet de l'tat, si
l'on veut : il flchira ncessairement dans son application aux cas particuliers.
Encore une fois, aucune de ces difficults n'est insurmontable si une portion
suffisante de l'humanit est dcide les surmonter. Mais il faut les regarder
en face, et savoir quoi l'on consent quand on demande la suppression des
guerres.
Maintenant, ne pourrait-on pas abrger la route par. courir, peut-tre
mme aplanir tout d'un coup les difficults au lieu de les tourner une une ?
Mettons part la question principale, celle de la population, qu'il faudra bien
rsoudre pour elle-mme, quoi qu'il arrive. Les autres tiennent surtout la
direction que notre existence a prise depuis le grand dveloppement de
l'industrie. Nous rclamons le confort, le bien-tre, le luxe. Nous voulons
nous amuser. Qu'arriverait-il si notre vie devenait plus austre ? Le mysticisme est incontestablement l'origine des grandes transformations morales.
L'humanit en parat sans doute aussi loigne que jamais. Mais qui sait ? Au
cours de notre dernier chapitre, nous avions cru entrevoir une relation entre le
mysticisme de l'Occident et sa civilisation industrielle. Il faudrait examiner les
choses plus attentivement. Tout le monde sent que l'avenir immdiat va
dpendre en grande partie de l'organisation de l'industrie, des conditions
qu'elle imposera ou qu'elle acceptera. Nous venons de voir qu' ce problme
est suspendu celui de la paix entre nations. Celui de la paix intrieure en
dpend au moins autant. Faut-il craindre, faut-il esprer ? Longtemps il avait
t entendu qu'industrialisme et machinisme feraient le bonheur du genre
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
157
humain. Aujourd'hui l'on mettrait volontiers sur leur compte les maux dont
nous souffrons. Jamais, dit-on, l'humanit n'a t plus assoiffe de plaisir, de
luxe et de richesse. Une force irrsistible semble la pousser de plus en plus
violemment la satisfaction de ses dsirs les plus grossiers. C'est possible,
mais remontons l'impulsion qui fut l'origine. Si elle tait nergique, il a pu
suffire d'une dviation lgre au dbut pour produire un cart de plus en plus
considrable entre le but vis et l'objet atteint. Dans ce cas, il ne faudrait pas
tant se proccuper de l'cart que de l'impulsion. Certes, les choses ne se font
jamais toutes seules. L'humanit ne se modifiera que si elle veut se modifier.
Mais peut-tre s'est-elle dj mnag des moyens de le faire. Peut-tre est-elle
plus prs du but qu'elle ne le suppose elle-mme. Voyons donc ce qu'il en est.
Puisque nous avons mis en cause l'effort industriel, serrons-en de plus prs la
signification. Ce sera la conclusion du prsent ouvrage.
On a souvent parl des alternances de flux et de reflux qui s'observent en
histoire. Toute action prolonge dans un sens amnerait une raction en sens
contraire. Puis elle reprendrait, et le pendule oscillerait indfiniment. Il est
vrai que le pendule est dou ici de mmoire, et qu'il n'est plus le mme au
retour qu' l'aller, s'tant grossi de l'exprience intermdiaire. C'est pourquoi
l'image d'un mouvement en spirale, qu'on a voque quelquefois, serait plus
juste que celle de l'oscillation pendulaire. A vrai dire, il y a des causes psychologiques et sociales dont on pourrait annoncer a priori qu'elles produiront
des effets de ce genre. La jouissance ininterrompue d'un avantage qu'on avait
recherch engendre la lassitude ou l'indiffrence ; rarement elle tient tout ce
qu'elle promettait ; elle s'accompagne d'inconvnients qu'on n'avait pas
prvus ; elle finit par mettre en relief le ct avantageux de ce qu'on a quitt et
par donner envie d'y retourner. Elle en donnera surtout envie des gnrations
nouvelles, qui n'auront pas fait l'exprience des anciens maux, et qui n'auront
pas eu peiner pour en sortir. Tandis que les parents se flicitent de l'tat
prsent comme d'une acquisition qu'ils se rappellent avoir paye cher, les
enfants n'y pensent pas plus qu' l'air qu'ils respirent ; en revanche, ils seront
sensibles des dsagrments qui ne sont que l'envers des avantages douloureusement conquis pour eux. Ainsi natront des vellits de retour en arrire.
Ces allers et retours sont caractristiques de l'tat moderne, non pas en vertu
de quelque fatalit historique, mais parce que le rgime parlementaire a
justement t conu, en grande partie, pour canaliser le mcontentement. Les
gouvernants ne recueillent que des loges modrs pour ce qu'ils font de bon ;
ils sont l pour bien faire ; mais leurs moindres fautes comptent ; toutes se
conservent, jusqu' ce que leur poids accumul entrane la chute du gouvernement. Si ce sont deux partis adverses qui sont en prsence, et deux
seulement, le jeu se poursuivra avec une rgularit parfaite. Chacune des deux
quipes reviendra au pouvoir avec le prestige que donnent des principes rests
en apparence intacts pendant tout le temps qu'il n'y avait pas de responsabilit
prendre : les principes sigent dans l'opposition. En ralit elle aura
bnfici, si elle est intelligente, de l'exprience qu'elle aura laiss faire par
l'autre ; elle aura plus ou moins modifi le contenu de ses ides et par
consquent la signification de ses principes. Ainsi devient possible le progrs,
malgr l'oscillation ou plutt au moyen d'elle, pourvu qu'on en ait le souci.
Mais, dans des cas de ce genre, les alles et venues entre les deux contraires
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
158
rsultent de certains dispositifs trs simples monts par l'homme social ou de
certaines dispositions trs visibles de l'homme individuel. Elles ne manifestent
pas une ncessit qui dominerait les causes particulires d'alternance et qui
s'imposerait d'une manire gnrale aux vnements humains. En est-il de
telles ?
Nous ne croyons pas la fatalit en histoire. Il n'y a pas d'obstacle que des
volonts suffisamment tendues ne puissent briser, si elles s'y prennent
temps. Il n'y a donc pas de loi historique inluctable. Mais il y a (les lois
biologiques ; et les socits humaines, en tant que voulues d'un certain ct
par la nature, relvent de la biologie sur ce point particulier. Si l'volution du
monde organis s'accomplit selon certaines lois, je veux dire en vertu de
certaines forces, il est impossible que l'volution psychologique de l'homme
individuel et social renonce tout fait ces habitudes de la vie. Or nous
montrions jadis que l'essence d'une tendance vitale est de se dvelopper en
forme de gerbe, crant, par le seul fait de sa croissance, des directions divergentes entre lesquelles se partagera l'lan. Nous ajoutions que cette loi n'a rien
de mystrieux. Elle exprime simplement le fait qu'une tendance est la pousse
d'une multiplicit indistincte, laquelle n'est d'ailleurs indistincte, et n'est
multiplicit, que si on la considre rtrospectivement, quand des vues diverses
prises aprs coup sur son indivision passe la composent avec des lments
qui ont t en ralit crs par son dveloppement. Imaginons que l'orang
soit la seule couleur qui ait encore paru dans le monde : serait-il dj compos
de jaune et de rouge ? videmment non. Mais il aura t compos de jaune et
de rouge quand ces deux couleurs existeront leur tour : l'orang primitif
pourra tre envisag alors du double point de vue du rouge et du jaune ; et si
l'on supposait, par un jeu de fantaisie, que le jaune et le rouge ont surgi d'une
intensification de l'orang, on aurait un exemple trs simple de ce que nous
appelons la croissance en forme de gerbe. Mais point n'est besoin de fantaisie
ni de comparaison. Il suffit de regarder la vie, sans arrire-pense de synthse
artificielle. Certains tiennent l'acte volontaire pour un rflexe compos,
d'autres verraient dans le rflexe une dgradation du volontaire. La vrit est
que rflexe et volontaire matrialisent deux vues possibles sur une activit
primordiale, indivisible, qui n'tait ni l'un ni l'autre, mais qui devient rtroactivement, par eux, les deux la fois. Nous en dirions autant de l'instinct et de
l'intelligence, de la vie animale et de la vie vgtale, de maint autre couple de
tendances divergentes et complmentaires. Seulement, dans l'volution
gnrale de la vie, les tendances ainsi cres par voie de dichotomie se dveloppent le plus souvent dans des espces distinctes ; elles vont, chacune de
son ct, chercher fortune dans le monde ; la matrialit qu'elles se sont
donne les empche de venir se ressouder pour ramener en plus fort, en plus
complexe, en plus volu, la tendance originelle. Il n'en est pas de mme dans
l'volution de la vie psychologique et sociale. C'est dans le mme individu, ou
dans la mme socit, qu'voluent ici les tendances qui se sont constitues par
dissociation. Et elles ne peuvent d'ordinaire se dvelopper que successivement. Si elles sont deux, comme il arrive le plus souvent, c'est l'une d'elles
surtout qu'on s'attachera d'abord ; avec elle on ira plus ou moins loin,
gnralement le plus loin possible ; puis, avec ce qu'on aura gagn au cours de
cette volution, on reviendra chercher celle qu'on a laisse en arrire. On la
dveloppera son tour, ngligeant maintenant la premire, et ce nouvel effort
se prolongera jusqu' ce que, renforc par de nouvelles acquisitions, on puisse
reprendre celle-ci et la pousser plus loin encore. Comme, pendant l'opration,
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
159
on est tout entier l'une des deux tendances, comme c'est elle seule qui
compte, volontiers on dirait qu'elle seule est positive et que l'autre n'en est que
la ngation : s'il plat de mettre les choses sous cette forme, l'autre est effectivement le contraire. On constatera, - et ce sera plus ou moins vrai selon les
cas, - que le progrs s'est fait par une oscillation entre les deux contraires, la
situation n'tant d'ailleurs pas la mme et un gain ayant t ralis quand le
balancier revient son point de dpart. Il arrive pourtant que l'expression soit
rigoureusement juste, et que ce soit bien entre des contraires qu'il y ait eu
oscillation. C'est lorsqu'une tendance, avantageuse en elle-mme, est incapable de se modrer autrement que par l'action d'une tendance antagoniste,
laquelle se trouve ainsi tre galement avantageuse. Il semble que la sagesse
conseillerait alors une coopration des deux tendances, la premire intervenant quand les circonstances le demandent, l'autre la retenant au moment o
elle va dpasser la mesure. Malheureusement, il est difficile de dire o
commence l'exagration et le danger. Parfois, le seul fait de pousser plus loin
qu'il ne semblait raisonnable conduit un entourage nouveau, cre une
situation nouvelle, qui supprime le danger en mme temps qu'il accentue
l'avantage. Il en est surtout ainsi des tendances trs gnrales qui dterminent
l'orientation d'une socit et dont le dveloppement se rpartit ncessairement
sur un nombre plus ou moins considrable de gnrations. Une intelligence,
mme surhumaine, ne saurait dire o l'on sera conduit, puisque l'action en
marche cre sa propre route, cre pour une forte part les conditions o elle
s'accomplira, et dfie ainsi le calcul. On poussera donc de plus en plus loin ;
on ne s'arrtera, bien souvent, que devant l'imminence d'une catastrophe. La
tendance antagoniste prend alors la place reste vide ; seule son tour, elle ira
aussi loin qu'il lui sera possible d'aller. Elle sera raction, si l'autre s'est
appele action. Comme les deux tendances, si elles avaient chemin ensemble, se seraient modres l'une l'autre, comme leur interpntration dans une
tendance primitive indivise est ce mme par quoi doit se dfinir la modration, le seul fait de prendre toute la place communique chacune d'elles un
lan qui peut aller jusqu' l'emportement mesure que tombent les obstacles ;
elle a quelque chose de frntique. N'abusons pas du mot loi dans un
domaine qui est celui de la libert, mais usons de ce terme commode quand
nous nous trouvons devant de grands faits qui prsentent une rgularit
suffisante : nous appellerons loi de dichotomie celle qui parat provoquer la
ralisation, par leur seule dissociation, de tendances qui n'taient d'abord que
des vues diffrentes prises sur une tendance simple. Et nous proposerons alors
d'appeler loi de double frnsie l'exigence, immanente chacune des deux
tendances une fois ralise par sa sparation, d'tre suivie jusqu'au bout, comme s'il y avait un bout ! Encore une fois : il est difficile de ne pas se
demander si la tendance simple n'et pas mieux fait de crotre sans se
ddoubler, maintenue dans la juste mesure par la concidence mme de la
force d'impulsion avec un pouvoir d'arrt, qui ne serait alors que virtuellement
une force d'impulsion diffrente. On n'aurait pas risqu de tomber dans
l'absurde, on se serait assur contre la catastrophe. Oui, mais on n'et pas
obtenu le maximum de cration en quantit et en qualit. Il faut s'engager
fond dans l'une des directions pour savoir ce qu'elle donnera : quand on ne
pourra plus avancer, on reviendra, avec tout l'acquis, se lancer dans la
direction nglige ou abandonne. Sans doute, regarder du dehors ces alles
et venues, on ne voit que l'antagonisme des deux tendances, les vaines
tentatives de l'une pour contrarier le progrs de l'autre, l'chec final de celle-ci
et la revanche de la premire : l'humanit aime le drame ; volontiers elle
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
160
cueille dans l'ensemble d'une histoire plus ou moins longue les traits qui lui
impriment la forme d'une lutte entre deux partis, ou deux socits, ou deux
principes ; chacun d'eux, tour tour, aurait remport la victoire. Mais la lutte
n'est ici que l'aspect superficiel d'un progrs. La vrit est qu'une tendance sur
laquelle deux vues diffrentes sont possibles ne peut fournir son maximum, en
quantit et en qualit, que si elle matrialise ces deux possibilits en ralits
mouvantes, dont chacune se jette en avant et accapare la place, tandis que
l'autre la guette sans cesse pour savoir si son tour est venu. Ainsi se
dveloppera le contenu de la tendance originelle, si toutefois on peut parler de
contenu alors que personne, pas mme la tendance elle-mme devenue
consciente, ne saurait dire ce qui sortira d'elle. Elle donne l'effort, et le rsultat
est une surprise. Telle est l'opration de la nature : les luttes dont elle nous
offre le spectacle ne se rsolvent pas tant en hostilits qu'en curiosits. Et c'est
prcisment quand elle imite la nature, quand elle se laisse aller l'impulsion
primitivement reue, que la marche de l'humanit assume une certaine
rgularit et se soumet, trs imparfaitement d'ailleurs, des lois comme celles
que nous noncions. Mais le moment est venu de fermer notre trop longue
parenthse. Montrons seulement comment s'appliqueraient nos deux lois dans
le cas qui nous l'a fait ouvrir.
Il s'agissait du souci de confort et de luxe qui semble tre devenu la
proccupation principale de l'humanit. A voir comment il a dvelopp l'esprit
d'invention, comment beaucoup d'inventions sont des applications de notre
science, comment la science est destine s'accrotre sans fin, on serait tent
de croire qu'il y aura progrs indfini dans la mme direction. Jamais, en effet,
les satisfactions que des inventions nouvelles apportent d'anciens besoins ne
dterminent l'humanit en rester l ; des besoins nouveaux surgissent, aussi
imprieux, de plus en plus nombreux. On a vu la course au bien-tre aller en
s'acclrant, sur une piste o des foules de plus en plus compactes se prcipitaient. Aujourd'hui, c'est une rue. Mais cette frnsie mme ne devrait-elle
pas nous ouvrir les yeux ? N'y aurait-il pas quelque autre frnsie, dont celleci aurait pris la suite, et qui aurait dvelopp en sens oppos une activit dont
elle se trouve tre le complment ? Par le fait, c'est partir du quinzime ou
du seizime sicle que les hommes semblent aspirer un largissement de la
vie matrielle. Pendant tout le moyen ge un idal d'asctisme avait
prdomin. Inutile de rappeler les exagrations auxquelles il avait conduit ;
dj il y avait eu frnsie. On dira que cet asctisme fut le fait d'un petit
nombre, et l'on aura raison. Mais de mme que le mysticisme, privilge de
quelques-uns, fut vulgaris par la religion, ainsi l'asctisme concentr, qui fut
sans doute exceptionnel, se dilua pour le commun des hommes en une
indiffrence gnrale aux conditions de l'existence quotidienne. C'tait, pour
tout le monde, un manque de confort qui nous surprend. Riches et pauvres se
passaient de superfluits que nous tenons pour des ncessits. On a fait
remarquer que, si le seigneur vivait mieux que le paysan, il faut surtout entendre par l qu'il tait nourri plus abondamment 1. Pour le reste, la diffrence
tait lgre. Nous nous trouvons donc bien ici devant deux tendances
divergentes qui se sont succd et qui se sont comportes, l'une et l'autre,
frntiquement. Il est permis de prsumer qu'elles correspondent deux vues
opposes prises sur une tendance primordiale, laquelle aurait trouv ainsi
moyen de tirer d'elle-mme, en quantit et en qualit, tout ce qu'elle pouvait et
1
Voir l'intressant ouvrage de Gina Lombroso, La Ranon du machinisme, Paris, 1930.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
161
mme plus qu'elle n'avait, s'engageant sur les deux voies tour tour, se
replaant dans l'une des directions avec tout ce qui avait t ramass le long
de l'autre. Il y aurait donc oscillation et progrs, progrs par oscillation. Et il
faudrait prvoir, aprs la complication sans cesse croissante de la vie, un
retour la simplicit. Ce retour n'est videmment pas certain ; l'avenir de
l'humanit reste indtermin, parce qu'il dpend d'elle. Mais si, du ct de
l'avenir, il n'y a que des possibilits ou des probabilits, que nous examinerons
tout l'heure, il n'en est pas de mme pour le pass : les deux dveloppements
opposs que nous venons de signaler sont bien ceux d'une seule tendance
originelle.
Dj l'histoire des ides en tmoigne. De la pense socratique, suivie dans
deux sens contraires qui chez Socrate taient complmentaires, sont sorties les
doctrines cyrnaque et cynique : l'une voulait qu'on demandt la vie le plus
grand nombre possible de satisfactions, l'autre qu'on apprt s'en passer. Elles
se prolongrent dans l'picurisme et le stocisme avec leurs deux principes
opposs, relchement et tension. Si l'on doutait de la communaut d'essence
entre les deux tats d'me auxquels ces principes correspondent, il suffirait de
remarquer que dans l'cole picurienne elle-mme, ct de l'picurisme
populaire qui tait la recherche souvent effrne du plaisir, il y eut l'picurisme d'picure, d'aprs lequel le plaisir suprme tait de n'avoir pas besoin
des plaisirs. La vrit est que les deux principes sont au fond de l'ide qu'on
s'est toujours faite du bonheur. On dsigne par ce dernier mot quelque chose
de complexe et de confus, un de ces concepts que l'humanit a voulu laisser
dans le vague pour que chacun le dtermint sa manire. Mais, dans quelque
sens qu'on l'entende, il n'y a pas de bonheur sans scurit, je veux dire sans
perspective de dure pour un tat dont on s'est accommod. Cette assurance,
on peut la trouver ou dans une mainmise sur les choses, ou dans une matrise
de soi qui rende indpendant des choses. Dans les deux cas on jouit de sa
force, soit qu'on la peroive du dedans, soit qu'elle s'tale au dehors : ou est
sur le chemin de l'orgueil, ou sur celui de la vanit. Mais simplification et
complication de la vie rsultent bien d'une dichotomie , sont bien susceptibles de se dvelopper en double frnsie , ont bien enfin ce qu'il faut
pour se succder priodiquement.
Dans ces conditions, comme il a t dit plus haut, un retour la simplicit
n'a rien d'invraisemblable. La science elle-mme pourrait bien nous en
montrer le chemin. Tandis que physique et chimie nous aident satisfaire et
nous invitent ainsi multiplier nos besoins, on peut prvoir que physiologie et
mdecine nous rvleront de mieux en mieux ce qu'il y a de dangereux dans
cette multiplication, et de dcevant dans la plupart de nos satisfactions.
J'apprcie un bon plat de viande : tel vgtarien, qui l'aimait jadis autant que
moi, ne peut aujourd'hui regarder de la viande sans tre pris de dgot. On
dira que nous avons raison l'un et l'autre, et qu'il ne faut pas plus disputer des
gots que des couleurs. Peut-tre ; mais je ne puis m'empcher de constater la
certitude inbranlable o il est, lui vgtarien, de ne jamais revenir son
ancienne disposition, alors que je me sens beaucoup moins sr de conserver
toujours la mienne. Il a fait les deux expriences; je n'en ai fait qu'une. Sa
rpugnance s'intensifie quand son attention se fixe sur elle, tandis que ma
satisfaction tient de la distraction et plit plutt la lumire ; je crois qu'elle
s'vanouirait si des expriences dcisives venaient prouver, comme ce n'est
pas impossible, qu'on s'empoisonne spcifiquement, lentement, manger de la
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
162
viande 1. On nous enseignait au collge que la composition des substances
alimentaires tait connue, les exigences de notre organisme galement, qu'on
pouvait dduire de l ce qu'il faut et ce qui suffit comme ration d'entretien. On
et t bien tonn d'apprendre que l'analyse chimique laissait chapper les
vitamines , dont la prsence dans notre nourriture est indispensable notre
sant. On s'apercevra sans doute que plus d'une maladie, aujourd'hui rebelle
aux efforts de la mdecine, a son origine lointaine dans des carences que
nous ne souponnons pas. Le seul moyen sr d'absorber tout ce dont nous
avons besoin serait de ne soumettre les aliments aucune laboration, peuttre mme (qui sait ?) de ne pas les cuire. Ici encore la croyance l'hrdit de
l'acquis a fait beaucoup de mal. On se plait dire que l'estomac humain s'est
dshabitu, que nous ne pourrions plus nous alimenter comme l'homme
primitif. On a raison, si l'on entend par l que nous laissons dormir depuis
notre enfance des dispositions naturelles, et qu'il nous serait difficile de les
rveiller un certain ge. Mais que nous naissions modifis, c'est peu probable : supposer que notre estomac diffre de celui de nos anctres prhistoriques, la diffrence n'est pas due de simples habitudes contractes dans la
suite des temps. La science ne tardera pas nous fixer sur l'ensemble de ces
points. Supposons qu'elle le fasse dans le sens que nous prvoyons : la seule
rforme de notre alimentation aurait des rpercussions sans nombre sur notre
industrie, notre commerce, notre agriculture, qui en seraient considrablement
simplifis. Que dire de nos autres besoins ? Les exigences du sens gnsique
sont imprieuses, mais on en finirait vite avec elles si l'on s'en tenait la
nature. Seulement, autour d'une sensation forte mais pauvre, prise comme
note fondamentale, l'humanit a fait surgir un nombre sans cesse croissant
d'harmoniques ; elle en a tir une si riche varit de timbres que n'importe
quel objet, frapp par quelque ct, donne maintenant le son devenu obsession. C'est un appel constant au sens par l'intermdiaire de l'imagination.
Toute notre civilisation est aphrodisiaque. Ici encore la science a son mot
dire, et elle le dira un jour si nettement qu'il faudra bien l'couter : il n'y aura
plus de plaisir tant aimer le plaisir. La femme htera la venue de ce moment
dans la mesure o elle voudra rellement, sincrement, devenir l'gale de
l'homme, au lieu de rester l'instrument qu'elle est encore, attendant de vibrer
sous l'archet du musicien. Que la transformation s'opre : notre vie sera plus
srieuse en mme temps que plus simple. Ce que la femme exige de luxe pour
plaire l'homme et, par ricochet, pour se plaire elle-mme, deviendra en
grande partie inutile. Il y aura moins de gaspillage, et aussi moins d'envie. Luxe, plaisir et bien-tre se tiennent d'ailleurs de prs, sans cependant avoir
entre eux le rapport qu'on se figure gnralement. On les dispose le long d'une
chelle : du bien-tre au luxe on passerait par voie de gradation ascendante ;
quand nous nous serions assur le bien-tre, nous voudrions y superposer le
plaisir ; puis viendrait l'amour du luxe. Mais c'est l une psychologie
purement intellectualiste, qui croit pouvoir calquer nos tats d'me sur leurs
objets. Parce que le luxe cote plus cher que le simple agrment, et le plaisir
que le bien-tre, on se reprsente la croissance progressive de je ne sais quel
dsir correspondant. La vrit est que c'est le plus souvent par amour du luxe
qu'on dsire le bien-tre, parce que le bien-tre qu'on n'a pas apparat comme
un luxe, et qu'on veut imiter, galer, ceux qui sont en tat de l'avoir. Au
1
Htons-nous de dire que nous n'avons aucune lumire particulire sur ce point. Nous
choisissons l'exemple de la viande comme nous prendrions celui de tout autre aliment
habituel.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
163
commencement tait la vanit. Combien de mets ne sont recherchs que parce
qu'ils sont coteux ! Pendant des annes les peuples civiliss dpensrent une
bonne partie de leur effort extrieur se procurer des pices. On est stupfait
de voir que tel fut l'objet suprme de la navigation, alors si dangereuse ; que
des milliers d'hommes y jourent leur vie ; que le courage, l'nergie et l'esprit
d'aventure d'o sortit par accident la dcouverte de l'Amrique s'employrent
essentiellement la poursuite du gingembre et du girofle, du poivre et de la
cannelle. Qui se soucie des aromates si longtemps dlicieux depuis qu'on peut
les avoir pour quelques sous chez l'picier du coin ? De telles constatations
ont de quoi attrister le moraliste. Qu'on y rflchisse pourtant, on y trouvera
aussi des motifs d'esprer. Le besoin toujours croissant de bien-tre, la soif
d'amusement, le got effrn du luxe, tout ce qui nous inspire une si grande
inquitude pour l'avenir de l'humanit parce qu'elle a l'air d'y trouver des
satisfactions solides, tout cela apparatra comme un ballon qu'on remplit
furieusement d'air et qui se dgonflera aussi tout d'un coup. Nous savons
qu'une frnsie appelle la frnsie antagoniste. Plus particulirement, la comparaison des faits actuels ceux d'autrefois nous invite tenir pour transitoires des gots qui paraissent dfinitifs. Et puisque la possession d'une
automobile est aujourd'hui pour tant d'hommes l'ambition suprme, reconnaissons les services incomparables que rend l'automobile, admirons cette
merveille de mcanique, souhaitons qu'elle se multiplie et se rpande partout
o l'on a besoin d'elle, mais disons-nous que, pour le simple agrment ou pour
le plaisir de faire du luxe, elle pourrait ne plus tre si dsire dans peu de
temps d'ici, - sans toutefois tre dlaisse, nous l'esprons bien, comme le sont
aujourd'hui le girofle et la cannelle.
Nous touchons au point essentiel de notre discussion. Nous venons de citer
une satisfaction de luxe issue d'une invention mcanique. Beaucoup estiment
que c'est l'invention mcanique en gnral qui a dvelopp le got du luxe,
comme d'ailleurs du simple bien-tre. Mme, si l'on admet d'ordinaire que nos
besoins matriels iront toujours en croissant et en s'exasprant, c'est parce
qu'on ne voit pas de raison pour que l'humanit abandonne la voie de l'invention mcanique, une fois qu'elle y est entre. Ajoutons que, plus la science
avance, plus ses dcouvertes suggrent d'inventions ; souvent il n'y a qu'un
pas de la thorie l'application; et comme la science ne saurait s'arrter, il
semble bien, en effet, qu'il ne doive pas y avoir de fin la satisfaction de nos
anciens besoins, la cration de besoins nouveaux. Mais il faudrait d'abord se
demander si l'esprit d'invention suscite ncessairement des besoins artificiels,
ou si ce ne serait pas le besoin artificiel qui aurait orient ici l'esprit d'invention.
La seconde hypothse est de beaucoup la plus probable. Elle est confirme
par des recherches rcentes sur les origines du machinisme 1. On a rappel
que l'homme avait toujours invent des machines, que l'antiquit en avait
connu de remarquables, que des dispositifs ingnieux furent imagines bien
avant l'closion de la science moderne et ensuite, trs souvent, indpendamment d'elle : aujourd'hui encore de simples ouvriers, sans culture scientifique,
trouvent des perfectionnements auxquels de savants ingnieurs n'avaient pas
pens. L'invention mcanique est un don naturel. Sans doute elle a t limite
1
Nous renvoyons encore au beau livre de Gina Lombroso. Cf. Mantoux, La Rvolution
industrielle au dix-huitime sicle.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
164
dans ses effets tant qu'elle s'est borne utiliser des nergies actuelles et, en
quelque sorte, visibles : effort musculaire, force du vent ou d'une chute d'eau.
La machine n'a donn tout son rendement que du jour o l'on a su mettre son
service, par un simple dclenchement, des nergies potentielles emmagasines
pendant des millions d'annes, empruntes au soleil, disposes dans la houille,
le ptrole, etc. Mais ce jour fui celui de l'invention de la machine vapeur, et
l'on sait qu'elle n'est pas sortie de considrations thoriques. Htons-nous
d'ajouter que le progrs, d'abord lent, s'est effectu pas de gant lorsque la
science se fut mise de la partie. Il n'en est pas moins vrai que l'esprit d'invention mcanique, qui coule dans un lit troit tant qu'il est laiss lui-mme, qui
s'largit indfiniment quand il a rencontr la science, en reste distinct et
pourrait la rigueur s'en sparer. Tel, le Rhne entre dans le lac de Genve,
parat y mler ses eaux, et montre sa sortie qu'il avait conserv son
indpendance.
Il n'y a donc pas eu, comme on serait port le croire, une exigence de la
science imposant aux hommes, par le seul fait de son dveloppement, des
besoins de plus en plus artificiels. S'il en tait ainsi, l'humanit serait voue
une matrialit croissante, car le progrs de la science ne s'arrtera pas. Mais
la vrit est que la science a donn ce qu'on lui demandait et qu'elle n'a pas
pris ici l'initiative ; c'est l'esprit d'invention qui ne s'est pas toujours exerc au
mieux des intrts de l'humanit. Il a cr une foule de besoins nouveaux ; il
ne s'est pas assez proccup d'assurer au plus grand nombre, tous si c'tait
possible, la satisfaction des besoins anciens. Plus simplement : sans ngliger
le ncessaire, il a trop pens au superflu. On dira que ces deux termes sont
malaiss dfinir, que ce qui est luxe pour les uns est une ncessit pour
d'autres. Sans doute ; on se perdrait aisment ici dans des distinctions subtiles.
Mais il y a des cas o il faut voir gros. Des millions d'hommes ne mangent
pas leur faim. Et il en est qui meurent de faim. Si la terre produisait
beaucoup plus, il y aurait beaucoup moins de chances pour qu'on ne manget
pas sa faim 1, pour qu'on mourt de faim. On allgue que la terre manque de
bras. C'est possible ; mais pourquoi demande-t-elle aux bras plus d'effort
qu'ils n'en devraient donner ? Si le machinisme a un tort, c'est de ne pas s'tre
employ suffisamment aider l'homme dans ce travail si dur. On rpondra
qu'il y a des machines agricoles, et que l'usage en est maintenant fort rpandu.
Je l'accorde, mais ce que la machine a fait ici pour allger le fardeau de
l'homme, ce que la science a fait de son ct pour accrotre le rendement de la
terre, est comparativement restreint. Nous sentons bien que l'agriculture, qui
nourrit l'homme, devrait dominer le reste, en tout cas tre la premire
proccupation de l'industrie elle-mme. D'une manire gnrale, l'industrie ne
s'est pas assez soucie de la plus ou moins grande importance des besoins
satisfaire. Volontiers elle suivait la mode, fabriquant sans autre pense que de
vendre. On voudrait, ici comme ailleurs, une pense centrale, organisatrice,
qui coordonnt l'industrie l'agriculture et assignt aux machines leur place
rationnelle, celle o elles peuvent rendre le plus de services l'humanit.
Quand on fait le procs du machinisme, on nglige le grief essentiel. On
l'accuse d'abord de rduire l'ouvrier a l'tat de machine, ensuite d'aboutir une
uniformit de production qui choque le sens artistique. Mais si la machine
1
Il y a sans doute des crises de surproduction qui s'tendent aux produits agricoles, et
qui peuvent mme commencer par eux. Mais elles ne tiennent videmment pas ce qu'il
y a trop de nourriture pour l'humanit. C'est simplement que, la production en gnral
n'tant pas suffisamment organise, les produits ne trouvent pas s'changer.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
165
procure l'ouvrier un plus grand nombre d'heures de repos, et si l'ouvrier
emploie ce supplment de loisir autre chose qu'aux prtendus amusements,
qu'un industrialisme mal dirig a mis la porte de tous, il donnera son
intelligence le dveloppement qu'il aura choisi, au lieu de s'en tenir celui que
lui imposerait, dans des limites toujours restreintes, le retour (d'ailleurs
impossible) l'outil, aprs suppression de la machine. Pour ce qui est de
l'uniformit du produit, l'inconvnient en serait ngligeable si l'conomie de
temps et de travail, ralise ainsi par l'ensemble de la nation, permettait de
pousser plus loin la culture intellectuelle et de dvelopper les vraies originalits. On a reproch aux Amricains d'avoir tous le mme chapeau. Mais la
tte doit passer avant le chapeau. Faites que je puisse meubler ma tte selon
mon got propre, et j'accepterai pour elle le chapeau de tout le monde. L
n'est pas notre grief contre le machinisme. Sans contester les services qu'il a
rendus aux hommes en dveloppant largement les moyens de satisfaire des
besoins rels, nous lui reprocherons d'en avoir trop encourage d'artificiels,
d'avoir pouss au luxe, d'avoir favoris les villes au dtriment des campagnes,
enfin d'avoir largi la distance et transform les rapports entre le patron et
l'ouvrier, entre le capital et le travail. Tous ces effets pourraient d'ailleurs se
corriger ; la machine ne serait plus alors que la grande bienfaitrice. Il faudrait
que l'humanit entreprt de simplifier son existence avec autant de frnsie
qu'elle en mit la compliquer. L'initiative ne peut venir que d'elle, car c'est
elle, et non pas la prtendue force des choses, encore moins une fatalit
inhrente la machine, qui a lanc sur une certaine piste l'esprit d'invention.
Mais l'a-t-elle tout fait voulu ? L'impulsion qu'elle a donne au dbut
allait-elle exactement dans la direction que l'industrialisme a prise ? Ce qui
n'est au dpart qu'une dviation imperceptible devient un cart considrable
l'arrive si l'on a march tout droit et si la course a t longue. Or, il n'est pas
douteux que les premiers linaments de ce qui devait tre plus tard le
machinisme se soient dessins en mme temps que les premires aspirations
la dmocratie. La parent entre les deux tendances devient pleinement visible
au XVIIIe sicle. Elle est frappante chez les encyclopdistes. Ne devons-nous
pas supposer alors que ce fut un souffle dmocratique qui poussa en avant
l'esprit d'invention, aussi vieux que l'humanit, mais insuffisamment actif tant
qu'on ne lui fit pas assez de place ? On ne pensait srement pas au luxe pour
tous, ni mme au bien-tre pour tous; mais pour tous on pouvait souhaiter
l'existence matrielle assure, la dignit dans la scurit. Le souhait tait-il
conscient ? Nous ne croyons pas l'inconscient en histoire : les grands courants souterrains de pense, dont on a tant parl, sont dus ce que des masses
d'hommes ont t entranes par un ou plusieurs d'entre eux. Ceux-ci savaient
ce qu'ils faisaient, mais n'en prvoyaient pas toutes les consquences. Nous
qui connaissons la suite, nous ne pouvons nous empcher d'en faire reculer
l'image jusqu' l'origine : le prsent, aperu dans le pass par un effet de mirage, est alors ce que nous appelons l'inconscient d'autrefois. La rtro-activit
du prsent est l'origine de bien des illusions philosophiques. Nous nous
garderons donc d'attribuer aux quinzime, seizime et dix-huitime sicles
(encore moins au dix-septime, si diffrent, et qu'on a considr comme une
parenthse sublime) des proccupations dmocratiques comparables aux
ntres. Nous ne leur prterons pas davantage la vision de ce que l'esprit
d'invention recelait en lui de puissance. Il n'en est pas moins vrai que la
Rforme, la Renaissance et les premiers symptmes ou prodromes de la
pousse inventive sont de la mme poque. Il n'est pas impossible qu'il y ait
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
166
eu l trois ractions, apparentes entre elles, contre la forme qu'avait prise
jusqu'alors l'idal chrtien. Cet idal n'en subsistait pas moins, mais il apparaissait comme un astre qui aurait toujours tourn vers l'humanit la mme
face : on commenait entrevoir l'autre, sans toujours s'apercevoir qu'il
s'agissait du mme astre. Que le mysticisme appelle l'asctisme, cela n'est pas
douteux. L'un et l'autre seront toujours l'apanage d'un petit nombre. Mais que
le mysticisme vrai, complet, agissant, aspire se rpandre, en vertu de la
charit qui en est l'essence, cela est non moins certain. Comment se
propagerait-il, mme dilu et attnu comme il le sera ncessairement, dans
une humanit absorbe par la crainte de ne pas manger sa faim ? L'homme
ne se soulvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le
point d'appui. Il devra peser sur la matire s'il veut se dtacher d'elle. En
d'autres termes, la mystique appelle la mcanique. On ne l'a pas assez
remarqu, parce que la mcanique, par un accident d'aiguillage, a t lance
sur une voie au bout de laquelle taient le bien-tre exagr et le luxe pour un
certain nombre, plutt que la libration pour tous. Nous sommes frapps du
rsultat accidentel, nous ne voyons pas le machinisme dans ce qu'il devrait
tre, dans ce qui en fait l'essence. Allons plus loin. Si nos organes sont des
instruments naturels, nos instruments sont par l mme des organes artificiels.
L'outil de l'ouvrier continue son bras ; l'outillage de l'humanit est donc un
prolongement de son corps. La nature, en nous dotant d'une intelligence
essentiellement fabricatrice, avait ainsi prpar pour nous un certain
agrandissement. Mais des machines qui marchent au ptrole, au charbon, la
houille blanche , et qui convertissent en mouvement des nergies potentielles accumules pendant des millions d'annes, sont venues donner notre
organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionne sa dimension et sa force, que srement il n'en avait rien t
prvu dans le plan de structure de notre espce : ce fut une chance unique, la
plus grande russite matrielle de l'homme sur la plante. Une impulsion
spirituelle avait peut-tre t imprime au dbut : l'extension s'tait faite
automatiquement, servie par le coup de pioche accidentel qui heurta sous terre
un trsor miraculeux 1. Or, dans ce corps dmesurment grossi, l'me reste ce
qu'elle tait, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger.
D'o le vide entre lui et elle. D'o les redoutables problmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de dfinitions de ce vide et qui, pour le
combler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts dsordonns et inefficaces : il y
faudrait de nouvelles rserves d'nergie potentielle, cette fois morale. Ne nous
bornons donc pas dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique
appelle la mcanique. Ajoutons que le corps agrandi attend un supplment
d'me, et que la mcanique exigerait une mystique. Les origines de cette
mcanique sont peut-tre plus mystiques qu'on ne le croirait; elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionns sa
puissance, que si l'humanit qu'elle a courbe encore davantage vers la terre
arrive par elle se redresser, et regarder le ciel.
Dans une oeuvre dont on ne saurait trop admirer la profondeur et la force,
M. Ernest Seillire montre comment les ambitions nationales s'attribuent des
missions divines : l' imprialisme se fait ordinairement mysticisme . Si
Nous parlons au figur, cela va sans dire. Le charbon tait connu bien avant que la
machine vapeur le convertit en trsor.
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
167
l'on donne ce dernier mot le sens qu'il a chez M. Ernest Seillire 1, et qu'une
longue srie d'ouvrages a suffisamment dfini, le fait est incontestable ; en le
constatant, en le reliant ses causes et en le suivant dans ses effets, l'auteur
apporte une contribution inapprciable la philosophie de l'histoire. Mais il
jugerait probablement lui-mme que le mysticisme ainsi entendu, ainsi compris d'ailleurs par l' imprialisme tel qu'il le prsente, n'est que la contrefaon du mysticisme vrai, de la religion dynamique que nous avons
tudie dans notre dernier chapitre. Nous croyons apercevoir le mcanisme de
cette contrefaon. Ce fut un emprunt la religion statique des anciens,
qu'on dmarqua et qu'on laissa sa forme statique sous l'tiquette nouvelle
que la religion dynamique fournissait. La contrefaon n'avait d'ailleurs aucune
intention dlictueuse ; elle tait peine voulue. Rappelons-nous en effet que
la religion statique est naturelle l'homme, et que la nature humaine ne
change pas. Les croyances innes nos anctres subsistent au plus profond de
nous-mmes ; elles reparaissent, ds qu'elles ne sont plus refoules par des
forces antagonistes. Or un des traits essentiels des religions antiques tait
l'ide d'un lien entre les groupements humains et des divinits attaches
chacun d'eux. Les dieux de la cit combattaient pour elle, avec elle. Cette
croyance est incompatible avec le mysticisme vrai, je veux dire avec le
sentiment qu'ont certaines mes d'tre les instruments d'un Dieu qui aime tous
les hommes d'un gal amour, et qui leur demande de s'aimer entre eux. Mais,
remontant des profondeurs obscures de l'me la surface de la conscience, et
y rencontrant l'image du mysticisme vrai telle que les mystiques modernes
l'ont prsente au monde, instinctivement elle s'en affuble ; elle attribue au
Dieu du mystique moderne le nationalisme des anciens dieux. C'est dans ce
sens que l'imprialisme se fait mysticisme. Que si l'on s'en tient au mysticisme
vrai, on le jugera incompatible avec l'imprialisme. Tout au plus dira-t-on,
comme nous venons de le faire, que le mysticisme ne saurait se rpandre sans
encourager une volont de puissance trs particulire. Il s'agira d'un
empire exercer, non pas sur les hommes, mais sur les choses, prcisment
pour que l'homme n'en ait plus tant sur l'homme.
Qu'un gnie mystique surgisse ; il entranera derrire lui une humanit au
corps dj immensment accru, l'me par lui transfigure. Il voudra faire
d'elle une espce nouvelle, ou plutt la dlivrer de la ncessit d'tre une
espce : qui dit espce dit stationnement collectif, et l'existence complte est
mobilit dans l'individualit. Le grand souffle de vie qui passa sur notre
plante avait pouss l'organisation aussi loin que le permettait une nature la
fois docile et rebelle. On sait que nous dsignons par ce dernier mot l'ensemble des complaisances et des rsistances que la vie rencontre dans la matire
brute, - ensemble que nous traitons, l'exemple du biologiste, comme si l'on
pouvait lui prter des intentions. Un corps qui comportait l'intelligence fabricatrice avec, autour d'elle, une frange d'intuition, tait ce que la nature avait
pu faire de plus complet. Tel tait le corps humain. L s'arrtait l'volution de
la vie. Mais voici que l'intelligence, haussant la fabrication de ses instruments
un degr de complication et de perfection que la nature (si inapte la
construction mcanique) n'avait mme pas prvu, dversant dans ces machines des rserves d'nergie auxquelles la nature (si ignorante de l'conomie)
n'avait mme pas pens, nous a dots de puissances ct desquelles celle de
1
Sens dont nous ne considrons d'ailleurs ici qu'une partie, comme nous le faisons aussi
pour le mot imprialisme .
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
168
notre corps compte peine : elles seront illimites, quand la science saura
librer la force que reprsente, condense, la moindre parcelle de matire
pondrable. L'obstacle matriel est presque tomb. Demain la voie sera libre,
dans la direction mme du souffle qui avait conduit la vie au point o elle
avait d s'arrter. Vienne alors l'appel du hros : nous ne le suivrons pas tous,
mais tous nous sentirons que nous devrions le faire, et nous connatrons le
chemin, que nous largirons si nous y passons. Du mme coup s'claircira
pour toute philosophie le mystre de l'obligation suprme : un voyage avait
t commenc, il avait fallu l'interrompre ; en reprenant sa route, on ne fait
que vouloir encore ce qu'on voulait dj. C'est toujours l'arrt qui demande
une explication, et non pas le mouvement.
Mais ne comptons pas trop sur l'apparition d'une grande me privilgie.
A dfaut d'elle, d'autres influences pourraient dtourner notre attention des
hochets qui nous amusent et des mirages autour desquels nous nous battons.
On a vu en effet comment le talent d'invention, aid de la science, avait
mis la disposition de l'homme des nergies insouponnes. Il s'agissait
d'nergies physico-chimiques, et d'une science qui portait sur la matire. Mais
l'esprit ? A-t-il t approfondi scientifiquement autant qu'il aurait pu l'tre ?
Sait-on ce qu'un tel approfondissement pourrait donner ? La science s'est
attache la matire d'abord ; pendant trois sicles elle n'a pas eu d'autre objet
; aujourd'hui encore, quand on ne joint pas au mot un qualificatif, il est
entendu qu'on parle de la science de la matire. Nous en avons autrefois
donn les raisons. Nous avons indiqu pourquoi l'tude scientifique de la
matire avait prcd celle de l'esprit. Il fallait aller au plus press. La
gomtrie existait dj ; elle avait t pousse assez loin par les anciens ; on
devait commencer par tirer de la mathmatique tout ce qu'elle pouvait fournir
pour l'explication du monde o nous vivons. Il n'tait d'ailleurs pas souhaitable que l'on comment par la science de l'esprit : elle ne ft pas arrive par
elle-mme la prcision, la rigueur, au souci de la preuve, qui se sont
propags de la gomtrie la physique, la chimie et la biologie, en
attendant de rebondir sur elle. Toutefois, par un autre ct, elle n'a pas t
sans souffrir d'tre venue si tard. L'intelligence humaine a pu en effet, dans
l'intervalle, faire lgitimer par la science et investir ainsi d'une autorit
inconteste son habitude de tout voir dans l'espace, de tout expliquer par la
matire. Se porte-t-elle alors sur l'me ? Elle se donne une reprsentation
spatiale de la vie intrieure ; elle tend son nouvel objet l'image qu'elle a
garde de l'ancien : d'o les erreurs d'une psychologie atomistique des tats
de conscience ; d'o les inutiles efforts d'une philosophie qui prtend atteindre
l'esprit sans le chercher dans la dure. S'agit-il de la relation de l'me au
corps ? La confusion est encore plus grave. Elle n'a pas seulement mis la
mtaphysique sur une fausse piste ; elle a dtourn la science de l'observation
de certains faits, ou plutt elle a empch de natre certaines sciences,
excommunies par avance au nom de je ne sais quel dogme. Il a t entendu
en effet que le concomitant matriel de l'activit mentale en tait l'quivalent :
toute ralit tant cense avoir une base spatiale, on ne doit rien trouver de
plus dans l'esprit que ce qu'un physiologiste surhumain lirait dans le cerveau
correspondant. Remarquons que cette thse est une pure hypothse mtaphysique, interprtation arbitraire des faits. Mais non moins arbitraire est la
mtaphysique spiritualiste qu'on y oppose, et d'aprs laquelle chaque tat
d'me utiliserait un tat crbral qui lui servirait simplement d'instrument ;
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
169
pour elle encore, l'activit mentale serait coextensive l'activit crbrale et y
correspondrait point point dans la vie prsente. La seconde thorie est
d'ailleurs influence par la premire, dont elle a toujours subi la fascination.
Nous avons essay d'tablir, en cartant les ides prconues qu'on accepte
des deux cts, en serrant d'aussi prs que possible le contour des faits, que le
rle du corps est tout diffrent. L'activit de l'esprit a bien un concomitant
matriel, mais qui n'en dessine qu'une partie ; le reste demeure dans l'inconscient. Le corps est bien pour nous un moyen d'agir, mais c'est aussi un
empchement de percevoir. Son rle est d'accomplir en toute occasion la
dmarche utile ; prcisment pour cela, il doit carter de la conscience, avec
les souvenirs qui n'claireraient pas la situation prsente, la perception
d'objets sur lesquels nous n'aurions aucune prise 1. C'est, comme on voudra,
un filtre ou un cran. Il maintient l'tat virtuel tout ce qui pourrait gner
l'action en s'actualisant. Il nous aide voir devant nous, dans l'intrt de ce
que nous avons faire ; en revanche il nous empche de regarder droite et
gauche, pour notre seul plaisir. Il nous cueille une vie psychologique relle
dans le champ immense du rve. Bref, notre cerveau n'est ni crateur ni
conservateur de notre reprsentation ; il la limite simplement, de manire la
rendre agissante. C'est l'organe de l'attention la vie. Mais il rsulte de l qu'il
doit y avoir, soit dans le corps, soit dans la conscience qu'il limite, des
dispositifs spciaux dont la fonction est d'carter de la perception humaine les
objets soustraits par leur nature l'action de l'homme. Que ces mcanismes se
drangent, la porte qu'ils maintenaient ferme s'entr'ouvre : quelque chose
passe d'un en dehors qui est peut-tre un au-del . C'est de ces perceptions anormales que s'occupe la science psychique. On s'explique dans une
certaine mesure les rsistances qu'elle rencontre. Elle prend son point d'appui
dans le tmoignage humain, toujours sujet caution. Le type du savant est
pour nous le physicien ; son attitude de lgitime confiance envers une matire
qui ne s'amuse videmment pas le tromper est devenue pour nous caractristique de toute science. Nous avons de la peine traiter encore de
scientifique une recherche qui exige des chercheurs qu'ils flairent partout la
mystification. Leur mfiance nous donne le malaise, et leur confiance encore
davantage : nous savons qu'on se dshabitue vite d'tre sur ses gardes ; la
pente est glissante, qui va de la curiosit la crdulit. Encore une fois, on
s'explique ainsi certaines rpugnances. Mais on ne comprendrait pas la fin de
non-recevoir que de vrais savants opposent la recherche psychique si ce
n'tait qu'avant tout ils tiennent les faits rapports pour invraisemblables ;
ils diraient impossibles , s'ils ne savaient qu'il n'existe aucun moyen
concevable d'tablir l'impossibilit d'un fait ; ils sont nanmoins convaincus,
au fond, de cette impossibilit. Et ils en sont convaincus parce qu'ils jugent
incontestable, dfinitivement prouve, une certaine relation entre l'organisme
et la conscience, entre le corps et l'esprit. Nous venons de voir que cette
relation est purement hypothtique, qu'elle n'est pas dmontre par la science,
mais exige par une mtaphysique. Les faits suggrent une hypothse bien
diffrente ; et si on l'admet, les phnomnes signals par la science psychique , ou du moins certains d'entre eux, deviennent tellement vraisemblables
qu'on s'tonnerait plutt du temps qu'il a fallu attendre pour en voir
entreprendre l'tude. Nous ne reviendrons pas ici sur un point que nous avons
1
Nous avons montr ci-dessus comment un sens tel que la vue porte plus loin, parce que
son instrument rend cette extension invitable. (V. p. 179. Cf. Matire et mmoire, tout le
premier chapitre.)
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
170
discut ailleurs. Bornons-nous dire, pour ne parler que de ce qui nous
semble le mieux tabli, que si l'on met en doute la ralit des manifestations
tlpathiques par exemple, aprs les milliers de dpositions concordantes
recueillies sur elles, c'est le tmoignage humain en gnral qu'il faudra dclarer inexistant aux yeux de la science : que deviendra l'histoire ? La vrit est
qu'il y a un choix faire parmi les rsultats que la science psychique nous
prsente ; elle-mme est loin de les mettre tous au mme rang ; elle distingue
entre ce qui lui parat certain et ce qui est simplement probable ou tout au plus
possible. Mais, mme si l'on ne retient qu'une partie de ce qu'elle avance
comme certain, il en reste assez pour que nous devinions l'immensit de la
terra incognita dont elle commence seulement l'exploration. Supposons
qu'une lueur de ce monde inconnu nous arrive, visible aux yeux du corps.
Quelle transformation dans une humanit gnralement habitue, quoi qu'elle
dise, n'accepter pour existant que ce qu'elle voit et ce qu'elle touche !
L'information qui nous viendrait ainsi ne concernerait peut-tre que ce qu'il y
a d'infrieur dans les mes, le dernier degr de la spiritualit. Mais il n'en
faudrait pas davantage pour convertir en ralit vivante et agissante une
croyance l'au-del qui semble se rencontrer chez la plupart des hommes,
mais qui reste le plus souvent verbale, abstraite, inefficace. Pour savoir dans
quelle mesure elle compte, il suffit de regarder comment on se jette sur le
plaisir : on n'y tiendrait pas ce point si l'on n'y voyait autant de pris sur le
nant, un moyen de narguer la mort. En vrit, si nous tions srs, absolument
srs de survivre, nous ne pourrions plus penser autre chose. Les plaisirs
subsisteraient, mais ternes et dcolors, parce que leur intensit n'tait que
l'attention que nous fixions sur eux. Ils pliraient comme la lumire de nos
ampoules au soleil du matin. Le plaisir serait clips par la joie.
Joie serait en effet la simplicit de vie que propagerait dans le monde une
intuition mystique diffuse, joie encore celle qui suivrait automatiquement
une vision d'au-del dans une exprience scientifique largie. A dfaut d'une
rforme morale aussi complte, il faudra recourir aux expdients, se soumettre
une rglementation de plus en plus envahissante, tourner un un les
obstacles que notre nature dresse contre notre civilisation. Mais, qu'on opte
pour les grands moyens ou pour les petits, une dcision s'impose. L'humanit
gmit, demi crase sous le poids des progrs qu'elle a faits. Elle ne sait pas
assez que son avenir dpend d'elle. A elle de voir d'abord si elle veut
continuer vivre. A elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement,
ou fournir en outre l'effort ncessaire pour que s'accomplisse, jusque sur notre
plante rfractaire, la fonction essentielle de l'univers, qui est une machine
faire des dieux.
FIN DU LIVRE.
You might also like
- Durkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialDocument4 pagesDurkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialGros Caca Liquide100% (1)
- ARISTOTE, Éthique À EudemeDocument10 pagesARISTOTE, Éthique À EudemewizzardravenNo ratings yet
- Les Méditations CartesiennesDocument26 pagesLes Méditations Cartesiennesjules borrelNo ratings yet
- Foucault - BHL - Non Au Sexe RoiDocument9 pagesFoucault - BHL - Non Au Sexe RoiyaoulNo ratings yet
- Hegel Et Le Possible RéelDocument26 pagesHegel Et Le Possible RéelGKF1789No ratings yet
- Emmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIADocument10 pagesEmmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIAToxophilus TheLuckyNo ratings yet
- Jan PatockaDocument5 pagesJan PatockakappamakikappaNo ratings yet
- Le Droit Comme Forme de Socialisation Georg Simmel Et Le Problème de LégitimitéDocument24 pagesLe Droit Comme Forme de Socialisation Georg Simmel Et Le Problème de LégitimitébloodyblackwingNo ratings yet
- Nouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240gDocument278 pagesNouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240ggrão-de-bicoNo ratings yet
- ELLUL - Le Système TechnicienDocument21 pagesELLUL - Le Système TechnicienAnna LongoNo ratings yet
- Husserl PDFDocument211 pagesHusserl PDFnicomakhosNo ratings yet
- De La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFDocument10 pagesDe La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFpolix1No ratings yet
- EMMANUEL MOUNIER - Lurol, GerardDocument256 pagesEMMANUEL MOUNIER - Lurol, GerardΡικαρδο Ραμοσ Παλομινο100% (1)
- Hegel - Le Fini Et L'infiniDocument7 pagesHegel - Le Fini Et L'infiniBoris100% (1)
- Dualisme (Philosophie de L'esprit) PDFDocument14 pagesDualisme (Philosophie de L'esprit) PDFMouhsine CheNo ratings yet
- Tran Duc Thao Textes FrenchDocument38 pagesTran Duc Thao Textes Frenchnr655321No ratings yet
- Husserl La Crise de L'humanité Européenne Et La PhilosophieDocument150 pagesHusserl La Crise de L'humanité Européenne Et La PhilosophieCanal ConcordeNo ratings yet
- Bien Et Bonheur Chez Kant PDFDocument293 pagesBien Et Bonheur Chez Kant PDFBassam BeylounehNo ratings yet
- Cogito Et Histoire de La FolieDocument36 pagesCogito Et Histoire de La FolieChiko VadouNo ratings yet
- René Girard Du Désir Au Rite Sacrificiel PDFDocument6 pagesRené Girard Du Désir Au Rite Sacrificiel PDFMichelotto Toonomamoueinaikaneís Paulo100% (1)
- M Canto Sperber L'Absurde Et Le Sens de La VieDocument17 pagesM Canto Sperber L'Absurde Et Le Sens de La Viethat_usernameNo ratings yet
- ÉTAT D EXCEPTION by Agamben GiorgioDocument85 pagesÉTAT D EXCEPTION by Agamben GiorgioAhmedCommunisteNo ratings yet
- VicoDocument96 pagesVicopippiNo ratings yet
- Queue Du BonheurDocument62 pagesQueue Du BonheurAlexandre SilenusNo ratings yet
- Frédéric Neyrat - Le Communisme Existentiel de Jean-Luc Nancy-Nouvelles Editions Lignes (2013)Document77 pagesFrédéric Neyrat - Le Communisme Existentiel de Jean-Luc Nancy-Nouvelles Editions Lignes (2013)JavierNo ratings yet
- Lyotard Derive A Partir de Marx Et Freud PDFDocument106 pagesLyotard Derive A Partir de Marx Et Freud PDFDaniel Cifuentes100% (1)
- Husserl Et Dilthey - La Problématique de La PhénoménologieDocument5 pagesHusserl Et Dilthey - La Problématique de La PhénoménologieYolande-Pyrène de JurquetNo ratings yet
- Corps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)Document21 pagesCorps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)dhstyjntNo ratings yet
- Le Désir D'eternité - Alquié, FerdinandDocument153 pagesLe Désir D'eternité - Alquié, FerdinandcarajulienNo ratings yet
- Hume - Discours Politiques PDFDocument224 pagesHume - Discours Politiques PDFCeernoNo ratings yet
- Les 3 Vagues de La Modernite-Leo StraussDocument14 pagesLes 3 Vagues de La Modernite-Leo StraussmalsaineNo ratings yet
- La Volonté de Vouloir by Jankélévitch VladimirDocument45 pagesLa Volonté de Vouloir by Jankélévitch VladimirMohamed MoussaouiNo ratings yet
- HYPPOLITE, J. - Vie Et Philosophie de L'histoire Chez BergsonDocument7 pagesHYPPOLITE, J. - Vie Et Philosophie de L'histoire Chez BergsonFernando Delfino PoloNo ratings yet
- Eustache Kouvelakis-L'Introduction A La Critique de La Philosophie Du Droit de Hegel, Karl Marx (2000)Document62 pagesEustache Kouvelakis-L'Introduction A La Critique de La Philosophie Du Droit de Hegel, Karl Marx (2000)Gastón GRNo ratings yet
- Jean Granier Nietzsche FreudDocument15 pagesJean Granier Nietzsche Freudpjonas.almeida2990No ratings yet
- Nietzsche - Fragments PosthumesDocument6 pagesNietzsche - Fragments PosthumesscrazedNo ratings yet
- Rencontres Internationales de GenÈveDocument330 pagesRencontres Internationales de GenÈveddufourtNo ratings yet
- Nouvelle IgnoranceDocument203 pagesNouvelle IgnoranceMarc nobert junior JeanNo ratings yet
- Ernst Mach La Connaissance Et L - ErreurDocument266 pagesErnst Mach La Connaissance Et L - Erreurdexterite99100% (3)
- Garrigou Lagrange Le RéalismeDocument13 pagesGarrigou Lagrange Le RéalismePagilisNo ratings yet
- Karl Vorländer Histoire de La Philosophie - Max StirnerDocument2 pagesKarl Vorländer Histoire de La Philosophie - Max StirnerLibrairie IneffableNo ratings yet
- 03 La Dematerialisation StructuralisteDocument9 pages03 La Dematerialisation Structuralistebadid SusskindNo ratings yet
- La Responsabilite Chez Sartre Et Levinas Stephane HabibDocument165 pagesLa Responsabilite Chez Sartre Et Levinas Stephane HabibLucas PalmierNo ratings yet
- Descartes CorrespondanceDocument33 pagesDescartes Correspondancemahrez00No ratings yet
- Philosophie A GregDocument44 pagesPhilosophie A GregعبداللهبنزنوNo ratings yet
- Bourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPDocument14 pagesBourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPcouturatNo ratings yet
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuFrom EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuNo ratings yet
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustFrom EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustNo ratings yet
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- Des profondeurs de l'être: Marie-Magdeleine Davy, itinéraire d'une philosophe absolueFrom EverandDes profondeurs de l'être: Marie-Magdeleine Davy, itinéraire d'une philosophe absolueNo ratings yet
- Essais et Conférences de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandEssais et Conférences de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- Recherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandRecherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- Pensées de Blaise Pascal - Fragments 425 et 430 : le divertissement: Commentaire de texteFrom EverandPensées de Blaise Pascal - Fragments 425 et 430 : le divertissement: Commentaire de texteNo ratings yet
- La Nuit du renard de Mary Higgins Clark (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreFrom EverandLa Nuit du renard de Mary Higgins Clark (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreNo ratings yet
- SIGMUND FREUD-De Quoi Lanxieux A-T-Il Peur - (Atramenta - Net)Document10 pagesSIGMUND FREUD-De Quoi Lanxieux A-T-Il Peur - (Atramenta - Net)Julien LaizéNo ratings yet
- Trois Propos Sur Le Sujet 1 F.F.BDocument8 pagesTrois Propos Sur Le Sujet 1 F.F.BJulien LaizéNo ratings yet
- MC - Terrier Se M Du 19 3 13Document15 pagesMC - Terrier Se M Du 19 3 13Julien LaizéNo ratings yet
- Linux (WWW - Worldmediafiles.com)Document722 pagesLinux (WWW - Worldmediafiles.com)Amina Elaibi100% (1)
- Adler - Connaissance de L'hommeDocument176 pagesAdler - Connaissance de L'hommekainomidNo ratings yet
- Livre Psy FemmeDocument92 pagesLivre Psy FemmeJulien LaizéNo ratings yet
- Carnet de Cuisine 2011 - by WantedxDocument66 pagesCarnet de Cuisine 2011 - by WantedxJulien LaizéNo ratings yet
- Le Grand Accélérateur - Paul VirilioDocument69 pagesLe Grand Accélérateur - Paul VirilioJulien LaizéNo ratings yet
- Chronique Des Indiens Guayaki - Pierre Clastres PDFDocument373 pagesChronique Des Indiens Guayaki - Pierre Clastres PDFguzstav999516100% (2)
- Dans L'enfer Des Tournantes - Samira BellilDocument196 pagesDans L'enfer Des Tournantes - Samira BellilJulien Laizé100% (3)
- SpinozaDocument118 pagesSpinozaAnonymous va7umdWyhNo ratings yet
- Nietzsche PimbeDocument93 pagesNietzsche PimbeJulien LaizéNo ratings yet
- Lexi QueDocument989 pagesLexi QueJulien LaizéNo ratings yet
- 36148-JEAN-BAPTISTE MESSIER-Principes de Justice SocialeDocument14 pages36148-JEAN-BAPTISTE MESSIER-Principes de Justice SocialeJulien LaizéNo ratings yet
- Psycho Alfred AdlerDocument126 pagesPsycho Alfred AdlerJulien Laizé100% (1)
- Epictete ManuelDocument13 pagesEpictete Manueljeanmarc100% (1)
- Prologue Au Testament ''Document3 pagesPrologue Au Testament ''Julien LaizéNo ratings yet
- 36022-SYLVAIN RICHARD-Mini-Memoire Sur Husserl Et La Phenomenologie Transcendantale - (InLibroVeritas - Net)Document23 pages36022-SYLVAIN RICHARD-Mini-Memoire Sur Husserl Et La Phenomenologie Transcendantale - (InLibroVeritas - Net)Julien Laizé100% (1)
- Lettre À PythoclèsDocument22 pagesLettre À PythoclèsRaphael Sitor NdourNo ratings yet
- Kierk LacanDocument5 pagesKierk LacanJulien LaizéNo ratings yet
- Zarka L Idee Hobbesienne de Philosophie PolitiqueDocument12 pagesZarka L Idee Hobbesienne de Philosophie PolitiqueJulien LaizéNo ratings yet
- Kierk LacanDocument5 pagesKierk LacanJulien LaizéNo ratings yet
- Durkheim Sociologie Et PhilosophieDocument160 pagesDurkheim Sociologie Et PhilosophieYoav YinonNo ratings yet
- Épicure - Lettre À HérodoteDocument8 pagesÉpicure - Lettre À HérodoteStephanie Hernandez100% (1)
- Aristote Philosophie PremièreDocument15 pagesAristote Philosophie PremièreJulien LaizéNo ratings yet
- BaconDocument484 pagesBaconJulien LaizéNo ratings yet
- Jean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueDocument381 pagesJean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueVinícius dos Santos100% (8)
- Héraclite - FragmentsDocument37 pagesHéraclite - FragmentsAnonymous 6N5Ew3No ratings yet
- PAscal Sur Le VideDocument34 pagesPAscal Sur Le VideJulien LaizéNo ratings yet
- Capacités HumainesDocument94 pagesCapacités HumainesBrigitte Nolan100% (5)
- Fiche Descriptive de La Figure de Taylor FinalDocument3 pagesFiche Descriptive de La Figure de Taylor Finalbushra lNo ratings yet
- Dossier Stage Responsabilite Professeurs Secondaire Et CPE 20Document46 pagesDossier Stage Responsabilite Professeurs Secondaire Et CPE 20Fedosia BuligaNo ratings yet
- (Amande) QRC QCMPsychopathologieDocument22 pages(Amande) QRC QCMPsychopathologieSimo SimooNo ratings yet
- RapportPSSP EstimeDocument133 pagesRapportPSSP EstimeAllo Psy HaitiNo ratings yet
- Marketing de Base (RESUME)Document9 pagesMarketing de Base (RESUME)CheikhNo ratings yet
- 24-Fascicule Philosophie IA PG-CDC Février 2020 (VF)Document54 pages24-Fascicule Philosophie IA PG-CDC Février 2020 (VF)Mamadou Moustapha Sarr90% (21)
- Journal La Derniere Heure-Mons - Centre-04!06!2021Document56 pagesJournal La Derniere Heure-Mons - Centre-04!06!2021RobItzNo ratings yet
- Brochure 02 - La Reconstitution Du Temple InterieurDocument5 pagesBrochure 02 - La Reconstitution Du Temple InterieurHodonou SountonNo ratings yet
- Cours Gestion Du Temps S1 NewDocument16 pagesCours Gestion Du Temps S1 NewNawfal LaamNo ratings yet
- French Book - Biography - Veda IncarnateDocument96 pagesFrench Book - Biography - Veda IncarnateYuga Rishi Shriram Sharma AcharyaNo ratings yet
- Expériences Vécues Par Les Morts Rudolf SteinerDocument273 pagesExpériences Vécues Par Les Morts Rudolf SteinerJean Claude Romond100% (2)